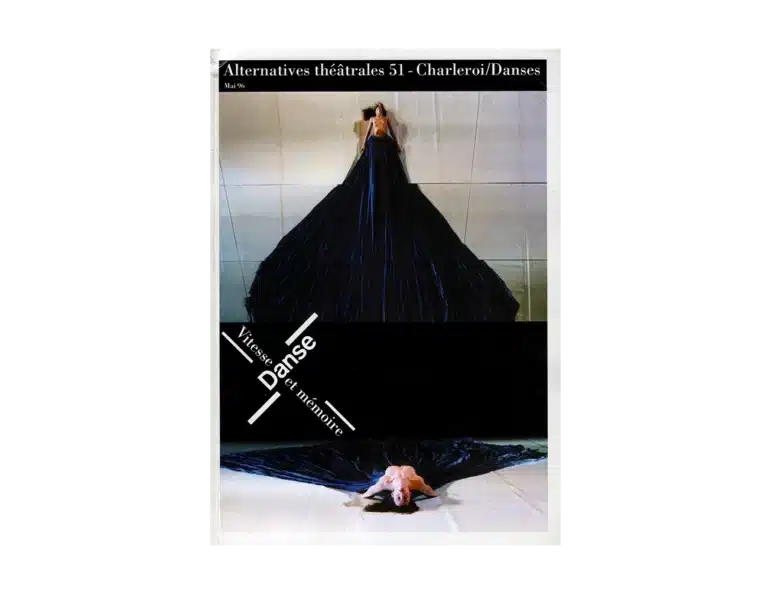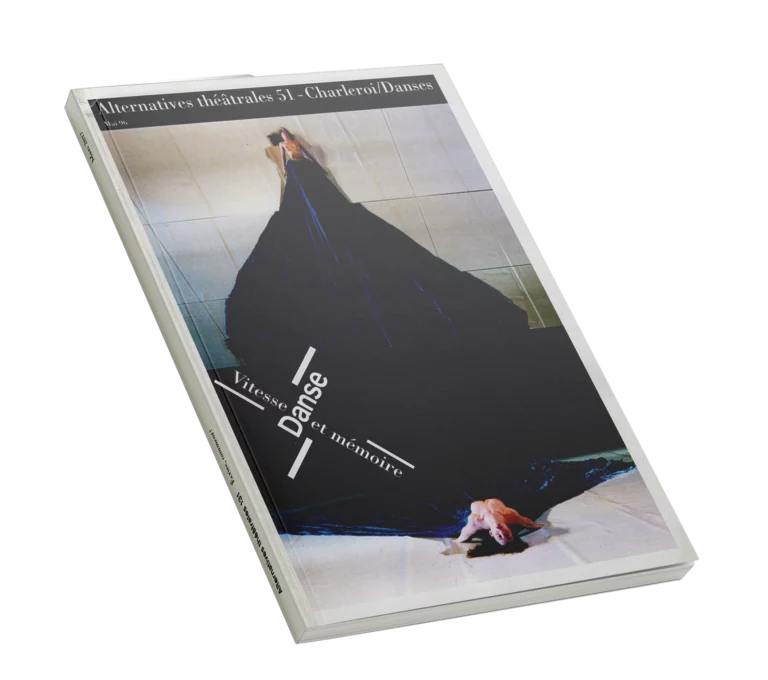BERNARD DEGROOTE : Quand nous vous avons contacté, nous vous avons proposé d’intervenir sur le thème de la Biennale, « Vitesse et mémoire », et vous nous avez répondu : « Je veux bien faire une intervention sur le thème «’vitesse et oubli’». C’était à la fois prendre à rebours le thème de la Biennale et en parler. Est-ce que la vitesse est toujours associée à l’oubli, ou est-ce que c’est dans une certaine définition de la mémoire ou de l’oubli que se réalise cette association ?
Paul Virilio : Quand j’ai publié LA MACHINE DE VISION1,en 1988, j’ai mis en exergue du livre une phrase de Norman Spear que je vous lis : « Le contenu de la mémoire est fonction de la vitesse de l’oubli ». C’est clair. La mémoire est liée à la nature de l’oubli, c’est-à-dire à sa vitesse. Puisque la mémoire est liée à la temporalité de manière très profonde, cette
mémoire est liée à l’élimination. L’oubli est l’élimination de la mémoire, comme on parle d’une élimination par l’urine ou d’une autre élimination. La vitesse élimine donc la mémoire, mais elle la constitue dans la mesure où il y a effectivement une vitesse relative à une pensée. Quelqu’un disait : une intuition, c’est un excès de vitesse de la pensée. Intéressant. Mais à l’inverse, si on oublie trop vite, il ne reste rien. Et on sait bien que dans des périodes où il se passe beaucoup de choses, dans des périodes d’accidents, de guerres, de traumatismes très graves, il ne reste aucune mémoire, sinon la stupéfaction ou la gravité du choc ou du traumatisme. Il n’y a plus rien. Donc la vitesse touche à tout, elle est à la base de toutes les informations : informations sur le corps et informations sur le monde. Je lisais dans un journal à propos des news : « Is slow news no news ? » Une information lente est-elle encore une information ? Je crois que c’est une grande question. La véritable information, c’est la vitesse. C’est qu’une information n’a de valeur que parce qu’elle est là au bon moment. On n’achète pas le journal de la veille, et on aimerait bien acheter le journal du lendemain.
La révolution de l’information dont on parle en ce moment est une révolution de la vitesse de l’information. Le « live », le temps réel, c’est une manière de dire que la seule information, c’est la vitesse, c’est Le scoop, c’est le spot, c’est l’effet d’annonce. Et là, bien entendu, nous sommes dans un temps-lumière, temps de la vitesse de la lumière et non plus dans un temps matière, c’est-à-dire le temps du vieillissement. Je vais expliquer les deux termes temps-lumière et temps-matière. Bien sûr, ils fonctionnent ensemble, on les distingue pour faire image. Le temps-matière, c’est vous et moi. Moi, j’ai 64 ans, je commence à vieillir, ça se voit. Un bâtiment qui a quelques millénaires, il faut le retaper. Les pyramides ont besoin d’être restaurées et pourtant elles sont là depuis quatre mille ans. Ça, c’est le temps-matière, le temps a de l’usure, de l’érosion, de la vieillesse, du vieillissement. C’est le temps de la longue durée du temps. Mais il y a le temps-lumière, c’est-à-dire le temps de l’éclair qui luit. Le temps du tonnerre qui gronde et le temps du « live », du direct, le temps réel. Et aujourd’hui, notre société s’est engagée dans un dépassement du temps-matière, du temps de la durée, de la longue durée, pour s’engager toute entière dans le temps-lumière, de la stupéfaction, de l’hallucination, etc. et donc dans l’oubli. Dans l’accélération de l’oubli. On le voit bien avec les médias : on est incapable de dire ce qui était en tête de l’éditorial du journal d’information d’il y a huit ou quinze jours : c’est déjà oublié. Donc l’information atteint le corps en tant qu’information. Le corps fait partie du temps-matière. C’est pour ça qu’on aime mieux une femme jeune qu’une femme vieille, parce qu’elle n’a pas les stigmates.…., elle n’a pas les stigmates du temps-matière, elle ne les a pas encore. Or, c’est ce temps-là qui est liquidé en ce moment au profit du vieillissement absolu, du vieillissement spontané, c’est-à-dire de l’effet de stupéfaction, d’hallucination du temps-lumière. Et je vais terminer là-dessus : la danse, le théâtre sont en première ligne de ce combat. Parce que la danse et le théâtre mettent en première ligne le temps-matière, c’est-à-dire le temps de l’unité de temps et de l’unité de lieu d’un corps présent ici et maintenant, hic et nune, in situ. Or, tout l’engagement de notre société dans Le temps lumière liquide cela au profit du clonage, au profit d’un être spectral, soit à travers la vidéo, soit à travers l’infographie ou le morphing, etc., etc., et tous les arts de la présence réelle comme le théâtre et la danse, mais il y en a d’autres, sont menacés par la virtualisation des corps, corps qui ne sont plus que des corps-lumière, des corps de la vitesse de la lumière, du calcul de l’image pour l’infographie, ou de la transmission de la vidéo, etc.
B. D.: Quand on parle d’une information qui fait disparaître le temps-matière au profit du temps-lumière, est-ce que ce n’est pas envisager l’information dans un sens très restrictif : l’information stratégique qui sert à des fins politiques et économiques, etc. ? Est-ce qu’il n’y a pas un autre type d’information qui a besoin d’un temps-matière ?
P. V. : Bien évidemment ; moi de toute façon, je résiste à ce que j’écris et à ce que je dis. Ce n’est pas parce que je le décris que je le soutiens. Bien évidemment et c’est le problème de l’accélération, non plus de l’histoire, mais de la réalité qui fait problème aujourd’hui. À l’époque de Braudel, on découvre que l’histoire, c’est aussi une accélération. Quand on lit l’histoire de l’Europe, l’histoire de la Méditerranée, pour parler de Braudel, on s’aperçoit qu’il y a une accélération des événements. Accélération qui n’est pas seulement liée à la densité démographique de l’Europe, mais qui est liée au développement des technologies. Or, cette idée qu’il y a une accélération de l’histoire est perçue à travers l’école des Annales — Marc Bloch, Fernand Braudel, Lucien Febvre — comme un événement extraordinaire. À priori, l’histoire n’a pas de temporalité sinon la sienne. L’histoire n’est pas un moteur. Tout à coup, Braudel et d’autres disent : « Oui, c’est un moteur l’histoire, ça s’accélère ». Or aujourd’hui, en cette fin de millénaire, on assiste non seulement à l’accélération de l’histoire, mais aussi à l’accélération de la réalité, du rapport au réel dans l’instant même. Pourquoi ? Parce que nous avons atteint l’échelle de la mondialisation, parce que le temps dominant est un temps réel, un temps mondial qui illustre la phrase de Shakespeare dans HAMLET : « Le temps est hors de ses gonds. » Qu’est-ce que c’est que « ses gonds » ? C’est littéral. Le temps ancien est le temps du tour de la terre, de l’alternance diurne-nocturne. Le gond, c’est le tour de planète. Quand Hamlet dit ça, c’est une belle phrase. Aujourd’hui, nous la vivons : c’est le temps réel, le temps mondial que les astronomes appellent le temps universel. Et ce temps-là, cette temporalité se fait parce que nous avons mis en œuvre la vitesse absolue, non plus la vitesse des pigeons ou des messagers de l’époque de la Méditerranée de Braudel, non plus les navires et les messagers à cheval de la poste naissante, mais le temps du « live », le temps de la vitesse de la lumière, le temps-lumière qui a atteint la limite des 300000 km/s des échanges électromagnétiques à la fois du son, de l’image, des informations et même de la télémétrie, c’est-à-dire de la télé-action. Donc, on le voit, nous ne vivons plus l’espace-temps local et relatif des anciens où le temps matière dominait sur le temps-lumière ; nous vivons l’espace-temps mondial, c’est ce qu’on appelle la mondialisation, et bien évidemment un temps-limite, un temps absolu, un temps axial, pour employer le terme de Hamlet. Le temps local de l’espace-temps local, c’est le temps des fuseaux horaires, de l’alternance diurne-nocturne, des saisons, c’est le temps-matière. Alors que le temps mondial est un temps axial qui n’a rien à voir avec la matière, ni avec le changement du jour et de la nuit, c’est le temps des sept jours sur sept, des vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Et les bourses qui sont à l’image de ce temps mondial vivent en synchronisme. Avant, il y avait un décalage entre la bourse de New York et la bourse du Pacifique, il y avait un décalage encore plus grand avec la bourse de Londres et la bourse de Tokyo, de Francfort ou de Paris. Désormais, il y a un synchronisme parce que nous avons mis en œuvre la vitesse de la lumière pour la première fois à une échelle mondiale et pas simplement pour le téléphone, la radio, mais dans des domaines stratégiques, des domaines économiques mais aussi esthétiques. Nous vivons le temps du monde, nous ne vivons plus le temps de l’espace, comme c’est votre cas en ce moment.
B. D.: Est-ce que ça veut dire que pour vivre le temps du monde, il a fallu.
P. V.: Perdre.
B. D.: Il a fallu qu’on sorte du monde, qu’on puisse le voir de l’extérieur ?
P. V.: Exactement. Et il a fallu mettre en orbite des objets, des satellites, qui sont la métaphore de l’émancipation du monde. Mon dernier livre s’appelle LA VITESSE DE LIBÉRATION2. La vitesse de libération est un terme technique, ce sont les 28000 kilomètres à l’heure qui permettent d’émanciper l’homme de l’attraction terrestre et de mettre en orbite un satellite ou un homme. La vitesse qui permet d’aller sur la Lune s’appelle la vitesse d’échappement : il faut atteindre 40000 kilomètres à l’heure pour s’arracher à l’orbite de la Terre. À partir de là, on n’augmente pas la vitesse de déplacement, parce que ce n’est pas nécessaire. Quand on a atteint 40000 kilomètres à l’heure, on peut aller n’importe où. Pour l’instant, la vitesse de libération nous a émancipés du temps-matière de la Terre, du temps des saisons, du temps de l’alternance diurne-nocturne, du temps du vieillissement. Et même s’il y a toujours un vieillissement, il compte infiniment moins que l’effet de feed-back, c’est-à-dire de l’instantanéité entre émission et réception d’un signal. Alors, si le corps disparaît, si Le corps de la terre disparaît ou s’éloigne, devient bien moins important qu’il ne l’a été pour les grands navigateurs qui avaient traversé les océans, etc., il va de soi que le corps de l’homme, lui aussi, est menacé de la même manière. Le temps-lumière peut faire l’économie du corps au profit de signaux, de spectres, qu’on appelle des clones. Le clone n’est pas simplement un phénomène génétique. Les bœufs, les veaux ou les lapins clonés sont un phénomène des télétechnologies. Dans ce qu’on appelle Le cyberspace, je peux avoir un clone qui me représente à distance et qui est mon émanation. Et c’est un fait qui menace gravement les arts de la corporéité que sont la danse et le théâtre. Je le disais à William Forsythe, et je le disais aussi à d’autres : comment vont réagir les gens de théâtre et les chorégraphes face à cela ? Est-ce qu’ils vont eux aussi abandonner la partie et choisir le clone comme le font beaucoup d’autres ? Je donne un exemple : la télésexualité, dont je parle aussi dans mon livre, est un exemple de clonage. Vous avez remarqué que depuis la parution de mon livre, il y a déjà eu un procès en adultère pour une télésexualité qui n’est pas aussi sophistiquée que celle que je décris dans mon livre, mais qui est déjà un problème dont il ne faut pas rire. On peut avoir des relations extrêmement intimes, et qui le seront de plus en plus dans l’avenir, avec quelqu’un qui n’est pas là, par la vitesse de l’information. Encore une fois, ce n’est pas l’information qui est importante dans ce cas : le fait de se palper ou d’être palpé, il n’y a rien de plus basique. Non, on peut se palper ou être palpé, sans parler de l’acte sexuel, instantanément, en étant à Tokyo ou à Los Angeles, c’est-à-dire sans être ensemble. La phrase du Christ s’inverse : il ne s’agit plus d’aimer son prochain ou sa prochaine comme soi-même, mais d’aimer son lointain ou sa lointaine comme soi-même. Mais en faisant cela, on perd le corps, on est bien d’accord. S’il y avait quelque chose qui embrayait le temps-matière, c’était bien l’accouplement, l’être-ensemble. Or, désormais les télétechnologies de la télésexualité, de la cybersexualité se développent au point de ne plus nécessiter l’être-ensemble. Donc, il y a perte de corps.
B. D.: Est-ce que vous pensez que cette idée du télécontact va remplacer un type de contact qui était le contact physique préexistant ou est-ce qu’on va vivre le rapport au corps sur plusieurs modes qui seront contemporains les uns des autres et qu’on passera de l’un à l’autre, quitte à provoquer chez certains une espèce de schizophrénie ?
P. V.: On aura les deux. On aura la catastrophe et puis on aura inévitablement un jour l’invention d’une poésie de cette mise à distance. Mais dans un premier temps, on aura la perte. Il n’y a pas d’acquis sans perte. Je le dis toujours, quand on a inventé l’ascenseur, on a perdu l’escalier. Il est toujours là, mais il ne sert plus à rien sauf quand il y a un incendie, surtout dans les tours évidemment. Quand on a inventé le jet, on a perdu le paquebot. Il y a encore des navigateurs solitaires, il y a beaucoup de paquebots avec des containers ou du pétrole, mais la mer n’est plus un lieu pratiqué par l’homme comme il l’a été dans le passé. Donc il y a toujours une perte. Et là, il va de soi que le contact cybernétique, le feed-back cybernétique, le mot est là, va entraîner la même perte de l’autre, de l’altérité, de l’altérité physique du prochain, de celui que je ne peux pas zapper. Je rappelle que le propre du prochain, c’est qu’il m’encombre, c’est qu’il est là à côté de moi, qu’il sent mauvais, qu’il me dérange, qu’il fait du bruit, qu’il me pose des questions. Or le lointain, lui, on peut l’interrompre, il suffit de le zapper. Et quand on a envie de lui, on l’appelle. Done il y a une sorte de loi de moindre action qui s’installe dans les rapports humains. La loi de moindre action, c’est important… ou du moindre effort, si on veut employer un terme plus banal. Toutes les sciences et technologies ont mis en œuvre des lois de moindre action. Pourquoi a‑t-on inventé la voiture ? Parce que c’était moins fatigant que d’être sur un cheval. Pourquoi est-on monté à cheval ? Parce que c’était moins fatigant que d’être à pied, en particulier pour faire la guerre ou pour faire le commerce. Pourquoi a‑t-on inventé le téléphone ? . Parce que c’est moins fatigant de téléphoner que d’écrire une lettre, ete. Il y a donc une histoire du moindre effort dans le monde, mais qui va de pair avec une perte. Si on se téléphone, on s’écrit moins, et enfin on ne s’écrit plus. Donc, si désormais on se fait l’amour au téléphone, pour prendre un exemple plus pointu, on va perdre, et il y a là même un risque démographique incalculable. Si la machine demain arrive à transcender et non seulement à égaler les sensations sensorielles sexuelles et autres, il est inévitable que nous ayons une perte de ce côté-là. C’est-à-dire qu’au lieu d’avoir perdu le cheval, ou la voiture — je vous rappelle qu’il n’y a plus de chevaux dans la rue, vous pouvez regarder, il y a encore des voitures, demain il n’y en aura plus —, nous aurons perdu le partenaire. La télésexualité correspondra à une perte majeure de l’humanité.
B. D.: Dans ce développement de la télésexualité, voyez-vous la disparition du désir, à savoir le chemin qu’il faut parcourir pour arriver à l’autre ?
P. V.: Comme on l’a dit tout à l’heure, il y a un oubli des préliminaires. Dans la relation dans le temps-matière, il y a des préliminaires. Si j’ai du plaisir à monter sur la montagne, c’est parce que ça prend du temps. Et puis quand je suis en haut, hurrah, j’y suis parvenu. Avec le temps-lumière, il n’y a plus de préliminaires. Tout, tout de suite. Et donc il est sûr que dans les relations sociales ou amoureuses — si je fais référence à la relation amoureuse, c’est parce que c’est là qu’est le maximum de la perte, c’est évident, ça entraîne tout le reste —, on perd les préliminaires. On assiste également actuellement à la perte de la politesse. Je suis scandalisé par la perte de la politesse. Tout le monde va me dire : mais la politesse, c’était de l’hypocrisie. Non, c’étaient des préliminaires. Je prends un exemple : quand j’écrivais une lettre jadis ou que je la recevais, j’avais : « cher Monsieur » et mon nom, mon titre éventuellement. Ensuite, j’ai eu « cher Monsieur », maintenant nous avons « Monsieur ». Dans les dernières lettres, il n’y a plus rien. La phrase commence ex abrupto, c’est elair, c’est très clair. La perte est claire. La phrase qui commence est là pour demander ou pour informer, mais elle n’est pas là pour introduire la demande ou l’information. On a coupé les préliminaires. C’est ce qu’on appelle aussi dans les relations sociales la désintermédiation, il n’y a plus d’intermédiaire. Tout, tout de suite. Le choc est immédiat. Alors, ce n’est peut-être pas hypocrite, mais c’est sacrément violent.
B. D.: C’est la convention qui existe dans les échanges de courrier électronique sur le réseau Internet.
P. V.: Par exemple. À tous les niveaux, on perd les préliminaires. Et perdant les préliminaires, il est probable qu’on perdra le désir car le désir n’est pas automatique. Or, nous allons vers des relations automatiques qui sont inspirées par un feed-back machinique. C’est une machine, hein. Les télécommunications, les télétechnologies sont à base d’un feed-back qui est un automatisme. Donc, il y a une menace effectivement de perte, d’oubli du désir au profit d’une satisfaction immédiate.
B. D.: Et dans ce contexte, les arts du spectacle vivant ne pourraient-ils pas être le dernier lieu où ce désir est possible ?
P. V.: Je l’espère et c’est pour ça que je défends à la fois l’écrit, le corps, la danse et le théâtre parce qu’à mon avis, ça va ensemble. La menace de l’écran sur l’écrit, elle est déjà très claire. La menace sur la presse écrite, sur le livre, est déjà là :il suffit de regarder les difficultés qu’ont les journaux, les difficultés des petits éditeurs qui ne sont pas multimédia. Et cette situation s’étend à toutes les relations. C’est un phénomène général, c’est un phénomène d’ampleur maximum puisque ça concerne l’espace et le temps. Je rappelle que si nous sommes homme ou femme, nous le sommes dans un corps propre, au sein d’un monde propre. Or, le monde propre est liquidé par la rapidité absolue du feed-back ; on peut être instantanément par les télétechnologies à New York ou ailleurs, mais après l’élimination du monde propre, l’élimination dans l’instantanéité de l’échange, il y a la possibilité de l’élimination du corps propre. C’est-à-dire une perte de la temporalité propre du corps, une temporalité qui est limitée. Un individu a une vitesse comme il a un âge ou un sexe. Quand on dit qui on est, j’ai envie de dire on est homme, femme, fort, grand, petit, brun, tout ce qu’on veut au niveau de la matière, mais il faut dire en plus qu’on est vitesse. Etre vif, être vivant — le mot a la même source — être vif, c’est être vitesse. Quand on est fiévreux, on a une vitesse supérieure ; quand on est fatigué, on a une vitesse inférieure. Cette vitesse permet de s’informer, de voir certaines images : 24 images/seconde, 30 images/seconde ; au-delà, on entre dans le subliminal, on ne voit plus. C’est-à-dire que notre vitesse de perception est limitée. On a assisté récemment à un exemple extraordinaire : la partie d’échecs entre Kasparov et l’ordinateur Deep Blue ; extraordinaire… Pour que Kasparov gagne, et ça, personne ne l’a dit, il a fallu qu’il retrouve ses deux heures de calcul avant de jouer ses coups. Quand il avait joué avec l’ordinateur précédent, il avait perdu parce qu’on n’avait pas tenu compte de la nécessité du temps humain pour calculer. L’ordinateur fonctionne à la vitesse de la lumière, il aligne les coups et les coups, et il fallait que l’homme ait au moins autant de temps de réflexion que dans un tournoi international, c’est-à-dire deux heures, et à partir de là, il a gagné. Pour combien de temps, peu importe. Mais c’est très intéressant. Ça veut dire que l’homme est homme à l’intérieur d’une vitesse donnée. Il y a donc une sorte de racisme de la machine qui vise à éliminer l’homme non pas en disant : « Tu es noir, tu es juif », mais : « Tu es lent ». Ce qui revient au même. La vitesse est le dénominateur commun des performances, et si l’homme ne s’y plie pas, il n’est rien. C’est une des grandes menaces. Et on n’a pas assez mis l’accent avec Kasparov sur ce changement dans la règle du jeu. C’est-à-dire de donner du temps à l’homme, un temps sans lequel il est battu à tous les coups.
B. D.: À propos du match Kasparov-Deep Blue, les commentaires précisaient que l’ordinateur est incapable d’établir des stratégies à long terme.
P. V.: Pour l’instant. C’est intéressant parce que c’est la notion de perspective qui intervient. Je rappelle que la stratégie, c’est ce qui se développe dans le temps en dehors du champ de bataille. Je reprends ici un terme militaire. La tactique, ce sont les coups qu’on exerce sur le champ de bataille ou sur l’échiquier, c’est-à-dire les pièges : je pars à gauche au lieu d’aller à droite, je feinte comme un boxeur. La stratégie correspond à une vision dans le temps et dans l’espace qui excède le champ de bataille. On entre là dans une perspective, au sens du Quattrocento, qui n’est plus une perspective de l’espace réel du champ de bataille ou de l’échiquier, mais une perspective du temps réel des coups à venir. Etant donné que l’ordinateur calcule à une vitesse fabuleuse, il est toujours dans un temps qui est infiniment éloigné du temps de l’homme. Il faut donc que l’homme soit capable d’utiliser au maximum, dans le cas d’un champion, cette préfiguration anticipée d’actions futures. Que se passera-t-il dans l’avenir, je ne sais pas, mais c’est un exemple qui prouve que l’homme est vitesse. C’est pour cela que le travail sur la vitesse est un travail sur l’homme. Ce n’est pas simplement un travail sur l’accélération des TGV ou de choses comme ça. C’est un problème d’être. Nous sommes vitesse.
Pour en revenir au corps, je suis très inquiet de ces accélérations par rapport au corps. Parce que, comme je l’ai écrit dans L’HORIZON NÉGATIF3 , la vitesse est un milieu, ce n’est pas seulement un problème d’accélération. C’est un milieu dans lequel nous sommes. Nous sommes en ce moment dans le milieu vitesse de notre santé. Le milieu vitesse implique l’oubli du milieu terrestre. Quand on traverse à grande vitesse un paysage en TGV, on élimine le paysage, il ne change plus. C’est étonnant de remarquer à quel point, quand vous prenez le TGV, vous ne sentez pas les saisons. Quand vous marchez à pied dans la campagne, ou même en voiture ou à vélo, vous pénétrez des saisons différentes. Quand vous êtes en TGV, on essuie comme avec une gomme qui effacerait les saisons. Bien sûr, s’il y a de la neige partout, c’est plus blanc. C’est un peu comme la nuit, il fait noir, mais ce n’est pas les saisons, ça. C’est un phénomène unificateur, uniforme. Je dirai que la vitesse est uniforme, la nuit aussi, la neige aussi, mais à part ça, regardez bien le TGV : il n’y a pas de saison et à la limite, il n’y a pas de paysage.
B. D.: C’est curieux de voir l’œil de quelqu’un qui regarde défiler un paysage, parce que l’œil est agité de soubresauts.
P. V.: Oui, l’œil est shunté. En ce sens, on pourrait dire que le vite mène au vide. Et c’est vrai puisque la vitesse amène à l’impesanteur. Les premiers avions volaient parce qu’ils avaient des surfaces de sustentation assez importantes. Maintenant, avec les jets, c’est la poussée du réacteur qui permet de maintenir l’objet en l’air. Autrement dit, ce n’est pas tellement la matière des ailes, des surfaces de sustentation, la dérive, etc., c’est la puissance du jet, un peu comme pour la fusée, qui est déterminante. La fusée est portée par la vitesse d’éjection de la tuyère. Donc, on a là un phénomène de perte du milieu. Le vite provoque le vide. Regardez par exemple un autodrome, un hippodrome, un aérodrome ou une autoroute, ce sont des espaces désertifiés où on a aplani la surface pour qu’il ne reste rien. La notion de drome qui est la base de dromologie, le montre bien. Autodrome, hippodrome, aérodrome, sont le lieu d’un désert fabriqué par l’homme pour la vitesse. La vitesse fabrique un désert, on l’a vu pour le TGV ou les saisons, mais quand on veut mettre en forme des courses quelles qu’elles soient, la course de l’avion, du train, du bateau, du coureur, le stade, il faut désertifier préalablement. Et je dis qu’à terme, c’est le corps lui-même qui sera désertifié. Jusqu’où ?