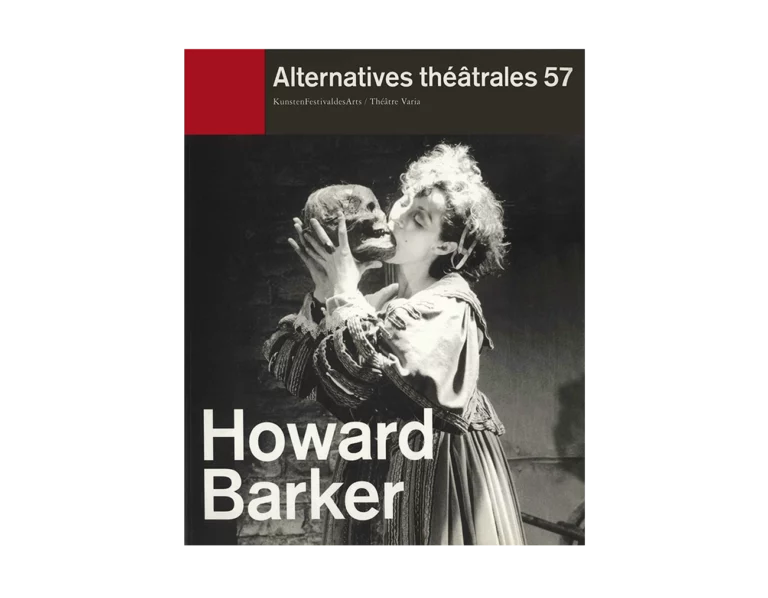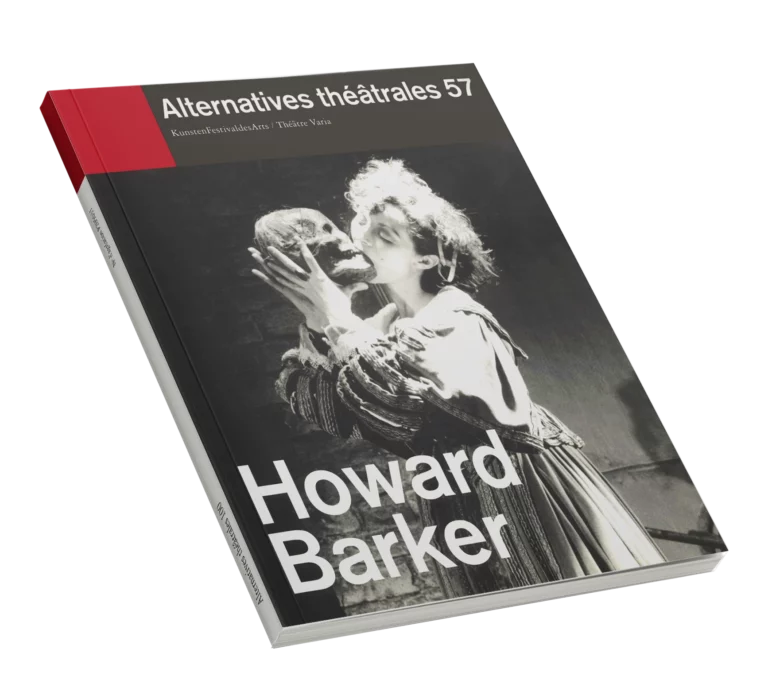L’AMBIGUÏTÉ DE CE TITRE est pertinent. Il est clair que la langue est le véhicule du théâtre de Barker mais, malgré cela on a l’impression que les personnages s’en servent. Elle possède en soi une force particulière et souvent résiste activement aux efforts que font les individus pour la contrôler. La langue séduit par ses propres moyens. Fréquemment l’utilisation de paroles persuasives pour séduire l’autre s’inverse pour séduire la personne qui parle. Par exemple dans JUDITH, la servante de l’héroïne éponyme commente la séduction d’Holopherne par sa maîtresse : « Comme elle est brillante ! Comme elle est ravissante ! Elle m’a convaincu ! Mais elle doit être prudente, car lorsqu’on ment, parfois, l’idée, même si elle est fausse, peut susciter une demande, et puis on est baisé ! » On rencontre souvent cette situation dans les pièces de Barker. Ici Judith, a recours à la parole dans un moment catastrophique ou potentiellement tel dans l’intention d’éviter le désastre. Holopherne raconte qu’il doit son savoir-faire linguistique à sa faible constitution physique : « J’éloignais les gens de mes intentions véritables, mes paroles devenaient dédale, j’utilisais le langage pour coincer mes ennemis, mes paroles étaient une trappe, je vivais dans la langue, la transformant en arme. » Holopherne dit avoir vécu dans la langue : au lieu de l’utiliser simplement comme un instrument, il la considère plutôt comme un terrain doté d’une identité autonome où l’on peut facilement se perdre, volontairement ou involontairement. Ainsi les paroles se font dédale.
Dans LES EUROPÉENS le personnage de Catherine lutte pour décrire le viol qu’elle a subi à un prêtre chargé d’enregistrer les atrocités commises par les Turcs lors du siège de Vienne en 1683 : « … puis l’un d’eux a soulevé ma jupe excusez-moi — (Elle boit.) Ou plusieurs d’entre eux, à partir de maintenant je parle d’eux au pluriel, à têtes multiples, de nombreuses jambes et une masse de bouches et bien sûr je ne portais pas de culotte, pour être précise — (Pause.) J’en possédais une mais pour des occasions spéciales. Ce qui se passait était certainement spécial mais quand je me suis levée le matin je n’en étais pas encore consciente, et je pensais à beaucoup de choses, mais je pensais d’abord — non, j’exagère, je prétends connaître l’ordre de mes pensées quelle prétention grotesque - rayez-moi ça, non, parmi la cascade d’impressions — c’est mieux — c’est juste — cascade d’impressions — l’idée me vint au moins je n’aurais pas besoin d ’embrasser.( Pause) Les lèvres étant saintes, les lèvres étant sacrées, l’orifice par lequel je prononçais mes pensées les plus parfaites et religieuses il n’y a que l’herbe qui les barbouillerait enfin non. (Pause.) Vous arrivez à suivre ? Parfois je trouve un courant et puis les mots courent — torrent — cascade — encore cascade, je viens d’utiliser ce mot ! J’aime ce mot maintenant que je l’ai découvert, je l’utiliserai, probablement ad nauseam, tombant en cascade ! Mais vous — (Pause.) Et puis ils m’ont retournée comme un quartier de boeuf, la façon dont un boucher flanque la carcasse, non pas sans une certaine familiarité, traitement rude mais avec une très vague notion de chaleur, oh, non, les mots dérivent, ce n’est pas du tout ce que j’ai voulu dire, la précision est tellement — la précision s’esquive même à portée de la main, échappe au contrôle et on m’a flanquée de l’autre côté et cette chose à bouches multiples — (Elle frissonne comme si elle avait une attaque, laissant échapper un cri effroyable, elle fait tomber l’eau par terre. La Bonne Soeur la soutient. Elle s’en remet.)» Cette tirade illustre l’une des caractéristiques les plus frappantes de l’écriture de Barker — sa capacité à produire des textes qui reflètent de manière sensible les fluctuations d’une conscience. Dans son discours on a l’impression que Catherine s’efforce de rester objective et ce, malgré les séductions trompeuses de la langue. Cependant il est clair que même lorsqu’elle semble y parvenir, la séduction a quand même lieu, et quand elle emploie le mot « cascade » c’est parce qu’il est connoté positivement, qu’il est relativement neutre, et pas seulement parce qu’elle le juge adéquat. Le mot qu’elle rejette torrent avec ses sous-entendus de violence, aurait été plus approprié.
Cascade et torrent s’accordent avec le mot courant que Catherine utilise également ici. Le mot courant est caractéristique du processus de la séduction qui génère sa propre énergie créative et son dynamisme, sans relation directe et souvent en contradiction avec les visées rationnelles et objectives. Lorsque Catherine dit les mots courent, outre sa signification littérale (les mots agissent selon leur propre impulsion), l’expression signifie aussi que l’on perd le contrôle des mots. Ce qui nous permet de relever un thème important de la pièce : la tentative d’appropriation par l’état de la souffrance personnelle de Catherine. À ces fins, l’état se sert de la raison et de l’objectivité, mais aussi de la syntaxe (les phrases ont des sujets, des compléments d’objet, des verbes actifs et passifs, etc.) L’expérience de Catherine — sa douleur — doit être transformée de façon telle que l’élément crucial de son individualité soit éliminé. La réplique citée plus haut intériorise le conflit entre la personne émotionnelle et l’appareil d’assimilation. Et l’on peut lire la pièce comme la succession des efforts que fait Catherine pour refuser cette intégration.
Elle raconte plus tard qu’elle est folle et il est certain que la structure de sa tirade est loin d’être rationnelle ; l’impulsion narrative est constamment déroutée, déviée et séduite. Afin de communiquer ceci, Barker provoque une rupture des modèles normaux de relations syntaxiques ; les phrases commencent avec force, puis s’arrêtent abruptement sans explication ; à d’autres moments elles continuent à couler, l’une dans l’autre, sans aucune ponctuation mais, surtout, les paroles se replient sur elles-mêmes pour se faire des remarques. On décèle alors plusieurs couches de conscience — la conscience du viol en soi, celle de la langue et celle de l’autre interlocuteur silencieux, il s’agit ici d’Orphuls. Ce dernier est invisible dans le noir (comme l’exigent les didascalies), et se fond ainsi dans le public pour devenir son complice. En tant que prêtre voué à la chasteté, Orphuls représente vraisemblablement aussi une sorte de défi pour Catherine, qui joue sans doute consciemment avec son désir sexuel refoulé.