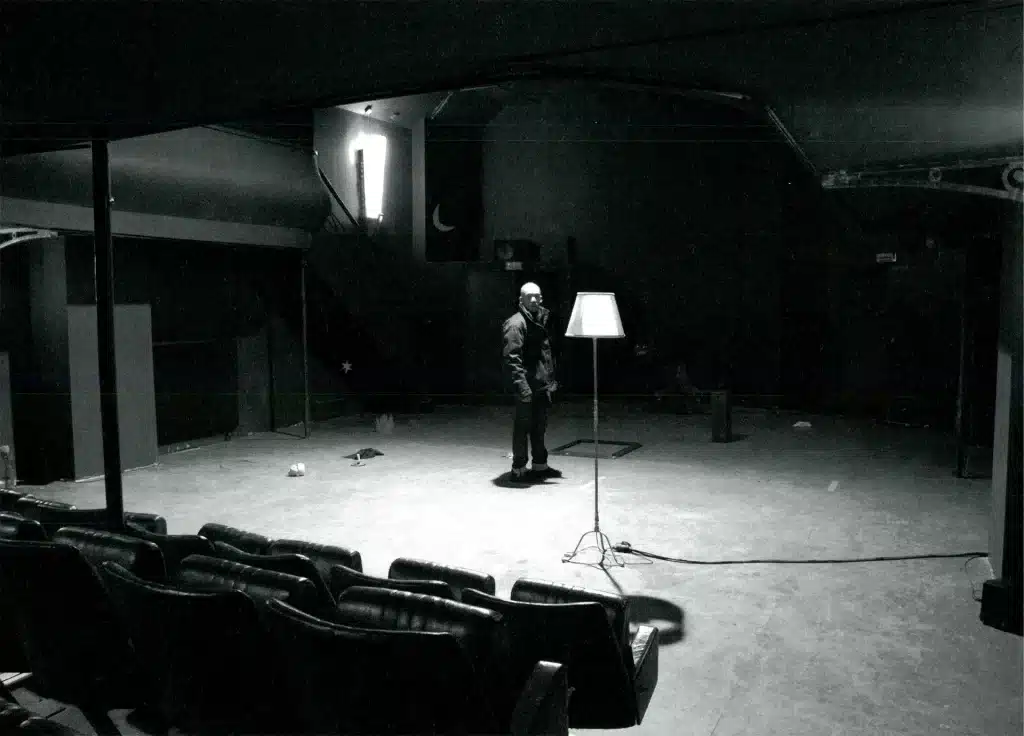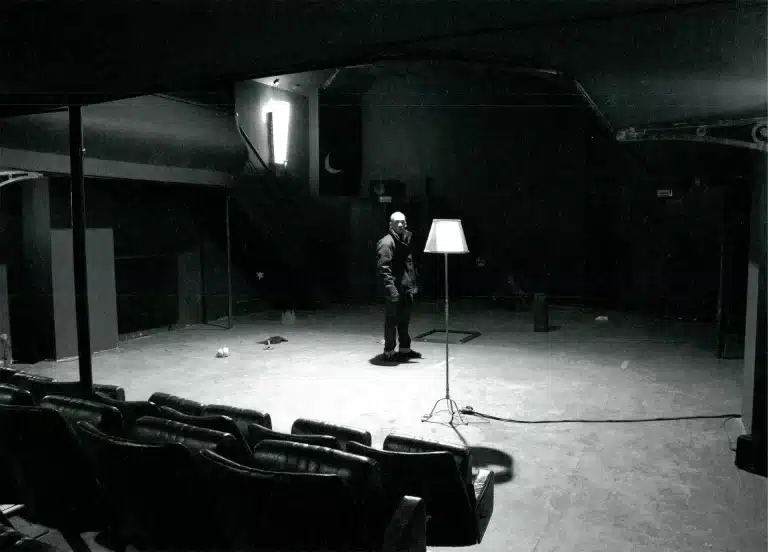Christophe Triau : La création, pour le Festival, de Partage de midi réunit, sans metteur en scène, des acteurs qui se connaissent bien, mais qui ont chacun des histoires théâtrales très singulières. Toi-même, par exemple, tu as un parcours personnel marqué par des collaborations fortes : avec Bruno Meyssat, avec Nordey à tes débuts, avec Régy, Jeanneteau… Il me semble que, dans ce travail commun, quelque chose de l’ordre de la transmission va forcément se jouer entre vous : non pas sur le mode d’un enseignement, bien sûr, mais simplement par le biais de l’échange, de la circulation entre vos personnalités et vos expériences d’acteurs. Sans doute, d’ailleurs, de telles expériences de transmission, en quelque sorte diffuse, sont-elles ainsi à l’œuvre entre les acteurs dans la plupart des projets. De quel ordre te semblent-t-elles être, et comment s’éprouvent-t-elles ?
Gaël Baron : Il y a des situations de transmission claires, parce que nommées, mais celles dont tu parles procèdent d’autre chose, et ne sont pas nommées comme telles. C’est une zone délicate, puisque on y est travaillé par quelque chose qui est à l’œuvre mais dont on ne se rend pas complètement compte. Dans ces situations-là, il n’y a pas d’un côté celui qui transmet et de l’autre ceux qui reçoivent, mais une transmission mutuelle, un échange qui met en jeu chacun au même titre. Quand on commence à travailler sur un spectacle, le plaisir de la rencontre avec des partenaires nouveaux se double parfois du plaisir à travailler avec des gens qu’on a vu jouer, qu’on aime, dont on aime l’« apparition » ; des gens à qui on a envie de « se frotter » — j’emploie exprès ce terme physique. Ce plaisir-là me semble important dans cette drôle d’autre transmission. Dans des traditions de théâtre plus anciennes, dans d’autres cultures, il existe une transmission qui se fait sans paroles, sans questions ni réponses mais par le regard, l’écoute et par l’imitation, en refaisant les gestes faits par quelqu’un d’autre. Dans ces traditions-là, il y a certes un maître. Mais j’ai l’impression que quand on commence un travail, quelque chose de cet ordre se joue dans ce désir de se frotter à des gens nouveaux, qu’il s’agisse de gens avec qui on n’a encore jamais travaillé mais qu’on aime, ou de gens avec qui on a déjà travaillé mais avec qui on sait que la nouvelle aventure sera différente de la précédente. Se joue alors ce que j’appellerais une transmission par contiguïté : une transmission sans paroles, sans démonstration, mais où il y a à inventer un échange de jeu ensemble. Cela met dans une situation de perception aiguë et de curiosité de l’autre, de son corps, de ce qui va surgir de lui : on est ému par l’autre, il apporte quelque chose qu’on ne s’attendait pas à ressentir, on est mis en mouvement par ça — et là on touche quelque chose de la transmission.
Quand je suis sorti du Conservatoire, Nelly Borgeaud (une grande actrice, qui a été très importante pour mon imaginaire de théâtre, pour mon apprentissage, et que j’ai eu la chance de rencontrer, grâce à Christian Rist) m’a dit, en substance (elle m’a comme offert cette phrase) : « maintenant que tu es sorti de l’école, tu vas commencer à apprendre ». Cela m’a complètement libéré d’une sorte d’autosatisfaction, libéré du poids d’avoir atteint un but, et cela a réouvert pour moi un espace. Il y a toujours quelque chose à apprendre dans un spectacle parce qu’il y a toujours un moment dans le début des répétitions où, quels que soient la satisfaction et le sentiment d’accomplissement que l’on a retiré du spectacle précédent, il faut leur dire adieu, un moment où on ne sait plus comment s’y prendre : c’est celui où on comprend à nouveau qu’on n’est pas tout seul à inventer le jeu, le théâtre qu’on va faire, mais que celui-ci va s’inventer dans et par le déplacement produit par l’autre, et que c’est là que va se poursuivre l’apprentissage.
Une telle transmission par contiguïté peut passer par beaucoup de petits détails, par exemple les anecdotes que les acteurs se racontent : des choses du théâtre, qu’on a vécues ou dont on a juste entendu parler. Cela se fait de manière très informelle, mais j’ai l’impression que, parfois, dans ces anecdotes aussi une vraie transmission est à l’œuvre. Elles font rire, peuvent devenir des sortes de légendes dont on ne sait plus si elles sont vraies ou fausses, mais elles rendent vivant notre imaginaire du théâtre, et inscrivent la création en cours dans une histoire infinie — cet imaginaire d’une histoire infinie me semble nécessaire pour avoir de la joie à créer. Après tout, même si ce n’est pas la même chose, dans d’autres traditions de transmission ou d’éveil spirituel, les petites histoires — zen, par exemple — permettent bien de susciter un état d’ouverture et de déplacement. Elles peuvent faire scintiller comme un point d’interrogation de l’existence, un point d’incongruité dont on a besoin comme d’un ferment pour créer.
C. T. : Cet apprentissage qui commence vraiment après la « formation initiale » à l’école, et qui passe par cet ébranlement produit par l’autre, comment se conjugue-t-il avec ce que tu as déjà acquis ? Comment s’y articulent la découverte de nouveaux outils et l’approfondissement de ta propre pratique (la technè et la praxis, d’une certaine manière) ? Le training verbal, que vous allez peut-être pratiquer avec Valérie Dréville, est par exemple une technique, mais j’imagine ce n’est pas en tant que tel qu’il va le plus te déplacer, qu’une transmission d’un autre ordre va se jouer à travers cette expérience.
G. B. : Les outils ne sont riches que s’ils sont réinterrogés — pour sortir d’une assurance qui peut en fait, paradoxalement, créer beaucoup d’inquiétude, une peur de tout ce qui pourrait lui contrevenir. Et c’est comme si cet espace de réinterrogation ne pouvait exister que par la présence des autres, dont le contact transforme ce que tu es, et ton rapport à ce que tu es. Par exemple, dans le dernier spectacle de Bruno Meyssat, Forces 1915 – 20081, il y avait un acteur, Arnaud Stéphan, qui sortait de l’école du TNB : il avait donc travaillé avec Stanislas Nordey, avait fait des exercices proposés et dirigés par lui, dont il lui arrivait de parler. Moi-même, j’ai longtemps travaillé, il y a plusieurs années, avec Stanislas, et la rencontre avec Arnaud a été l’occasion pour moi de revisiter ce travail. Cela faisait longtemps que je n’y avais pas pensé, et pourtant j’en suis « porteur », comme on le dirait d’un virus : le souvenir de cette expérience est comme en sommeil, mais il est vraiment dans mon corps. Déjà, le voir dans le corps d’un autre me le faisait apparaître, physiquement, autrement. C’était vraiment un drôle de moment que cet échange avec Arnaud, qui pouvait aussi passer, très ludiquement, par des imitations de Stanislas, qui reconvoquaient quelque chose de son corps, et par conséquent de son imaginaire, de ses enjeux de travail, de son rapport au corps en scène… S’amuser, tous les deux, à rejouer cette part-là de son théâtre (et la façon dont lui-même, pour transmettre, met en jeu son corps), faire revivre ainsi un point précis d’une certaine physicalité de théâtre, c’était une façon de poser un jalon de notre expérience, de remettre en jeu une transmission plus ou moins ancienne et de voir de quels outils on disposait, tout en permettant en même temps une différenciation, de saisir où nous en étions du tout autre travail que nous faisions alors avec Bruno.
Au théâtre, on acquiert sans doute une sorte de savoir-faire, mais qui n’arrête pas de bouger : le corps évolue, nos acquis ne sont pas fixés. Je suis par exemple curieux de voir comment le travail sur le training verbal va me changer. Et ce qui me plaît particulièrement dans cette expérience nouvelle, c’est qu’elle passe par Valérie, qui a une longue pratique avec Vassiliev mais qui, au lieu de la laisser dans le lieu du maître, la dissémine. J’aime bien que le training verbal ait ainsi une autre existence — même Valérie le redécouvre alors —, et devienne une pratique partagée mais sans propriétaire. Valérie voyage avec, sans nous y obliger, elle laisse faire la vie du groupe, et c’est justement parce qu’il n’y a pas d’obligation qu’on est dans une situation d’échange et de transmission, dans laquelle il y a forcément réinterrogation et réinvention de ce qui est transmis et partagé — par contiguïté.
C. T. : Sur quelle base peut le mieux se produire une telle transmission sans rapport pédagogique instauré : celle d’un groupe extrêmement soudé et uni, ou celle d’un ensemble laissant suffisamment de « jeu » pour que les singularités s’affirment ? N’y a‑t-il pas besoin à la fois de suffisamment de complicité et de suffisamment de différences pour que cet échange puisse avoir lieu ?
G. B. : Je me méfie des effets de groupe : quand il y a trop de signes de reconnaissance, il me semble que quelque chose de la transmission n’est plus vivant ; il n’y a plus que de la reproduction de ce qui nous fait nous reconnaître comme appartenant à ce groupe, et les différences ne sont plus en jeu. Dans le début des répétitions, il y a toujours un moment important où se produit comme un déclic qui permet de dépasser une réserve, une petite frontière de pudeur. Sans exhibitionnisme, on ose une émotion, un toucher, et c’est le moment où s’éprouve le minimum de confiance dont on a besoin : pas simplement le plaisir de se retrouver (et pas celui de faire groupe), mais la confiance, toujours fragile et mise à l’épreuve, qui permet de créer une chose commune avec ce que chacun va apporter, sans jouer tous pareil, et de continuer à oser être différents les uns des autres. Ce moment, on le réinvente à chaque fois, on ne sait jamais par où il va passer (le travail physique, par exemple, peut nous mettre dans une fragilité qui le favorise).
C. T. : As-tu l’impression d’être porteur, dans ta relation au plateau, de certains traits que tu aurais acquis, sans qu’ils te soient explicitement enseignés, dans certaines aventures théâtrales, ou au fil de certains compagnonnages — par exemple celui avec Bruno Meyssat —, et qui t’accompagnent sur les autres projets ?
G. B. : J’ai l’impression que je suis, par exemple, habité par une certaine manière de regarder des objets comme des corps, comme s’ils étaient dans un rapport vivant avec ceux des acteurs, et c’est un plaisir que j’ai pu creuser et partager avec Bruno. J’aime beaucoup le regarder créer des « sites », comme il dit : sa manière de déplacer des objets, brutale et délicate à la fois, pour voir comment l’espace se modifie avec les acteurs. Et je vois bien que je vis avec ça : ce n’est absolument pas passé par une « formation », mais par une transmission un peu comme on attrape le tic de quelqu’un, ou plutôt comme quand on regarde quelque chose qu’on aime chez quelqu’un et qui après vous constitue. Ceci dit, j’en parle ici, parce que tu me le demandes… mais en le disant, j’en fais comme un objet de formation, alors qu’en le vivant, je ne le formalise pas, cela reste de l’instinct, et dans l’espace de la transmission.
Parfois, dans un cadre strictement pédagogique, ce n’est pas l’objet de la formation qui est transmis, mais autre chose. Un jour, par exemple, où je travaillais, au Conservatoire, avec Madeleine Marion sur Tête d’Or avec Laurent Zisermann, elle nous arrête pour nous faire travailler sur l’intelligibilité du texte, elle s’approche de moi, me touche, me prend le bras comme si elle-même jouait Tête d’Or, et dans la pression de sa main sur mon bras, j’ai senti quelque chose du rapport physique au partenaire : ce n’était pas ce sur quoi elle était en train de me former, l’objet de son intervention, mais cela a été une transmission effective. J’ai aussi le souvenir de Pierre Vial, qui montait et descendait incessamment entre la salle et le plateau pour nous donner des indications ; d’une certaine manière, les indications de jeu qu’il nous donnait pour travailler une scène relevaient de la formation, mais la transmission se jouait dans le fait de le voir ainsi monter et descendre sans cesse, dans les suspensions que ce mouvement instaurait dans ses indications… Comme si dans la formation on pouvait dire les choses, mais que la transmission se faisait à son insu — pourtant elle existe, fortement ; elle vient nourrir un désir de théâtre, et vingt ans après on en parle, cela nous porte encore. Sur le moment, on le vit — comme une joie, en regardant de tous ses yeux —, mais ce n’est qu’après que cela commence à éclore, en y repensant, en le racontant à quelqu’un d’autre et en le transmettant ainsi à son tour.
C. T. : Ce n’est pas la leçon en tant que telle qui transforme : elle est un matériau qui n’agit qu’à partir du moment où il est à l’œuvre en toi, où il t’habite, et dont le résultat se constate avec le recul. Quels exemples pourrais-tu donner de faits de transmission, sans doute survenus « à ton insu », qui t’ont ainsi marqué ?
G. B. : C’est très difficile, pour moi, à discerner en dehors de l’espace de travail. C’est comme si la manière dont il met en jeu l’imaginaire, les désirs, les craintes… rendait l’espace où les transmissions travaillent extrêmement particulier — comme, d’une autre manière, sont très spéciaux l’espace de l’amour physique, ou l’espace psychanalytique… Ce qui me vient en tête, ce sont surtout des souvenirs de gestes, ou de disponibilité : Anne Alvaro, par exemple, en éveil, disponible toujours, même dans la fatigue qui était la sienne alors qu’on répétait La Tour avec Gérard Watkins… cela m’a « impressionné », comme on dit.*
C. T. : C’était de l’ordre de l’admiration, et cela te proposait un modèle vers lequel tendre ?
- FORCES 1915 – 2008, spectacle constirué de la mise en scène de FORCES, d’August Scramm, et d’une composition de Bruno Meyssac, LA CIME DES ARBRES. ↩︎
- Merci à Nicolas Bouchaud de nous avoir fait découvrir en répétitions la conférence radiophonique de décembre 1966, où Foucault évoque cerce notion d’ « hétérotopie » (note de G. B.). ↩︎