Bernard Debroux : Comment est née l’idée de réaliser cette mise en scène au théâtre de Ordet / La Parole ? C’est, je crois, un projet ancien ?
Arthur Nauzyciel : C’est un projet ressuscité. Tout ce qui a été vécu du processus de ce projet est très proche du sujet même ! L’idée même d’Ordet était née pendant que je préparais mon premier spectacle, Le Malade imaginaire ou le silence de Molière, qui réunissait un texte contemporain de Giovanni Macchia sur la fille de Molière et Le Malade imaginaire. C’était un spectacle que j’ai tenu à représenter à Orléans depuis ma nomination comme directeur du Centre Dramatique. Dans cette première saison qui était une saison de transmission entre ce qu’Olivier Py avait construit et ce que j’allais y amener, je n’avais pas envie de présenter tout de suite la création — Ordet —, je me suis dit que ce serait plus intéressant de présenter mes deux premiers spectacles : Le Malade imaginaire ou le silence de Molière et Black Battles with Dogs. C’était une façon de me présenter au public, de présenter mon travail et de l’inscrire dans une histoire. Les centres dramatiques ne sont pas des catalogues, des lieux de consommation de spectacles, ce sont des lieux où on essaye de donner du sens, de la cohérence, en faisant en sorte que des spectacles qui sont d’une certaine exigence et d’une certaine nature soient reliés les uns aux autres pour que le public suive un parcours à travers une saison. C’est donc délibérément que j’ai présenté Le Malade qui est justement aussi un spectacle sur le théâtre, sur la famille, sur la transmission, sur les pères et les fils, qui est un spectacle sur la mémoire, sur l’abandon de la mort. Il abordait la plupart des thèmes que j’ai déclinés par la suite.
Dans la mort de Molière jouant Le Malade, il y a quelque chose de la résurrection de l’artiste. Il y a quelque chose de lui qui meurt et, en même temps, il n’a jamais été plus vivant qu’après cet acte-là. Et j’avais alors dans la tête l’idée d’une trilogie sur la résurrection, mais où la résurrection est envisagée comme utopie théâtrale, comme un acte de réconciliation. La résurrection de l’artiste à travers Le Malade imaginaire ou le silence de Molière, celle d’une femme à travers Ordet et celle d’une langue quasi disparue à travers un spectacle que j’avais envie de faire en yiddish. Se projeter dans une trilogie est une façon de voir plus loin que ce qu’on fait. Trouver une énergie, une perspective qui va bien au-delà du spectacle qu’on fait et ainsi lui donne du sens. Je n’arrive pas à envisager un spectacle comme étant une fin en soi. Soit c’est la partie d’un ensemble, soit c’est le prétexte à d’autres choses : des rencontres, des expériences de vie, avec le désir secret que ce qu’on fait puisse aussi servir à d’autres.
Après Le Malade, je ne savais pas si j’allais continuer dans la mise en scène et comment… Ce qui me fait avancer, c’est de réinventer à chaque fois un processus de création. Je cherche l’adéquation entre ce processus et le projet, comme s’il en devenait le sujet même. Ordet / La Parole, à ce moment-là, était impensable. Je ne me voyais pas engager ce travail très lourd dans le cadre d’une production traditionnelle, comme je venais de le faire pour Le Malade. Alors est arrivée la proposition d’Atlanta de monter un Koltès, et je suis parti aux États-Unis mettre en scène Black Battles with Dogs / Combat de nègres et de chiens, et pour moi, cela a représenté le départ d’autre chose.
Donc, on pourrait dire que le projet Ordet a été enterré et qu’il est ressuscité par la volonté du Festival d’Avignon quand, en 2005, Vincent Baudriller et Hortense Archambault m’ont proposé de réfléchir à un projet pour la Cour d’honneur. C’était quelques semaines avant le festival 2005 qui a été si controversé. Je leur ai alors fait trois propositions : Falsh de René Kalisky, Othello et Ordet / La Parole. C’est ce texte qu’ils ont choisi et c’était important qu’ils le choisissent autant que moi. Dans le contexte de ce festival, je trouvais intéressant d’y créer un spectacle qui s’appelle « la parole » et pose, entre autres questions, celle de la foi. Comment la foi des papes, la foi religieuse, aurait été remplacée, depuis Vilar, par la foi des acteurs, celle de l’art, celle du théâtre, du collectif. C’était aussi l’occasion d’aborder l’un des sujets les plus brûlants aujourd’hui, dont on peut le moins facilement parler. Avant de créer Ordet, et pour se donner le temps, nous avons décidé de présenter au Festival Black Battles with Dogs, en 2006.
Entre-temps, j’ai eu le sentiment que la Cour n’était pas le juste lieu, parce que dans ce texte, dans l’histoire de ces gens, il y a une dimension profondément humaine et que je voulais que les questions posées dans Ordet s’inscrivent entre les personnes sur le plateau et celles qui sont dans la salle. Je trouve que la Cour a une trop grande verticalité. L’ensemble des personnages semble soumis au divin, alors que le rapport à Dieu de chacun est direct et de l’ordre de l’intime. Les Carmes, ancien espace de spiritualité mais à échelle humaine, me semble être un lieu plus équilibré pour traiter du religieux et du profane.
B. D.: C’est par le film de Dreyer que vous avez eu connaissance d’Ordet ?
A. N.: Oui, c’est un film que j’ai regardé perplexe et fasciné et qui m’a bouleversé dans ces dernières minutes. C’est ce qui m’intéresse dans l’art en général et que j’essaie de retrouver quand je fais du théâtre : utiliser au mieux les outils du théâtre pour que le spectateur puisse être ému par quelque chose qu’il ne comprend pas et qu’il ne puisse pas nécessairement mettre de nom sur cette émotion, qu’il ne sache pas très bien d’où elle vient et comment elle est arrivée. C’est Isabelle Nanty qui m’a dit que c’était une pièce et me l’a fait découvrir.
B. D.: Elle n’avait jamais été jouée en français.
A. N.: Non, elle n’avait jamais été jouée en France mais jouée très souvent au Danemark où elle est aujourd’hui un classique. L’auteur, Kaj Harald Leininger Munk, est très connu au Danemark, c’est un héros national. Il est très lié à l’histoire de son pays. C’est un auteur très paradoxal, qui tout le temps cherche à affirmer une chose et son contraire. Il était habité par le doute, l’ambivalence. Hostile à la logique, impulsif. Pour lui l’existence, c’était l’association des contraires. Il y a un point commun entre Dreyer et Munk, ils ont tous deux perdu leur mère très jeune, à sept ou huit ans. Élevés dans la religion, avec l’idée de la résurrection, ils racontent tous deux comment ils sont allés très sereinement au cimetière en pensant qu’au moment de l’enterrement, les mamans allaient réapparaître… Pour des enfants, ce sont des choses extrêmement marquantes. Ce qui me touche évidemment c’est que Munk puis Dreyer ont consacré une part de leur vie à tenter de réparer ce que le réel n’a pas permis, en écrivant puis en filmant cette résurrection miraculeuse. Munk est devenu pasteur, mais a été confronté enfant à l’absence du miracle qui lui avait pourtant été maintes fois raconté. Alors il a écrit des pièces de théâtre, de la poésie. Auteur très joué de son vivant, il était en même temps un pasteur très rigoriste. Ce qui en a fait un personnage trouble, c’est aussi son adhésion au début des années trente, aux thèses nationalistes, s’enflammant pour les « hommes forts » Mussolini et Hitler, et sur lesquelles il est revenu, dès qu’il a entendu parler des déportations des juifs. Il a créé un des premiers réseaux de résistance danois et a été abattu par les Allemands alors qu’il allait de village en village lire un de ses textes sur l’antisémitisme. On trouve dans la vie de Munk ce paradoxe qu’il y a dans la pièce où l’on ne sait jamais que ou qui croire, et où la question du doute est aussi présente que celle de la croyance.
B. D.: Est-ce la pièce telle quelle qui est représentée ? N’est-elle pas un peu datée dans la forme ?
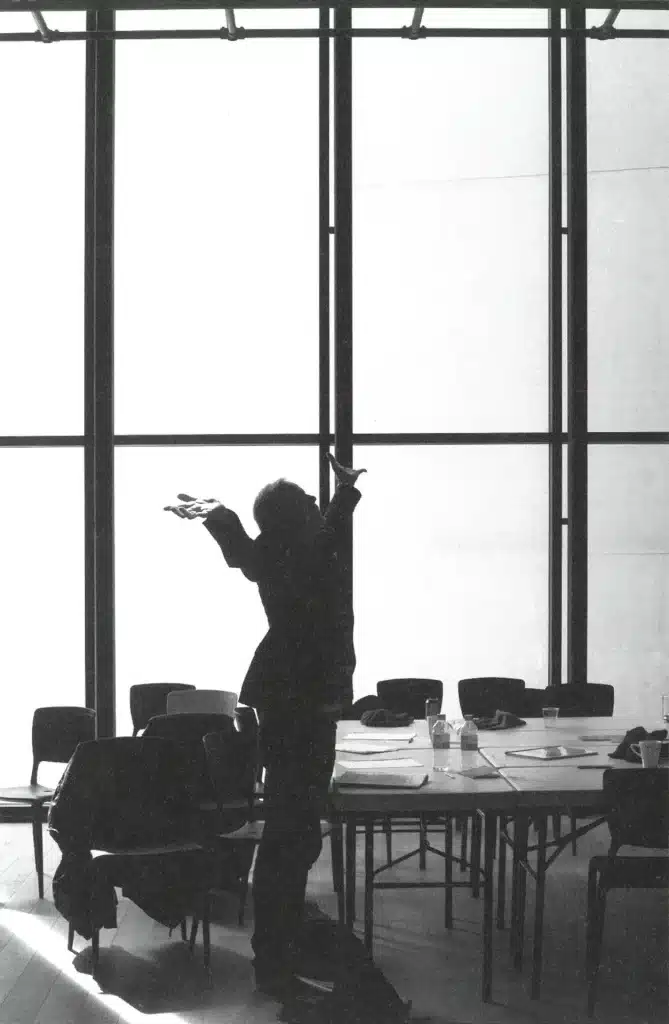
A. N.: Tout le travail sur la langue, la distribution, le décor, les costumes, la présence des chanteurs de l’ensemble Organum, tous ces éléments sont réunis parce que j’espère faire un théâtre pour aujourd’hui. C’est une pièce intéressante, faussement classique dans sa forme. Elle est écrite par quelqu’un qui aime le théâtre, qui a une connaissance du théâtre. Sa structure classique se justifie par rapport au propos. Le miracle est quelque chose d’irrationnel qui intervient dans un monde rationnel, identifiable. C’est en cela qu’il y a un miracle. Cela ne devrait pas arriver et ça arrive. Si la pièce était volontairement étrange, ou formellement trop éclatée, le miracle n’y trouverait pas sa place. La force de la pièce, c’est de ne pas être un débat théologique, mais de solliciter chez le spectateur sa capacité à croire dans l’histoire qu’on lui raconte. Ainsi la question de la croyance va bien au-delà de la question de Dieu. On s’en aperçoit en travaillant jour après jour sur le texte, la pièce est habitée, comme hantée. La rigueur protestante des pays du nord est originellement nourrie d’un paganisme et d’un rapport à la nature très particulier, où le visible et l’invisible participent d’une même réalité. C’est fondamental pour comprendre cette pièce, dont la force est aussi dans l’atmosphère. C’est la première fois que je me confronte à une pièce aussi classique dans sa langue, c’est un challenge après avoir travaillé sur des pièces où l’écriture avait une dimension plus formelle, peu dialoguée finalement, que ce soit Bernhardt ou Koltès, ou même Shakespeare et Molière. Dans Ordet / La Parole, on n’a pas ça. La langue est très simple. Je ne crois pas que ce soit une pièce datée. Elle a une forme d’universalité. La question religieuse ou le rapport que peut avoir l’être humain à l’invention de Dieu, ou à la question de l’existence de Dieu, est liée à l’absence de réponses à des questions existentielles : la mort et l’absence de connaissance qu’on a du monde des morts.
B. D.: Dans la conversation que nous avions eue ensemble, il y a deux ans, vous évoquiez l’idée que le théâtre est un lieu où les vivants convoquaient les morts.
A. N.: Je viens de monter Jules César à Boston, un spectacle très important pour moi parce qu’il y avait une cristallisation d’énormément de choses. Et je me suis retrouvé à recentrer le travail une nouvelle fois sur ce rapport des morts et des vivants. Je m’intéresse probablement à des textes qui me sollicitent là-dessus. Pourquoi ai-je ce rapport au théâtre comme un lieu hanté ? Je me disais que je n’aimais pas traiter le personnage parce que c’est une convention qui nous empêche d’être libre, qui réduit l’écriture, et entretient les acteurs dans ce qu’ils ont de moins intéressant. Si le personnage ne m’intéresse pas, c’est parce qu’en plus, il n’a pas la dimension du fantôme que l’on peut prêter aux êtres qui apparaissent sur le plateau. Le théâtre m’intéresse quand il enveloppe la salle et la scène, que c’est un espace partagé entre les acteurs et les spectateurs et qu’on ne sache plus très bien au bout d’un moment de quel côté sont les morts et les vivants.
B. D.: Ici, cette dimension va être complètement exacerbée avec le miracle.
A. N.: Ce qui est troublant, c’est que ce miracle arrive à la fin, qu’il est expédié en trois répliques, et ce n’est vraiment pas un coup de théâtre. Il n’est pas spectaculaire. Il est émouvant parce qu’en se réalisant, il s’avoue également comme un moment de théâtre, c’est-à-dire quelque chose qui appartient au monde de la fiction et donc nous renvoie à notre réalité. C’est un peu mélancolique. Et ça se termine par : « Pour nous la vie ne fait que commencer ». Mais avant alors, c’était quoi, si la vie commence à la fin ? Pourtant, la résurrection devrait être la fin des temps… Il y a là un paradoxe. Le théâtre est troublant dans son rapport entre le réel et l’illusion. Le miracle qui arrive à la fin, c’est un vrai miracle mais comme on est au théâtre c’est en même temps le simulacre du miracle.
B. D.: Au théâtre, les morts se relèvent toujours à la fin de la pièce.
A. N.: À partir du moment où, au théâtre, les morts se relèvent toujours, c’est comme si la mort ne pouvait être qu’une cérémonie, et la représentation, une façon de conjurer la mort, une célébration du vivant. Je me suis aperçu que dans Le Malade, Place des héros, Roberto Zucco, Jules César ou Black Battles, il y a l’idée d’une fête des morts quelque part, et le spectacle (ou ce qui se passe sur le plateau) n’est que la partie visible pour les spectateurs. Des fantômes hantent le théâtre et se rejouent à travers le texte, dans l’expérience de la représentation, une mémoire collective de l’humanité. Mon rapport au théâtre s’ancre là. Munk s’est toujours vécu comme déjà mort, enterré auprès de sa mère, allant parfois jusqu’à douter de sa propre existence. On sent là comment Ordet / La Parole aborde dans le fond la question de l’existence, mais du point de vue du rêve, ou du souvenir. Peut-être que le monde est un monde peuplé par les morts et habité par les vivants…
B. D.: La mort n’est-elle pas aussi une forme de réconciliation ?


