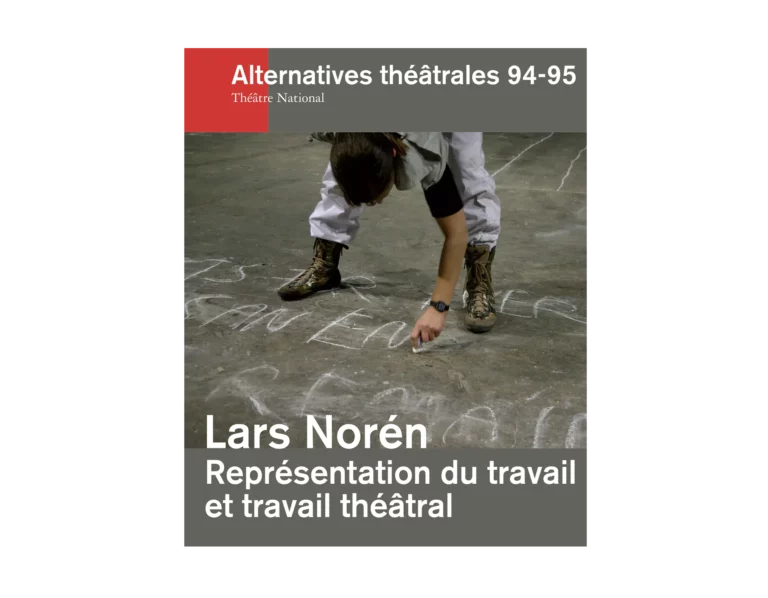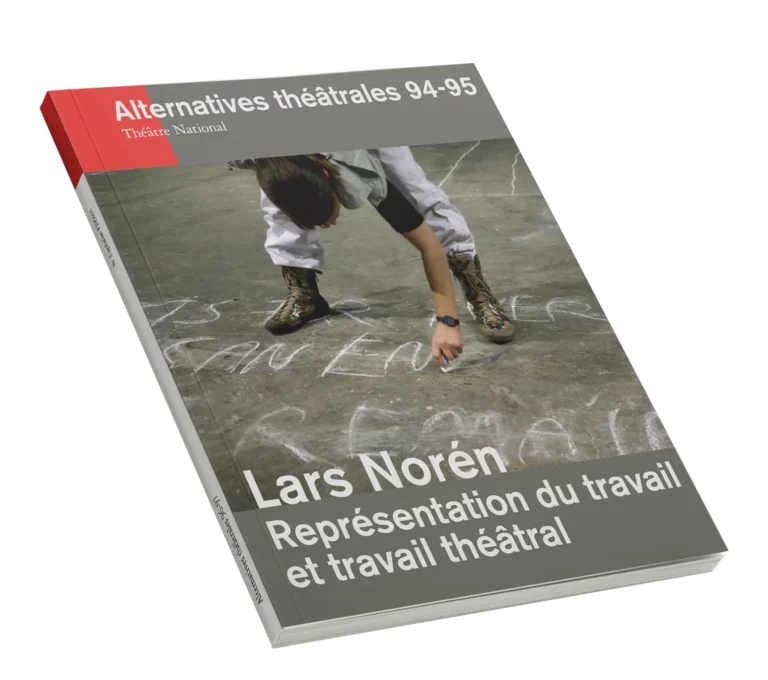Comment Lars Norén est-il en tant que metteur en scène ? On pourrait répondre facilement à cette question en affirmant : simple. Pour lui, la mise en scène est simple, claire, pure : la rencontre entre le texte et l’acteur joue le rôle principal.
Mais, bien entendu, rien n’est aussi simple en ce monde. Encore moins au théâtre. L’activité littéraire de Lars Norén est aujourd’hui considérable. Il est extrêmement productif, écrit deux ou trois pièces par an et en met en scène à peu près autant. Il s’est lancé dans la mise en scène au début des années 90 après avoir travaillé auparavant uniquement en tant qu’auteur dramatique. Un auteur dramatique de plus en plus présent aux répétitions de ses nouvelles pièces au cours des années 80. Il écrivait de plus en plus souvent pour les acteurs au moment où la pièce prenait forme. En contact étroit avec les acteurs, il ajoutait des répliques ou en retirait pendant les répétitions. Ces pièces, que l’on appelle parfois « les pièces d été » au ton plus léger, telle LE TEMPS EST NOTRE DEMEURE, ont été écrites au moment où Lars Norén était le dramaturge du Dramaten1, la scène nationale suédoise.
Cette période peut être considérée comme un préambule aux années 90, comme une nouvelle phase dans son métier d’écrivain. Lors des premières années de la décennie, il a écrit les PIÈCES MORTES, une série de treize pièces aux accents nettement plus sombres, dont quelques-unes font partie de celles qui sont le plus jouées à l’étranger telles que ROUMAINS ou CRISES. La pièce qui clôt cette série était UN GENRE DE HADÈS (1994) que Lars Norén a lui-même mise en scène pour la télévision suédoise deux ans plus tard. Le théâtre à la télévision était une forme de théâtre très ambitieuse en Suède dans les années 90. Portée par les idéaux les plus nobles — mais peut-être aussi de plus en plus passés de mode — elle voulait rendre le meilleur de l’art accessible à tous, y compris à ceux qui habitent dans les coins les plus reculés.
Langue imagée et décousue
UN GENRE DE HADÈS fut réalisé en collaboration avec les réalisateurs de la télévision, certains d’entre eux ayant déjà filmé de la danse. La pièce se passe dans un hôpital psychiatrique et grâce à la caméra, les gros plans et les plans larges s’enchaînent rapidement et facilement, passant harmonieusement de la salle d’activités à la salle de réception où la plupart des scènes sont tournées. Jusqu’alors, les pièces de Lars Norén, à quelques exceptions près, avaient été montées dans un style de jeu psychologiquement réaliste et dans une scénographie qui, tout en ne représentant pas tout à fait la réalité, se voulait néanmoins vraisemblable. En Suède, la référence en matière de théâtre était évidemment Strindberg et un jeu réaliste. L’art dramatique de Strindberg et le style de jeu qu’il a lui-même élaboré, commenté et enseigné à ses acteurs sont encore bien présents sur la scène suédoise. Ingmar Bergman, en tant que metteur en scène de théâtre, est un très bon exemple de cette tradition et Lars Norén s’y inscrit également de bien des façons.
Dans UN GENRE DE HADÈS, Norén a cependant essayé de ne pas être fidèle à sa propre tradition. Le langage imagé était décousu, libre, la composition des images s’apparentant à de la peinture. D’une part des portraits minutieux, intimes, d’autre part de beaux et radieux portraits de groupe empreints de calme, quelques séquences mouvementées, presque emblématiques, comme celle où la jeune et maniaque Julia se précipite dans le couloir de l’hôpital en perdant sa serviette contenant tous ses livres. Sa raison d’être, sa vie, se désagrègent dans les airs pour retomber au sol dans un mouvement de ralenti.
Il a réussi à construire un rythme calme, à nous raconter son histoire par une succession d’images paisibles. Tout à coup, au lieu de ce flot d’images incessant qui inonde le petit écran, surgit quelque chose d’autre. Le temps, comme figé, va tranquillement à la rencontre du spectateur. Laissant lentement, nettement, inexorablement, apparaître de façon tout à fait compréhensible l’homme moderne dans son intégralité.
Parallèlement à la mise en scène pour la télévision d’UN GENRE DE HADÈS, Lars Norén avait mis en scène LA DANSE DE MORT d’August Strindberg au Dramaten et QUI A PEUR DE VIRGINIA WOLF ? d’Edward Albee dans un théâtre privé de Stockholm. Les deux mises en scène furent représentées dans la tradition du réalisme psychologique mais poussée à son paroxysme dramatique. On peut tracer dans ces deux pièces des parallèles évidents dans la description de couples malheureux et amers. On pourrait considérer ces travaux de mise en scène de Strindberg et Albee comme une sorte d’atelier de travail pour un auteur. C’est devenu frappant lorsque plus tard Lars Norén s’est frotté à d’autres pièces d’auteurs dramatiques ; il les a mises en scène comme s’il les avait écrites lui-même. Lorsqu’en 2001 il met en scène LA MOUETTE pour le Riksteatern2 suédois, il y a déjà plusieurs années que ses propres pièces se passaient dans des lieux déconstruits et sans nom. LA MOUETTE devient alors une étude lumineuse et légère d’un jeune écrivain, une sorte d’autoportrait de Norén lui-même. En 2007, lorsqu’il monte HAMLET dans ce beau théâtre en extérieur dans les ruines d’un monastère sur l’île de Gotland, il revient à la problématique familiale de ses premières pièces et laisse presque de côté la réalité politique et militaire qui entoure la famille royale au château d’Elseneur dans le drame de Shakespeare.
Fragmentaire, lyrique
La réflexion scénique d’UN GENRE DE HADÈS se voit développée dans CATÉGOIE 3.1, la pièce qui a sans doute été la plus unanimement acclamée comme la grande messe de notre époque, un chant funèbre et en même temps un poème dramatique plein d’espoir à propos de l’homme occidental issu de la société postindustrielle de consommation intensive. Le texte des deux pièces a un caractère fragmentaire marqué, composé de longs monologues isolés et doté d’un puissant éclat dramatique. CATÉGOIE 3.1 a été mis en scène par Lars Norén lui-même en collaboration avec le Dramaten et le Riksteatern et représenté en une version écourtée qui durait quatre heures environ. L’espace scénique était constitué d’une énorme boîte rectangulaire peinte en blanc. Le public était assis sur un côté long et un côté court, enfermé dans cette boîte. Les acteurs s’asseyaient de temps à autre sur les gradins, au milieu du public, entre leurs répliques ou monologues. Le sol de cette boîte blanche, la scène même, était un lieu non identifié, peut-être extérieur, peut-être intérieur.On sait que l’une des plus grandes places de Stockholm a servi d’exemple à cet espace mais Norén a tenté ici de représenter un espace qui n’en est pas un, un type d’espace auquel il reviendra souvent. Plusieurs des acteurs qui jouaient dans UN GENRE DE HADÈS ont également participé à CATÉGORIE 3.1, certains d’entre eux ont ensuite suivi Norén pour une longue série de productions. Le texte était composé des monologues isolés qui étaient joués souvent simultanément par les acteurs et s’entremêlaient ainsi en dialogues. La mise en scène était empreinte de réalisme et donnait le sentiment très vif d’avoir en face de soi une série de destins individuels.
Lorsque la pièce fut mise en scène par Jean-Louis Martinelli au TNS / Strasbourg (puis présenté ensuite au Théâtre des Amandiers à Paris), la scénographie était plus définie. Elle donnait au spectateur des indices, lui proposant de s’imaginer l’endroit dans lequel se joue la pièce. Un centre commercial, ensuite une morgue. La scène était composée de petits espaces avec des différences de niveau et donnait la sensation d’un équilibre et d’un rapport plus manifeste entre les acteurs. Pour sa mise en scène, Martinelli n’avait pas autant réduit la pièce que Norén, elle durait six bonnes heures. Cette durée permettait de construire plusieurs scènes individuelles et petites histoires qui s’inscrivaient dans le flot général de la pièce, comme la scène de la femme dans la cabine d’essayage ou celle d’un tournage de film porno. Une mise en scène au style un peu plus réaliste donc que celle de Norén, qui préfère gommer les lieux et les personnages, déconnecter plutôt que connecter.