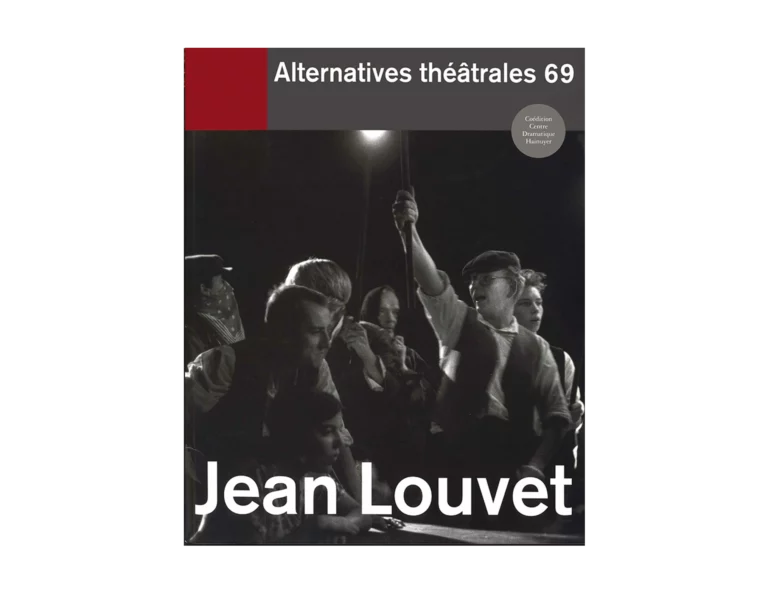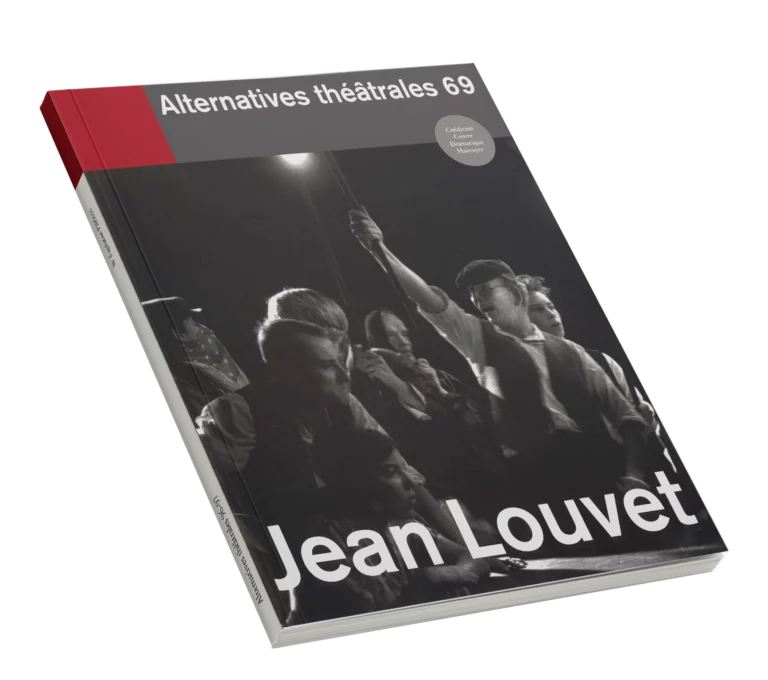J’AI DÉCOUVERT l’œuvre de Louvet en même temps que celles de Kalisky, Sigrid, et Hugo Claus, au cours de mes premières recherches sur le théâtre contemporain belge pendant mon séjour de boursier à Bruxelles en 1981. J’avais appris à aimer Ghelderode et Maeterlinck auparavant de l’autre côté de l’océan, à New York City. Il peut sembler bizarre de jumeler de tels apolitiques — voire, pour certains, réactionnaires — comme Ghelderode et Maeterlinck avec Louvet, mais cela expose de manière claire mon système : juxtaposer des écrivains de tous bords pour voir ce qu’ils partagent, tout en découvrant leurs différences.
Le théâtre de Louvet correspondait à merveille à mes goûts et à mes expériences. Quand je parle du théâtre de Louvet, je parle surtout de L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE. Ce style particulier se retrouve ici et là dans son œuvre : dans la première scène de CONVERSATION EN WALLONIE surtout — laquelle possède toutes les savoureuses qualités de l’opéra, mais dont l’intérêt grandit justement parce que ce n’est pas un opéra — un tout petit peu dans À BIENTÔT MONSIEUR LANG et plus rarement dans d’autres pièces. Le style de Louvet est identifiable par des thèmes profondément politiques, une approche gauchiste et en même temps, intensément poétique, abstraite, lyrique, le tout versé dans un mixeur de mémoire proustienne.
On se souvient que la première scène de CONVERSATION EN WALLONIE se déroule à l’extérieur d’un château, où les gens du village se rassemblent chaque nuit pour écouter la voix exquise du jeune chanteur prodige qui flotte jusqu’à leurs oreilles. Ce garçon est le fils d’un ouvrier wallon, mais le château appartient à l’aristocrate local. Voilà une image en trois dimensions du théâtre belge : on est socialiste, mais on aime également l’esthétique des châteaux. Le tout est imprégné d’un nuage de nostalgie et du regret d’une politique dorénavant impraticable, mais rendue toute dorée par la mémoire.
D’où vient mon goût pour ce monde théâtral propre à Louvet ? Les châteaux, c’est compréhensible. Depuis toujours, j’adore le monde magique du Moyen Âge que l’on retrouve dans un musée de New York appelé « The Cloisters ». Un musée constitué de cloîtres européens reconstruits chez nous. C’est Bruges à New York ! J’ai été élevé ici, à New York, par un père ayant grandi dans l’admiration pour le communisme russe, et qui, jusqu’à la fin de ses jours était un stalinien (et puis kroutchévien et brejnévien) convaincu. Même si on admet que le socialisme new-yorkais « de fauteuil » (dont a tellement rigolé Trotsky quand il nous a rendu visite) était dépourvu de la pratique révolutionnaire telle qu’elle a été vécue partout en Europe, mon père en a pourtant connu certaines aventures. Ainsi, bien avant ma naissance, fournissait-il aux « Abraham Lincoln Brigade » des provisions de médicaments avant que les brigadistes ne partent participer (et la plupart d’entre eux, mourir) à la guerre civile d’Espagne. Suite à notre ère McCarthy, mon père a dû céder sa pension de guerre (de la deuxième guerre mondiale). Pour recevoir une telle pension à l’époque, il fallait jurer qu’on n’avait jamais appartenu au Parti Communiste, ce qui aurait été faux et aurait risqué de lui valoir une période de prison. J’ai donc vécu dans un foyer qui a accepté certains sacrifices pour des idéaux de gauche. De plus, nous vivions dans une paranoïa constante à propos de la C.I.A. censée surveiller nos allées et venues et dans l’amertume à l’égard de presque toutes les institutions d’état.
Dans tous les ménages où les enfants étaient élevés par des parents communistes, ces sentiments allaient de pair avec une horreur des possessions, une attitude puritaine envers la chair et tous les plaisirs, et une détestation viscérale de toute cérémonie qui flattait l’état américain ou la religion. Pour un enfant, il en résultait une vision morne, grise, et dépouillée d’aspects positifs. Tout était contre et rien n’était pour, excepté l’Union Soviétique, une entité bien vague mais décidément laide à mes yeux. Moi, j’aurais préféré quelques bonnes cérémonies ! Voilà sans doute une raison de mon amour du théâtre.
Enfant des années 60, j’ai creusé mon propre chemin « progressiste » dans les manifestations des « Civil Rights » et contre les guerres du Vietnam et du Cambodge. Étudiant à l’université, j’ai failli jurer fidélité à un groupe révolutionnaire, mais je me suis finalement décidé pour le théâtre. Ce dernier, à mon avis, exigeant un engagement aussi total. En même temps, j’ai rejeté la politique pro-soviétique de mes parents, après avoir pris en grippe leur nostalgie d’un engagement qui me paraissait si moche et si gris.
Peu à peu, notre génération a glissé vers une position moins axée sur la politique. Quand j’ai lu la chronique de Julien Lahaut qui s’incarne dans L’HOMME QUI AVAIT LE SOLEIL DANS SA POCHE, j’étais convaincu, emballé même. Cette histoire de courage m’a paru réellement poignante ! Ensuite, obnubilé, j’ai entrepris des recherches sur la Question Royale (une fascination peut-être transposée de nos propres histoires américaines) et sur Lahaut. La forme de la pièce surtout m’enthousiasmait. Il ne s’agissait ni d’art documentaire, ni de réalisme stalinien, mais cette forme présentée par Louvet aurait été appréciée par Maeterlinck (et Meyerhold et Maïakovski). Un nuage bleu de nostalgie et de mémoire entoure toute la polémique, pour ne pas parler de dialectique. L’histoire de Julien Lahaut est éparpillée dans l’action, évoquée parfois par sa présence électrifiante, mais surtout dans le parler des Wallons ordinaires, des gens attirants et aimables.… et noyés dans l’actualité. Des gens qui ont perdu le fil de leurs repères et de leurs convictions.
Même si cela n’avait plus rien à voir avec le monde dans lequel ils vivaient, cet univers, sans que je le sache, a trouvé un écho dans l’expérience de mes parents qui se sont noyés dans leur fidélité caduque, sans avoir jamais retrouvé une nouvelle conviction aussi satisfaisante. Ils ont donc préféré rester dans un monde antérieur, un choix qui les a rendus risibles et pathétiques. Cela est aussi vrai pour les personnages de la pièce de Louvet, mais ces derniers sont plus sympathiques à mes yeux — leur comportement plus compréhensible.