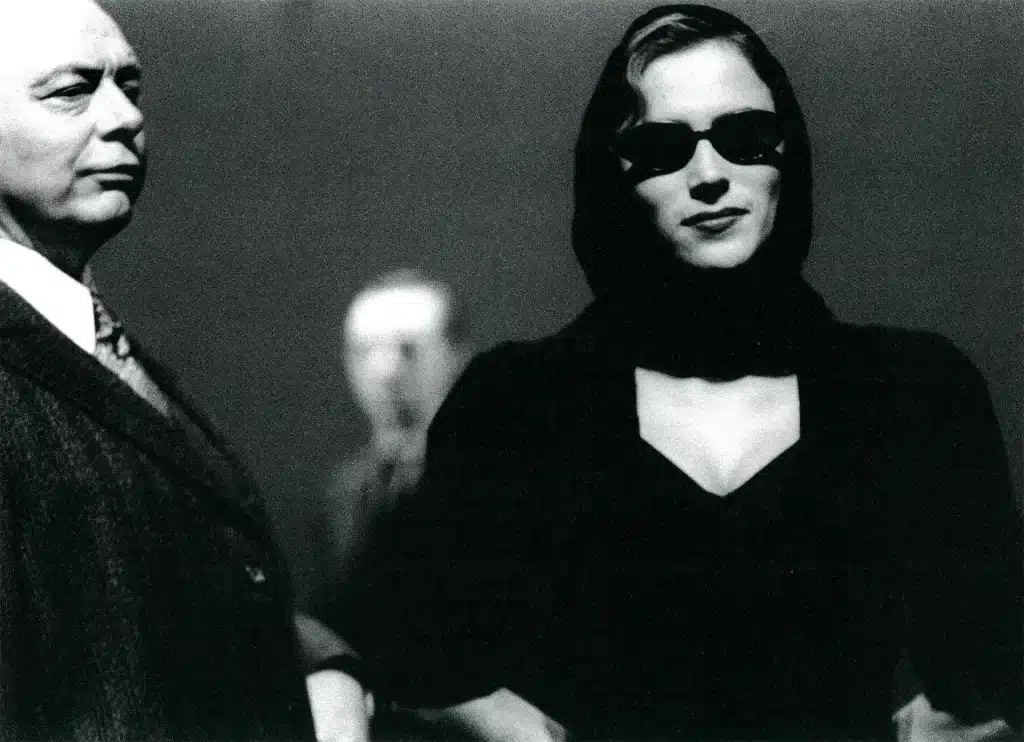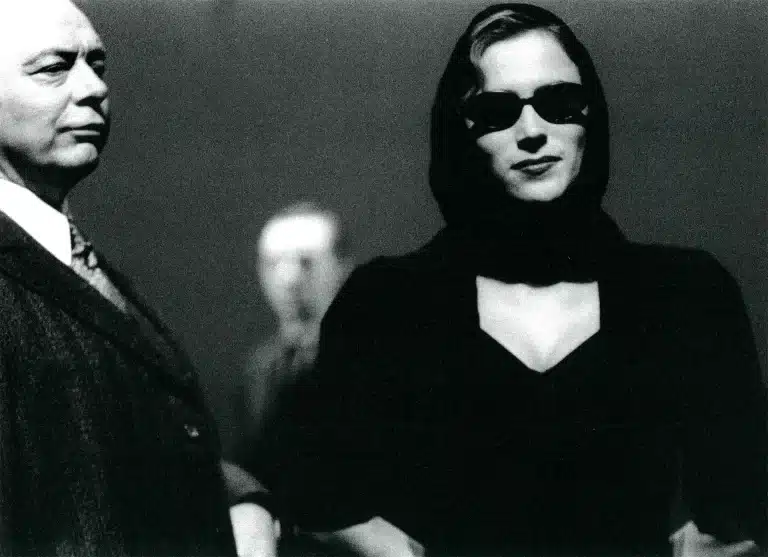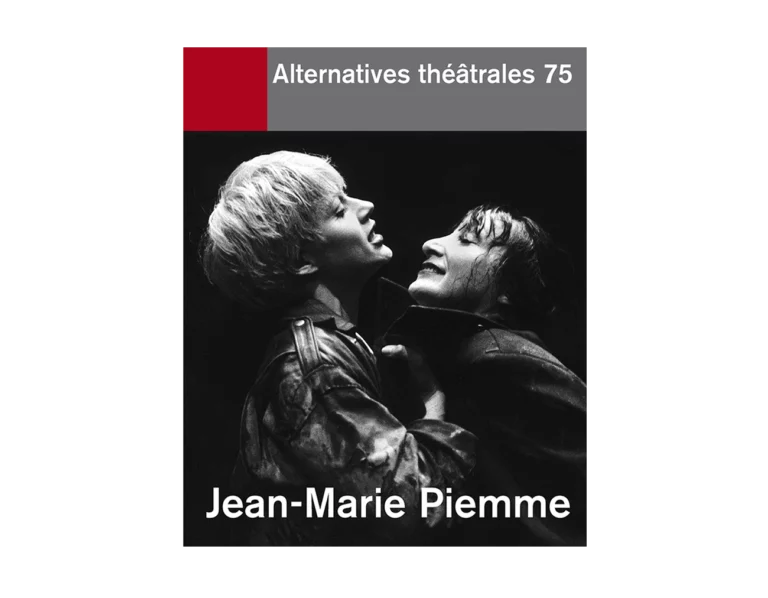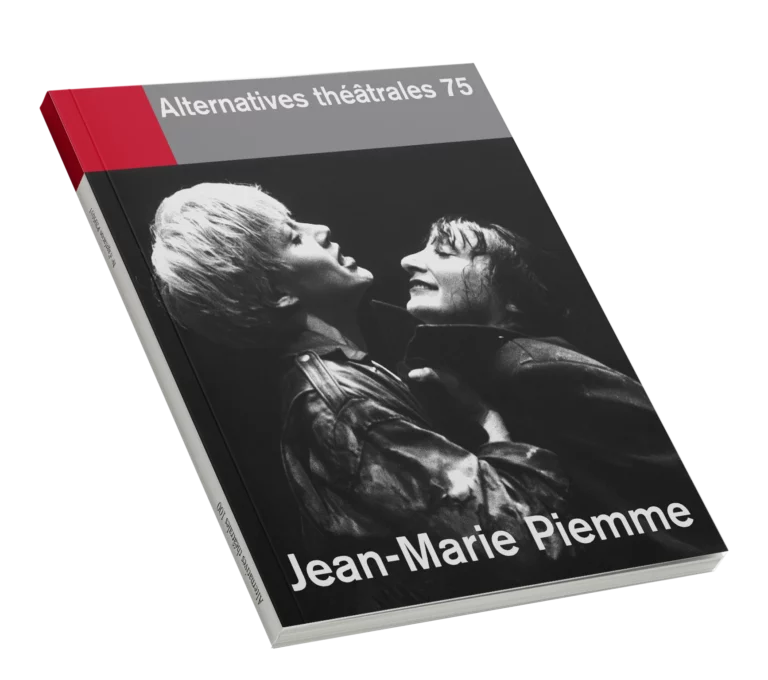A l’image des protagonistes de TORÉADORS, Jean-Marie Piemme est animé par la passion d’argumenter. Avant qu’en 1986 il ne débarque définitivement dans la fiction, sa pratique de la dramaturgie, de longues années durant, avait fait de lui le dialecticien le plus remarquable de notre paysage théâtral. C’est sans doute là que se trouve l’origine de la confiance qu’il semble faire à l’intelligence du spectateur : il se méfie de la simplicité et propose de nous emporter dans un univers de subtilité faisant éclater les contradictions qui traversent ses personnages. Avec une maîtrise du dialogue théâtral et une jouissance de la langue saisissante, pour lui, chaque scène est un enjeu. Les phrases se balancent au rythme de la pensée. Tout est rapport de forces, même l’écriture. Héritier de Brecht, il manie avec aisance la compénétration du présent et du passé, faite d’identifications et de distanciations, et brise en morceaux le réalisme ordinaire, illusionniste, comme l’analyse de manière remarquable Philippe Ivernel. Ce langage si maîtrisé est cependant loin d’être désincarné. En passant de la lecture critique des textes à une écriture personnelle, il n’a pas abandonné la proximité du plateau. Travaillant en lien étroit avec les metteurs en scène, n’hésitant pas à remettre sans cesse l’ouvrage sur le métier, cette écriture s’est liée, au contact des acteurs, à la fantaisie du théâtre et au jeu des possibles, comme le fait remarquer Philippe Sireuil. Langue pour les acteurs, écriture « physique », écriture « du corps », « on sent toujours le corps à l’œuvre », affirment unanimement les collaborateurs de ce numéro. L’œuvre de Jean-Marie Piemme nous ressemble, nous surprend, nous provoque. Elle est violente comme l’est la société, corrosive et ironique, elle est aussi drôle et tendre. Au fil des pièces se dessine un pessimisme joyeux comme l’écrit Patrick Verschueren, une énergie joyeuse qui surgit des vérités et des paradoxes qui nous sont proposés. Il y a aussi, et ce n’est pas le moindre apport de Piemme au théâtre contemporain, une capacité d’imagination et d’invention étonnante. Isabelle Pousseur en a une conscience aigüe lorsqu’elle voit que chez lui le personnage « n’est plus seulement l’objet d’une histoire menée par un auteur : on lui donne tout à coup une espèce de responsabilité narrative, une responsabilité de la forme de l’écriture mais en même temps une responsabilité de son destin, de sa vie ». Elle poursuit en nous rappelant que « le grand théâtre, c’est le théâtre où on ne sent pas une emprise de l’auteur qu’elle soit idéologique, de sens ou de conduite ». C’est ce que confirme Jean-Marie Piemme quand il écrit que « le plaisir est là, dans le mouvement infini de l’appropriation », magnifique proposition à la liberté du spectateur. Ainsi nous est donné un théâtre où l’exigence d’une pensée en acte et en mouvement s’allie à une profonde humanité.
«IL Y A QUELQUES ANNÉES j’ai acheté une vieille édition de Marc Aurèle qui portait la dédicace: «Qu’il vous soit…