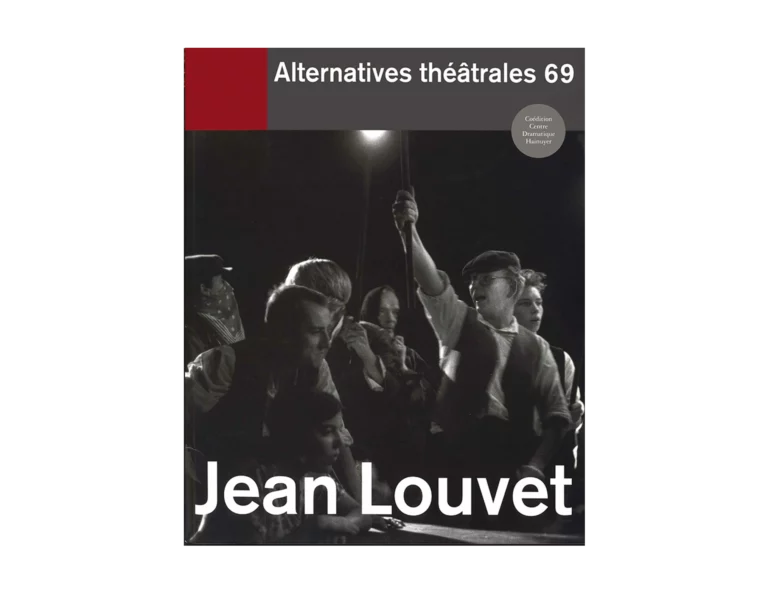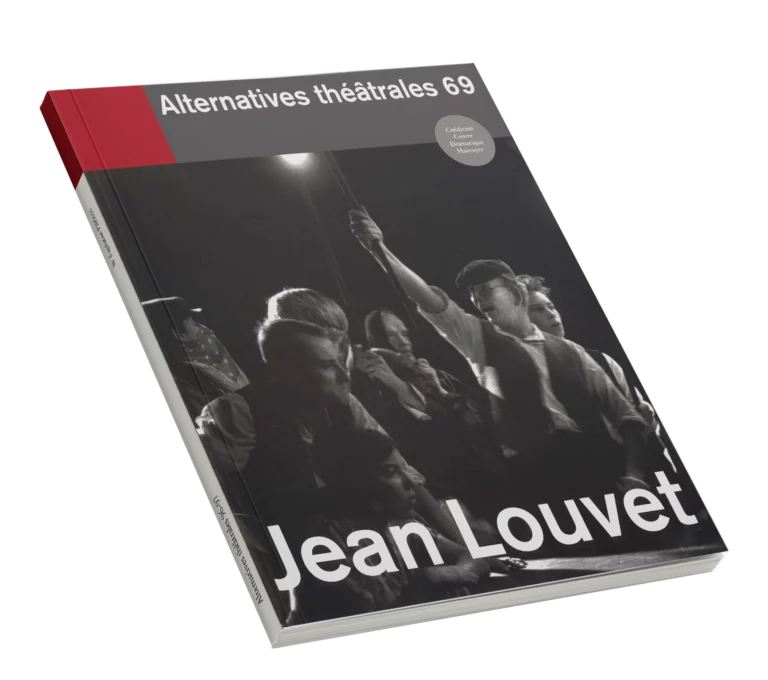MÊME SI LE GROUPE a parfois changé de nom : Théâtre prolétarien, Atelier de théâtre, Studio-Théâtre de La Louvière, il y a une continuité quasi ininterrompue de cette activité théâtrale à La Louvière. 1961 – 2001 : quarante ans. Militantisme ? Néo-militantisme ? C’est en tout cas sur la lancée du militantisme politique et syndical des années 60 que va perdurer ce travail.
Au départ, c’est un groupe d’ex-grévistes qui s’installe dans une arrière-salle de café partagée avec des boxeurs et des colombophiles. Un quartier ouvrier. Un public de militants politiques et syndicaux, d’intellectuels engagés, d’ouvriers. Rien n’échappe à notre volonté de critiquer le capitalisme et les directions du mouvement ouvrier. La plupart des membres de la troupe mènent une activité militante aux plans national et international. Quelques points forts de notre analyse : bureaucratisation des organisations (pendant la grève de 60/61, quelques membres importants de « Socialisme et barbarie » étaient venus à La Louvière), impasse du réformisme, lutte pour le fédéralisme avec un contenu socialiste, société de consommation et ses manipulations, poujadisme, rôle de l’intellectuel.
Très peu de moyens financiers.
Menacée de disparaître fin des années 70, la troupe va connaître une éclaircie sur le plan matériel quand quelques hommes de gauche nous invitent à nous inscrire dans la circulaire du théâtre-action, institution toute récente dont le Théâtre prolétarien se rapproche le plus. En adhérant au théâtre-action, la consigne demeure cependant claire, inscrite dans les statuts du nouveau Studio-Théâtre de La Louvière : je dois continuer à écrire et à monter mes pièces et celles d’autres auteurs de la région. Nous nous initions à la création collective avec plusieurs spectacles : LE JEU DU ROI DE LA LOUVIÈRE, VISITE GUIDÉE, COMMENT ÇA SE FAIT QUE PERSONNE NE RIT, ARRÊTEZ, JE VEUX DESCENDRE. Nous organisons des formations, la plus récente est la naissance d’un atelier d’écriture. Quand Jacques Dubois m’avait invité à Liège, à la Huitième section, pour animer avec Pascal Durant un séminaire sur l’écriture théâtrale, j’avais tenté de formaliser un minimum d’accès théorique à ce type d’écriture.
C’est cette approche-là que quelques membres de la troupe ont souhaité partager en écrivant : LA CITÉ DES MAL LOTIS, À COMME ADRIEN, TERMINUS CAVIAR (Janine Laruelle); L’HOMME INTERDIT, LES ENCOMBRANTS (Jean Leroy); QUAI DES AFFRES, LA RACE DES SAIGNEURS (Emmanuel Loretelli); POLITIQUEMENT INCORRECT, LE MIRAGE DES OLIVIERS (Franck Livin); ESPÈCE D’IDYLLE (Stéphane Mansy). Quatre de ces pièces ont été publiées chez Lansman. Actuellement quatre nouvelles pièces sont en chantier.
Sur le plan de la mise en scène, il y a eu aussi des changements importants. Si j’ai mis en scène pendant trente ans, à partir de 1989, c’est mon fils Pierre qui va me remplacer pendant que je glissais à la dramaturgie.
Nous avons décidé aussi d’autonomiser Le plus possible les membres. Aujourd’hui, dans un premier temps, actrices, acteurs et auteur participent le plus possible à l’élaboration du spectacle ; ce n’est que plus tard que metteur en scène et dramaturge « attitrés » interviennent à la demande d’ailleurs du groupe. Une exception, quand il s’agit de ce qu’on appelle les créations propres (pour les opposer aux ateliers), c’est toujours le couple Louvet qui mène la danse surtout parce que j’aime vraiment bien travailler avec Pierre qui a souvent un coup d’œil sûr.
Phénomène récent :il y a des ateliers qui n’aboutissent pas nécessairement à des spectacles. Pendant six mois, Pierre a animé un atelier avec quelques personnes très marginalisées. On nous demande aussi parfois de donner un coup de main à la mise au point de spectacles scolaires (secondaire ou primaire). Et depuis plusieurs années, La Plate-forme de concertation de la Santé mentale (qui regroupe les services psychiatriques de trois hôpitaux et quatre centres de guidance) entretient avec le Studio-Théâtre des relations suivies ; Serge Faëlli, Robert Sterck, psychiatres, et Jean-François Lavis, sociologue, se sont intéressés de près à plusieurs de mes pièces pour tenter de comprendre la perte du lien social. Pierre Louvet a mené un travail en service psychiatrique à Jolimont, et plus récemment nous avons organisé toute une soirée sur le suicide, revenant au débat comme dans les années soixante. Précisons que l’art-thérapie est au centre de ces rencontres. Ajoutons enfin qu’un atelier d’histoire, très prometteur, est animé, notamment, par Madame Claire Billen, professeur à l’ULB et où le Studio-Théâtre pourrait éventuellement intervenir (le but de cet atelier est de rendre le sens de l’histoire à une population précarisée).
La permanence de ces activités tient sans aucun doute en partie à la stabilité du noyau familial qui gère quotidiennement les problèmes. La permanence est due aussi au fait qu’il y a un groupe d’actrices et d’acteurs très impliqués, entourés par Jean Capiau, Christian Leroy, Daniel Pelletti.
Le public militant des années 70 a disparu en grande partie, remplacé par ce qu’on appelle le public « institutionnel » largement régional, complété par une frange non négligeable du public dit défavorisé : jeunes amenés par un animateur de rue, quelques chômeurs, population de femmes et de jeunes de cités plus où moins à risques, réfugiés politiques, etc.
À travers vents et marées, de l’intellectuel engagé à l’intellectuel critique, le Studio-Théâtre de La Louvière a trouvé sa place, surmontant la chute du mur, la mondialisation, l’idéologie gestionnaire, les grèves des enseignants (plusieurs membres sont professeurs) dont les échecs répétés ont entraîné une profonde démobilisation. À quoi il faut ajouter les problèmes personnels.
La Wallonie est une société fracassée : dans un premier temps, c’est elle qui a permis à la bourgeoisie belge de se hisser au niveau des grandes puissances économiques ; dans un second temps, la Wallonie s’est retrouvée au rang des régions d’Europe parmi les plus sinistrées. Il n’en fallait pas tant pour susciter la naissance et le développement, jusqu’à aujourd’hui, d’un théâtre politique pour tenter de répondre à cette apparente énigme et d’en pallier les effets dévastateurs. C’est ce terrain-là qui a permis, notamment, aux générations de se rencontrer.