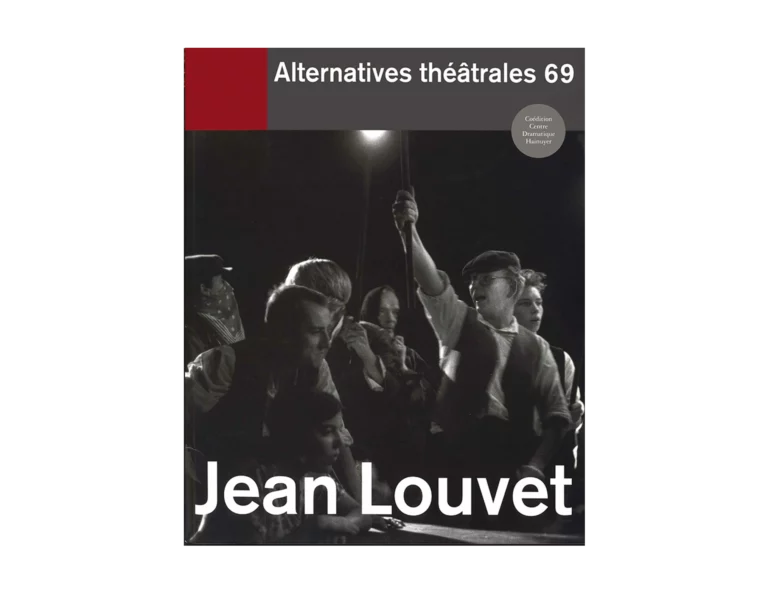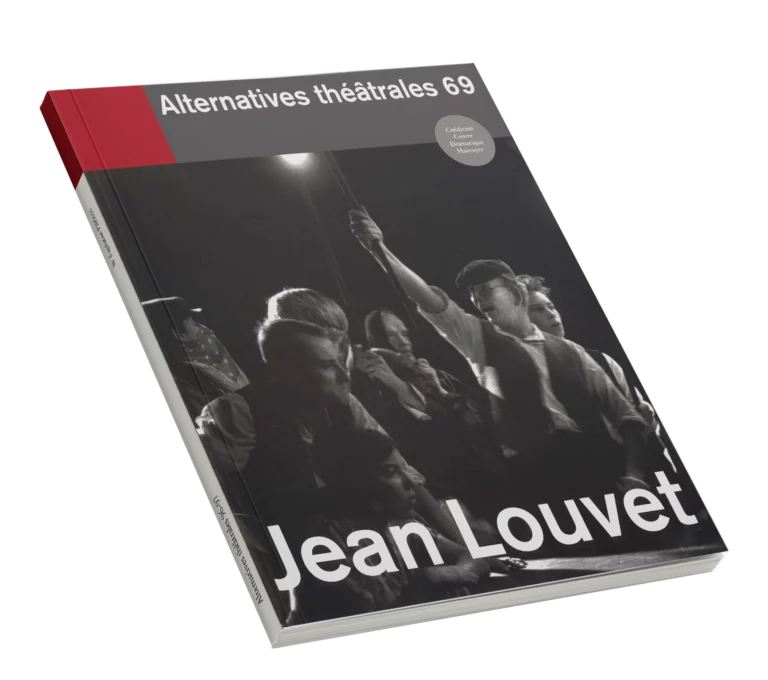… « Le libéralisme économique extrémiste rétablit la lutte pour la vie comme forme idéale de justice. Le noir du ghetto devint rapidement le prototype du raté. Ce revirement de situation particulièrement cruel créa une prise de conscience, dont le rap est une des manifestations. Désormais, les textes décriront la vie du ghetto, et reprendront le combat inachevé de Martin Luther King et des Black Muslims. En 1982, le rap devint un message. D’abord dance-music, il wuta en protest-song. »
Georges Lapassade et Philippe Rousselor,
LE RAP OU LA FUREUR DE DIRE
(Loris Talmart, 1998)
IL AURAIT PU, Mohamed, se retrouvant sans le sou après la scission de sa compagnie Les Acharnés, rebondir avec prudence et timidité, comme le font la plupart de ses confrères dans les moments d’adversité, par un modeste solo d’acteur pour petite salle ou petite jauge, un de ces « seul-en-scène » de plus parmi ceux qui se multiplient dans nos théâtres, tout à la fois pour de mauvaises raisons économiques, mais aussi, parfois, pour quelques bonnes motivations liées à l’exploration introspective du « je » (du jeu ?), ainsi qu’à la relation de confidence, d’intimité et de proximité souvent aujourd’hui recherchée par l’acteur auprès de son destinataire. Pour ce faire, il avait tout sous la main. Un bon acteur : lui-même. Un dramaturge de talent : encore lui-même, auteur désormais confirmé de plusieurs pièces parmi lesquelles LES ACHARNÉS (à l’origine du nom de la compagnie), LES FRAGMENTS DE KAPOSI ou LES NOUVEAUX BÂTISSEURS, toutes publiées chez Actes Sud Papiers. Une idée forte : réunir quelques extraits des harangues les plus percutantes de Malcolm X, militant noir afro-américain assassiné en 1965 ; opposer implicitement, sans même y faire allusion, l’image du méchant Malcolm, musulman vindicatif et « prédicateur de la haine » (c’est-à-dire de la lutte des classes) à celle du bon chrétien, le pasteur Martin Luther King, pacifique, intégrationniste et consensuel ; mettre en perspective Le discours très américain et daté « années ‘60 » de Malcolm avec ce qui aujourd’hui en France n’a pas (beaucoup) changé : les flambées de racisme et de xénophobie, la colère des banlieues, l’insoluble héritage esclavagiste et colonial.
Dans cette première approche déjà, certains choix de texte et de traduction font mouche : les mots « basané », « voleur », « pyromane », « taux de criminalité » ou encore « délit de faciès » et « sauvageon », se portent garants de la modernité du propos et semblent établir par-delà l’Atlantique et les décennies une passerelle explicite entre la fable historique et l’actualité. Si l’on ajoute à cela que la physionomie de Mohamed, comme ses nom et prénom, véhicule les signes ethniques et culturels sinon de l’Algérie et de l’Islam, du moins du Maghreb et de la communauté arabe, il n’est pas très difficile de faire jouer entre le « nègre » et le « beur », l’Amérique et l’Europe, les sixties et aujourd’hui, le double mouvement de relation et de distance, de rapprochement et d’éloignement dont le projet dramaturgique est porteur.
Pour conforter cette idée, mais aussi pour ajouter une valeur de plaisir et de sens à une intention déjà très pertinente en soi, Mohamed Rouabhi a donc élargi le monologue oratoire de Malcolm — qui demeure l’épine dorsale de son propos — à un spectacle « total » ou, plus modestement, « pluriel », incluant plusieurs disciplines — la musique, la voix, la chorégraphie et les images —, et faisant appel à quatre, voire cinq partenaires scéniques : un DJ, deux rappeurs, une chanteuse, ainsi qu’un projectionniste « à vue » installé au premier rang.
Le rouge et le noir
Toute maquillée de noir, la cage de scène dit non seulement l’étymologie de la négritude et la couleur de la peau, mais aussi le deuil, lié aux exécutions, aux violences des rues, aux expéditions punitives, au crime organisé. Le tréteau s’y fait alors catafalque, et le costume-noir-cravate-noire (genre en in black) des deux rappeurs annonce l’ordonnateur des pompes funèbres en même temps qu’il dit l’uniforme protocolaire du garde du corps. Tout l’enjeu tragique du spectacle est contenu dans la monochromie de cette camera obscura qui, aux deux bouts de la chaîne, réunit, dans un même volume cubique, la boîte photographique et/ou cinématographique où se fabrique une information truquée, manipulée, et la salle de spectacle — théâtre, cinéma, music-hall, salle des fêtes —, celle-là même où se diffusent toutes les idéologies, dominantes et dominées, aliénantes ou émancipatrices, depuis les films racistes et impérialistes issus de la production hollywoodienne la plus grossière, jusqu’aux meetings révolutionnaires des prédicateurs de l’espoir et de la dignité retrouvés. Seules taches de couleur vive dans cette salle obscure : quelques rangées de sièges tapissés de tissu écarlate, rabattus sur leurs dossiers, désignent par métonymie, à cour comme à jardin, la présence-absence de corps humains formant une assistance où un auditoire. Couleur du sang versé, commun à toutes les races. Couleur aussi du drapeau rouge de la lutte des classes et de la révolution.