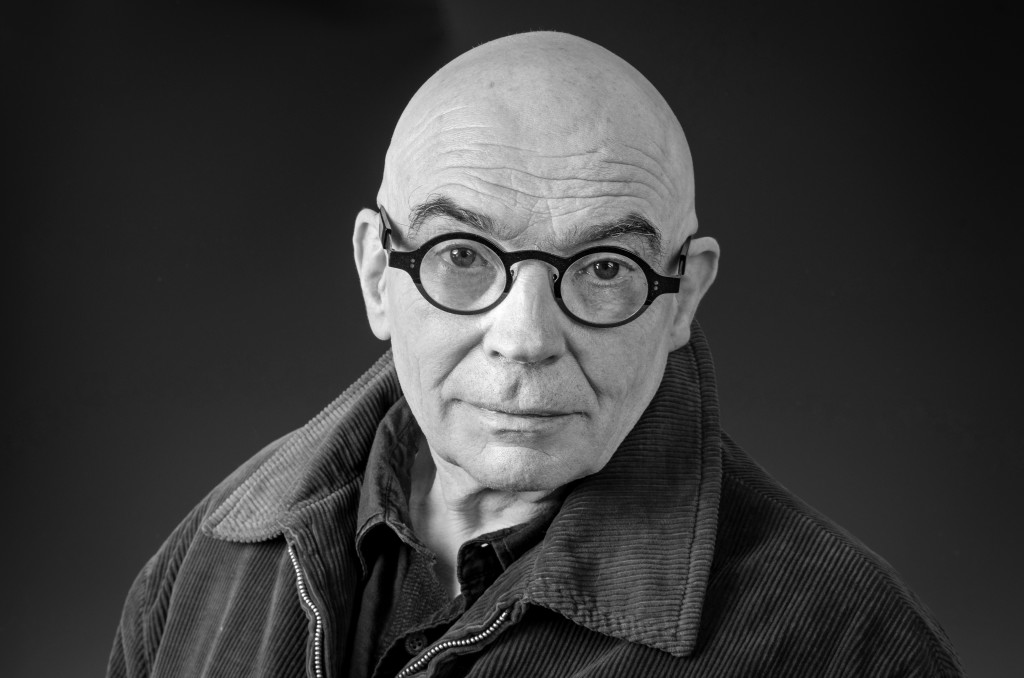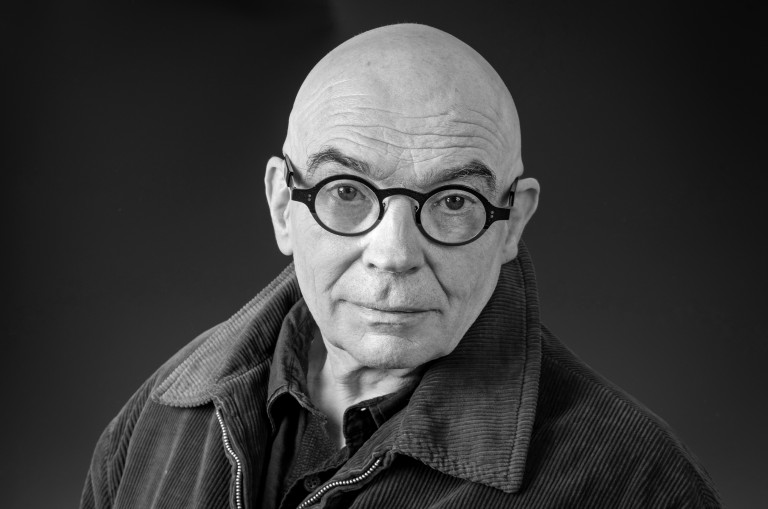- LA MOUETTE N’EST PAS UNE PIÈCE DE L’AMOUR CONTRARIÉ, comme on l’avance parfois un peu simplement. Ce n’est pas une tragédie de la passion amoureuse. Treplev ne se suicide pas parce qu’il a perdu Nina et celle-ci ne trouve pas le bonheur avec Trigorine. Ces échecs les marquent au fer rouge, mais le moteur de leurs actes est à chercher dans la nécessité où la vie les place d’avoir à franchir la distance qui sépare l’illusion de la réalité. La Mouette est d’abord la chronique d’un apprentissage, celui de la réalité, par deux jeunes gens. L’un(e) y accède dans la souffrance, l’autre n’ayant pas la capacité d’endurer, et ne sachant pas pourquoi il l’aurait, choisit le suicide. Tchekhov sait beaucoup de choses sur la vie. Par exemple qu’il faut de l’illusion pour vivre. Il faut de grands espoirs et des désirs. Mais il sait aussi, et contradictoirement, que vivre son temps, c’est aussi perdre ses illusions et affronter la séduction dangereuse d’un désir sans paillettes ni mirages. Ainsi, à travers un mince fil d’intrigue dont on ne voit que rarement les temps forts, à travers les urgences du désir qui les jettent l’un contre l’autre pour faire, défaire et refaire le jeu constant des triangles amoureux, les personnages sont implacablement ramenés à eux-mêmes, à leur vérité dans le temps, saisis sans romantisme, sans trémolo, décapés de la couche de mythologie qui pourrait parfois faire de leur vie une belle aventure et les rendre un peu héroïques. Ils n’ont qu’un seul destin : marcher vers la fin (même si, comme Sorine, ils n’ont pas vécu) avec une bonne dose d’aveuglement, de méchanceté et d’égoïsme. On est seul chez Tchekhov parce qu’on voudrait se raconter des histoires et qu’on ne le peut pas.
*
- DANS LA MOUETTE, ON TIRE UN COUP DE FEU MORTEL. Le fait est que Constantin Gavrilovitch se tue. Discrètement, certes ! Avec un bruit de bouchon qui saute, et surtout hors-scène. Dans Oncle Vania, on tire aussi un coup de feu. Toujours derrière la scène, comme l’indique la didascalie. Mais la victime apparaît aussitôt. On se bat, le presque assassin est désespéré : « qu’ai-je fait, qu’ai-je fait ! ». Dans Les Trois Sœurs, coup mortel, le futur marié ne viendra pas. Adieu la vie différente. L’acte tragique traverse pudiquement la vie tchekhovienne comme pour rappeler que l’intensité n’a pas disparu, même si on vit à la campagne une vie de routine. Simultanément, il faut vivre sa vie, continuer jusqu’à la tombe, assurer en sachant que la réalité ne sera jamais à la hauteur des rêves. Trigorine, jusqu’à sa tombe, sera « moins bien » que Tolstoï ou Tourgueniev. Macha devient Paulina sous nos yeux. Arkadina voudrait vivre sans penser à la mort, mais la mort de son fils lui ouvre le chemin d’une vieillesse qui sera difficile. Vania se révolte un peu puis renonce. À la différence de Treplev qui ne supporte pas d’être rien, il accepte de continuer à vivre, ne sera pas, n’aurait probablement jamais pu être un Schopenhauer. Irina, la plus belle, la plus jeune, celle qui avait encore dans les mains tout un possible –même si le fiancé n’était pas à la hauteur des rêves — rejoint ses sœurs en disgrâce. Comme leur frère qui ne deviendra jamais le grand professeur qu’il aurait voulu être. Les trois sœurs regardent le vide devant elles. Une fois la garnison partie, il reste à se résigner. « À Moscou ! À Moscou ! », s’écrient-elles pendant que l’impassible et inexorable mouvement du temps abat leurs châteaux de sable. On voudrait pleurer. On ne peut pas. La dramaturgie tchekhovienne n’appelle ni la complaisance ni la compassion. Elle ne raconte jamais le destin malheureux d’un personnage. Le cœur de ses pièces est fait du groupe d’hommes et de femmes qui vivent sous la loi inexorable de la vie. Tchekhov dit : voyez-la, cette vie, dure dans son processus, étrangère au bonheur et au malheur des hommes. Elle distribue le lot des êtres pendant un certain laps de temps, indifférente à ce qu’ils désirent ou à ce qu’ils redoutent. Avec Tchekhov, on n’est jamais dans le dos des personnages, mais face à eux. On ne s’englue pas avec eux dans leurs impossibilités, on les regarde s’engluer, avec, parfois, une goutte de sueur qui vous coule dans le dos. Tchekhov est trop lucide pour être sentimental. Il aime ses personnages, c’est évident, mais ne leur accorde jamais la consolation du vibrato romantique. Je vous aime dans vos souffrances, leur dit-il, puis il ajoute brutalement : la vie, c’est ça et rien d’autre, alors il faudra vous y faire. C’est la loi du « c’est comme ça » qui porte à un point de densité rare la perspective de la vie comme résignation. On a souvent ramené la lucidité tchekhovienne à la profession de l’auteur. Je soutiens pourtant que Tchekhov n’est pas lucide à la manière d’un médecin. Tchekhov n’a pas le détachement du technicien, sa lucidité est celle du poète. Dans sa dramaturgie du renoncement palpite toujours la présence de ce à quoi il a fallu renoncer. Le « c’est comme ça » se souvient toujours de ce que ce serait tellement mieux autrement. Tchekhov a un sens tragique de l’impossible. Impossible de penser que cela puisse être autrement. Impossible de ne pas penser que cela devrait être autrement.
*
- PETER SELLARS ET LA MOUETTE. À Washington avec Gérard Mortier pour voir (notamment) La Mouette de Tchekhov mise en scène par le metteur en scène américain Peter Sellars. Il avait présenté à La Monnaie une adaptation de l’Ajax de Sophocle actualisée. Les chefs de l’armée grecque en lutte contre Troie (Agamemnon, Ménélas, Ulysse, Ajax, etc.) sont transposés en généraux américains dans le contexte de la guerre du Vietnam. Spectacle puissant. Une image, entre autres, me frappe. Ajax, colosse barbu, est muet, il parle en langue des signes, traduit quand il le faut par sa femme. Dissociation du geste et de la parole. Ce parti pris de mise en scène fait tout de suite sentir au spectateur l’étrangeté d’Ajax. Il n’est pas comme le reste de son camp. Sa solitude est physiquement perceptible. Dans l’adaptation de Sellars, Ajax passe en cour martiale pour un acte fautif. On l’amène sur le plateau dans une grande cage en verre fermée de tous côtés. Ses pieds baignent dans dix à vingt centimètres de sang. Il commence sa défense (traduite en paroles par sa femme) dans les gestes de la langue des signes. En accentuant ses gestes, il plonge parfois les mains dans le sang qui se projette alors sur les parois de verre. Ainsi a‑t-on en même temps la violence de la guerre et la mise à distance de la violence. L’oreille entend la voix calme et neutre de l’interprète du récit d’Ajax (version froide) et l’œil perçoit la violence des faits racontés par Ajax dans son langage (version chaude) par le moyen d’une représentation radicalement non naturaliste, absolument spécifique à la scène comme lieu d’artifice. On retrouve cette disjonction dans la mise en scène de La Mouette, mais sous une autre forme. La contradiction dans ce cas se situe entre le type de jeu et la scénographie. Type de jeu : réaliste, très Actor Studio, le comédien est le personnage, identification radicale, exhibition paroxystique des sentiments. Scénographie : un plateau nu, quelques chaises rassemblées, un piano. Donc, un espace où seront mis en scène non les personnages, mais les acteurs. Non l’énoncé, mais l’énonciation. D’un côté (le jeu) un parti pris illusionniste ; d’un autre côté (espace et mise en place), une volonté d’affirmer la présence de la scène, sans chercher d’illusion référentielle. Du choc des contraires naissait un beau spectacle, jouant de la proximité et de la distance. Ce soir-là, le public américain n’était pas enthousiaste. Il comprenait mal, semble-t-il, la proposition d’espace. J’imagine que si le spectacle avait été présenté en France, c’est un jeu trop psychologique qui aurait suscité des réserves.