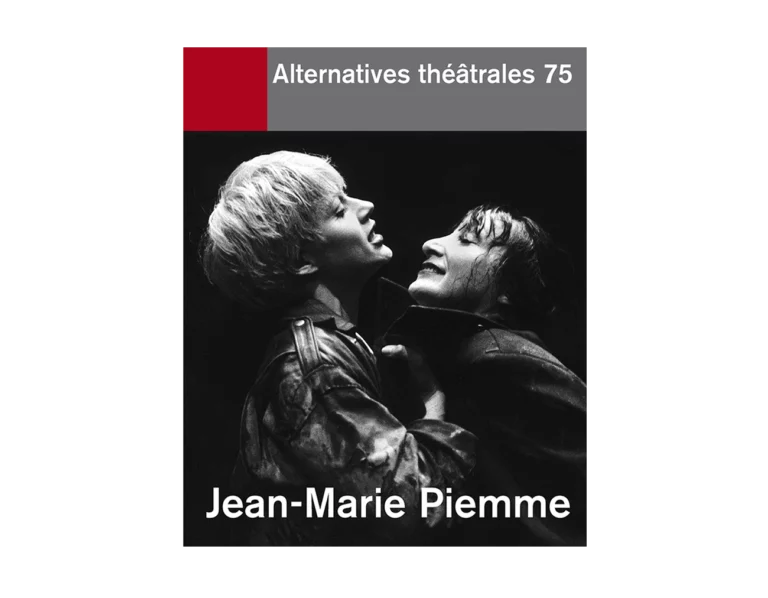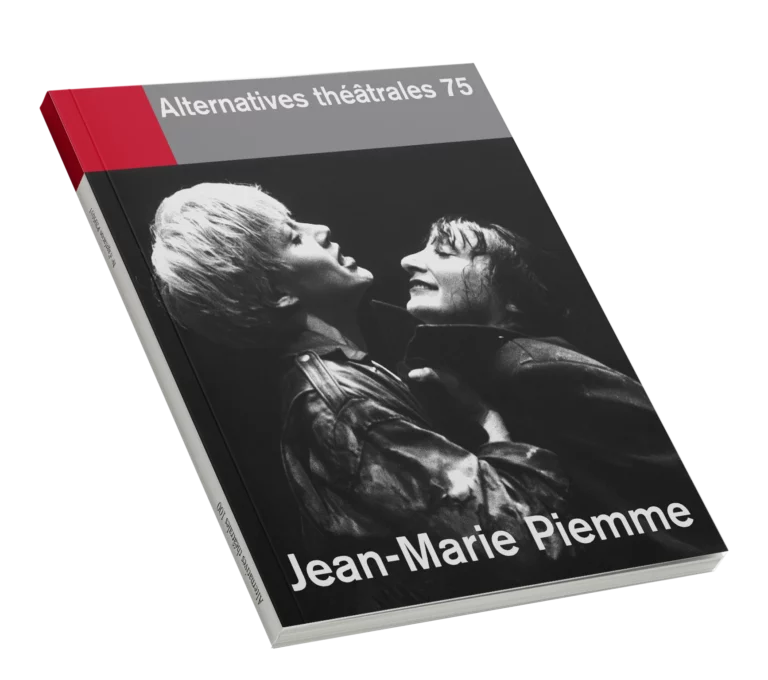BERNARD Debroux : Comment s’est déroulée l’expérience de la Balsamine à laquelle tu as été associée ?1
Isabelle Pousseur : Christian Machiels avait participé au projet de « Bruxelles nous appartient »2. J’avais pris part auparavant à la création de spectacles réalisés à partir d’interviews dans le quartier, en compagnie de neuf metteurs en scène ; textes et acteurs avaient été tirés au sort. Christian Machiels avait vu ce travail et voulait poursuivre l’expérience, mais autrement. Pour lui, il fallait un auteur pour réaliser le passage à la scène d’une écriture du réel. Il était intéressé par la matière rassemblée par « Bruxelles nous appartient » mais souhaitait le travail d’un auteur. Il a décidé de deux metteurs en scène et d’un chorégraphe, assignant pour tâche aux premiers de choisir des textes dans le matériau existant et un auteur. Il ne manquait plus alors que le choix des acteurs pour que s’initie ensuite un processus classique de réalisation.
J’ai tout de suite pensé à Jean-Marie, non tant à cause de la spécificité du projet que parce que je venais de travailler avec des étudiants de l’INSAS sur les Pièces d’identités (Trompe‑l’œil et livre d’images) ; c’était la première fois que j’abordais des textes de Piemme. Ça s’était bien passé, j’avais vécu un rapport très actif à son écriture ; elle me sollicitait beaucoup et j’avais envie de poursuivre quelque chose. Je lui ai donc proposé l’écriture et il a tout de suite accepté.
Pour moi, le processus s’est enclenché de manière assez étrange : je n’ai pas été très vite et très fort intéressée par ce matériau, je ne veux pas dire « humainement », mais en tant que metteur en scène.
B. D. : C’est pourtant toi qui avais sélectionné ce matériau ?
I. P. : On nous a introduit au site de « Bruxelles nous appartient » lequel présentait la liste des différentes interviews, un petit résumé de chacun et un petit enregistrement. On pouvait ensuite avoir accès à tous les CD qu’on voulait mais il y en avait deux cents ! C’était un moment bizarre et difficile. J’ai fait des choix à partir du site, sans avoir de ligne directrice (d’autres en avaient). Je me trouvais confrontée à beaucoup d’interviews assez « gentilles », menées par des non-professionnels, dont les questions ne poussaient pas la personne vers des endroits qui pouvaient devenir intéressants pour le théâtre.
Je suis finalement « tombée » sur une femme qui m’a plus intéressée ; c’était quelqu’un de très bavard, un « personnage », doté d’un langage très métaphorique. Je l’ai proposée à Jean-Marie et il a accroché très vite. Je me suis rendue compte que j’avais vécu bizarrement ce rôle d’aller offrir un matériau à un auteur.
B. D. : D’autant plus, peut-être, que tu ne maîtrisais pas l’ensemble…
I. P. : Oui, difficile à maîtriser parce que très vaste. Mais Jean-Marie s’est tout de suite intéressé au personnage, il a senti que c’était un personnage « romanesque », quelqu’un qui avait un vécu, un regard sur le monde et une capacité à exprimer ce regard. Effectivement, nous avons eu l’occasion de rencontrer cette personne qui est vraiment très particulière, « déjantée », une femme vivant dans une communauté chrétienne, très croyante et développant un humanisme très particulier, fréquentant les cafés, décrivant les personnages qu’elle croise, se mettant à parler avec tout le monde à n’importe quelle heure du jour et de la nuit, mais qui a emmagasiné beaucoup de sensations et beaucoup de rencontres. On s’est donc dit qu’on allait démarrer de cette femme et de son regard sur les autres. Ça a été le point de départ de l’écriture.
À partir de là, Jean-Marie a écrit quelque chose que je qualifierais de « classique », qui renouait avec une vraie petite forme théâtrale. On aurait pu faire comme d’autres qui ont juxtaposé des bribes de paroles, de textes et en faire une sorte de « chœur ». Jean-Marie, lui, a véritablement transformé — non pas les mots de cette personne dont beaucoup sont repris comme tels — mais à partir du regard de cette personne sur la réalité et sur d’autres personnes, sur le lieu où elle était (un café), il a écrit une pièce avec des personnages, des rencontres…
B. D. : Il ne s’est donc pas servi du matériau comme tel pour en faire un « monologue » ; il a introduit d’autres personnages imaginés à partir de son regard à elle.
I. P. : Il a introduit deux autres personnages. Le premier, c’est quelqu’un dont cette femme parle abondamment, la serveuse du café, Angèle, et dont elle parle avec beaucoup d’amour, d’intérêt et de curiosité ; il a créé le personnage de Jeanne, fortement inspiré de ce qu’elle disait. Et puis il y a le rôle d’homme, à partir d’une allusion qu’elle fait et qui nous avait fait sourire : parmi tous les gens qui fréquentaient le café, elle parlait d’un écrivain subventionné par la Communauté française qui se tient dans un coin et qui pense… (on s’est demandé qui pouvait bien être cet écrivain subventionné par la Communauté française qui hante ce café étrange, le Gambrinus !) Jean-Marie est parti de cette allusion-là pour créer un personnage à lui qui, par ailleurs, a également été inspiré par l’acteur.
Dès qu’il m’a eu donné les premières moutures, j’ai tout de suite eu une idée de distribution pour les trois personnages. À partir de là, il a poursuivi l’écriture en s’inspirant des acteurs eux-mêmes ; en particulier de Philippe Grandhenry qui incarne le rôle de l’homme et devient dans la pièce « l’homme au bonnet ». Philippe porte tout le temps des bonnets et c’est donc de Philippe même que Jean-Marie est parti pour construire son personnage.
B. D. : Mais il a gardé le personnage de la femme dans son « personnage » à elle.
I. P. : Oui, le personnage de la femme est joué par Laurence Vielle. Dans la première mouture que j’ai eue, tout ce qu’elle disait, ou presque, était dans l’interview. Simplement, il avait dû agencer le contenu autrement puisque les questions n’étaient pas reprises. Il y avait quelque chose dont nous avions parlé, que j’aime beaucoup dans les textes et qui est très importante : le mouvement assez constant entre le narratif et le dramatique. C’est très développé dans la pièce : Jean-Marie a inventé un chœur, constitué des trois personnages, et le chœur raconte ; c’est le cas au début par exemple. Et puis il a imaginé que la parole de cette femme s’adressait tantôt à l’un, tantôt à l’autre… Quand on lit la pièce, elle est là dans ce café, elle parle, est-ce qu’elle s’adresse à la serveuse, est-ce qu’elle s’adresse au public, est-ce qu’elle s’adresse au monde, à Dieu… C’est quelque chose de très ouvert qui permettait de préserver beaucoup de choses qui avaient été dites en réponse aux questions de l’intervieweuse.
Dans la deuxième mouture, après en avoir discuté, Jean-Marie a en quelque sorte prolongé le personnage vers quelque chose qui n’existait pas, qu’il a lui-même assimilé et qui a permis, à mon sens, d’écrire une très belle fin beaucoup plus fantasmée. Il la fait aller dans un endroit moins réaliste mais rendu possible par le côté quand même un peu rêveur et très excentrique du personnage de départ.
B. D. : À partir du moment où tu as fait le choix de cet entretien, c’est le matériau avec lequel Jean-Marie a travaillé. Mais toi, tu n’es pas intervenue dans l’orientation qu’allait prendre l’écriture ?
I. P. : Uniquement lorsque nous avons parlé des acteurs, (les contraintes financières n’ont pas permis de multiplier les personnages). Je me souviens avoir dit à Jean-Marie qu’il me semblait que la fin pouvait être développée à partir d’un imaginaire. Lui hésitait mais c’était surtout pour des raisons éthiques. Nous avions en effet tous les deux nos blocages par rapport au fait d’utiliser la parole de quelqu’un. Que peut-on faire et ne pas faire ? Est-ce qu’on regarde cette femme avec un point de vue critique ? Est-ce qu’on la regarde avec amour ? On était quand même d’accord tous les deux sur le fait qu’on n’était pas là pour en faire la critique mais pour la porter ; que si on l’avait choisie, c’était pour ça. Mais ça n’empêchait pas qu’on la prolonge.
C’est à ce moment-là aussi qu’on a parlé du film. Jean-Marie avait envie d’un film et il m’a demandé si c’était possible pour moi. Il voulait que le film regarde la rue « vraiment », il voulait un regard à l’intérieur du monde « réel ». On est partis de l’idée d’une sorte de caméra subjective, comme si c’était elle qui se promenait dans les rues, la nuit, à Saint-Josse. La teneur la plus importante de cette discussion a été d’être d’accord que même si on était dans le café, qu’il y avait trois personnages, on ne cherchait pas une forme réaliste, qu’on devait tout le temps justifier. Il m’a beaucoup questionnée là-dessus. Moi, je voulais bien qu’il y ait des blocs de textes, à nous de trouver comment faire les rapports ; au contraire, ça m’intéressait plutôt. Il y a donc eu une étape qui a été franchie après la discussion : aller vers quelque chose de plus libre, et donc permettre à Jean-Marie de se laisser aller à des désirs d’écriture et de forme plus personnels.
B. D. : Avez-vous travaillé le matériau brut avec les acteurs ?
I. P. : Non, on a attendu que ce soit fini. Quand j’ai parlé tout à l’heure d’une forme classique, je voulais dire qu’à partir de l’interview, il est allé quand même vers ce qu’on peut appeler « une pièce de théâtre ». L’œuvre qui en résulte est traversée par le dialogue entre le narratif et le dramatique dans une continuité intemporelle, ni réaliste, ni psychologique. Je me souviens qu’on se disait qu’il n’était pas nécessaire d’expliquer, que le théâtre, la mise en scène s’en chargerait. Je dis ça parce que nous avons un autre projet, Jean-Marie et moi, et qu’on a eu une discussion où cette même question revenait un peu : à savoir lorsque le metteur en scène et l’auteur sont présents dans un temps à peu près équivalents, l’idée de laisser des espaces non définis, non fermés, non finis, non expliqués au metteur en scène et aux acteurs, lesquels doivent bien entendu ensuite être traités et travaillés.
B. D. : La personne qui a donné naissance au projet, l’avez-vous rencontrée ?
I. P. : Je ne l’ai quasi pas rencontrée. Elle s’est tout de suite « jetée » sur Jean-Marie et a parlé trois heures avec lui. Jean-Marie m’a dit que c’était encore plus incroyable qu’il ne pensait, qu’elle a des histoires, des histoires, des histoires… et sans qu’on ne sache jamais très bien si c’est totalement vrai ou si elle invente ; c’est quelqu’un qui a un rapport très étrange à la réalité… J’ai voulu poursuivre l’entretien avec elle mais ça n’a pas été possible. Elle était assez insaisissable… (arrivait en retard, disparaissait…). Je ne crois pas qu’elle ait vraiment parlé du spectacle ; elle était contente de le voir et voulait rencontrer Jean-Marie, mais je ne crois pas qu’elle ait parlé à Laurence qui jouait son personnage.
B. D. : Cette expérience particulière a‑t-elle eu des répercussions sur ta manière de faire de la mise en scène ?
I. P. : Oui, d’abord de par toute la légèreté de l’entreprise. Peu de temps pour répéter, des moyens limités, très peu de temps dans l’espace de représentation ; tout ça a été finalement plutôt positif. En même temps, le fait pour moi que Jean-Marie ait créé les deux personnages, qu’il ait travaillé avec la présence imaginaire de l’acteur, tout cela a donné ensuite une espèce d’évidence dans le travail avec les acteurs. La circulation préalable entre lui et moi avant l’écriture, le fait qu’alors que l’écriture n’est pas finie existent des idées d’acteurs, tout cela rend l’écriture plus proche du désir du metteur en scène avant même que la mise en scène ne commence. Je l’ai senti et ça a produit une chose très harmonieuse et très coulante, quelque chose d’un peu naturel.
B. D. : Avez-vous l’intention de poursuivre cette expérience ?
- L’INSTANT, représenté à la Balsamine en décembre 2001. ↩︎
- « Bruxelles nous appartient » est un projet réalisé par Bruxelles 2000 visant à enregistrer des témoignages d’habitants sur leur appartenance à la ville et à constituer ainsi une banque de données, mémoire collective mise à la disposition des artistes en vue de leurs productions. Plus de 200 CD existent à ce jour. ↩︎