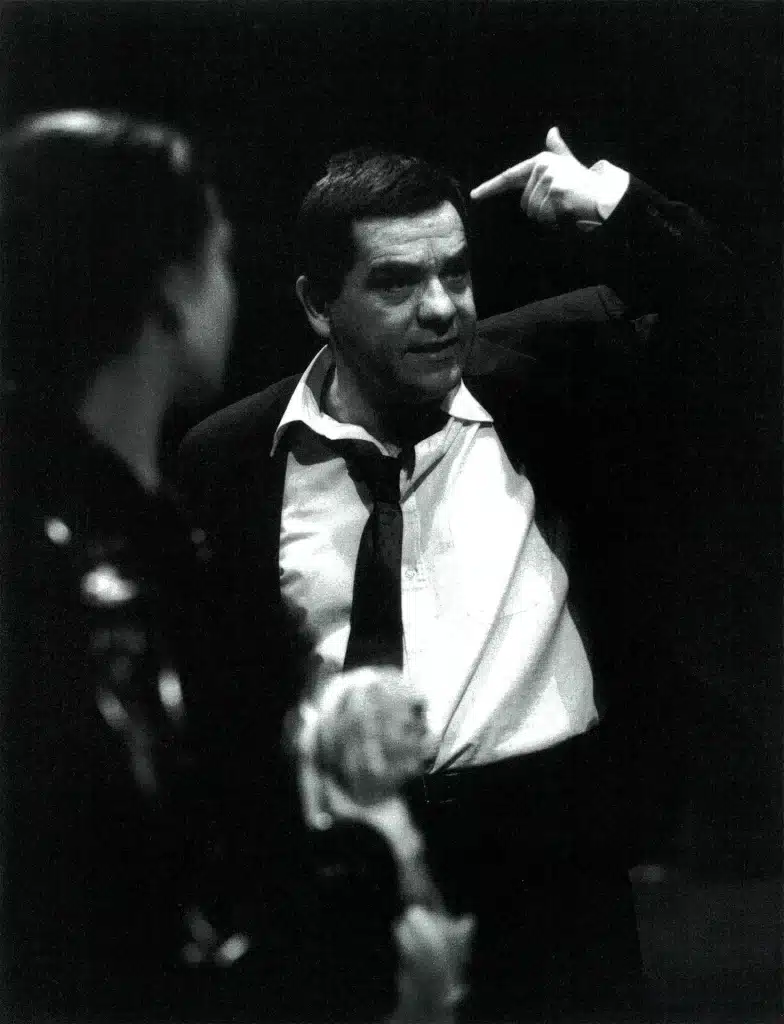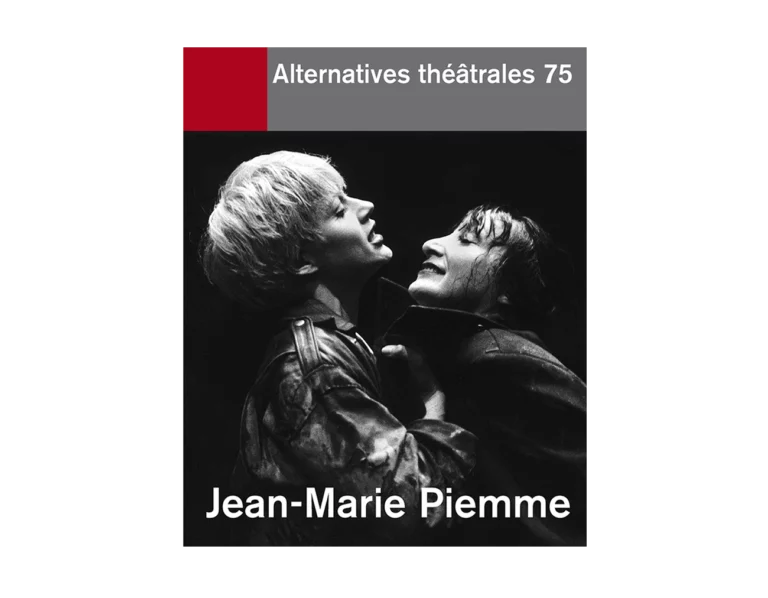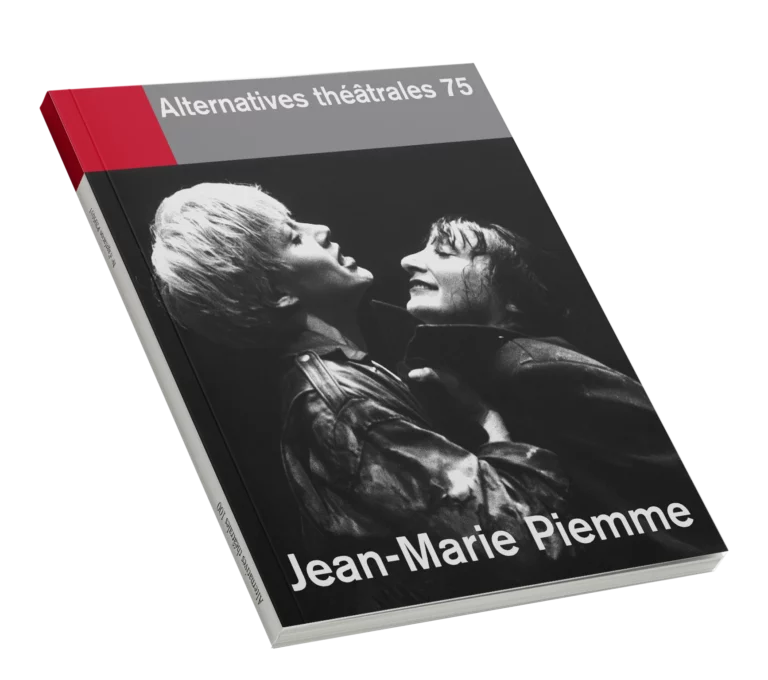POUR MOI, il n’est jamais aisé de théoriser après coup une expérience théâtrale, quel que fût l’accueil qui lui a été réservé. C’est encore plus complexe quand le spectacle a connu un grand succès. C’est un peu comme si je craignais de figer les choses, de diminuer l’aventure, voire de la gauchir. Avant d’entreprendre une mise en scène, j’aime à penser que je ne sais pas et après j’aime à dire heureusement. Je me livre cependant avec plaisir à l’exercice modeste du témoignage parce que Jean-Marie Piemme, l’homme et son écriture, ont été dans mon cheminement théâtral, dans ma pratique, une rencontre importante et riche.
Je connais Jean-Marie depuis pas mal de temps. Dès la fin des années 1980, il avait pris la bien bonne mauvaise habitude de m’envoyer ses écrits. Ami également de Philippe Sireuil avec qui j’avais étudié au début des années 1970 à l’Institut National Supérieur des Arts du Spectacle (INSAS) à Bruxelles, il m’a été donné de voir plusieurs réalisations à la scène des textes de Piemme. Mieux encore, j’ai eu l’occasion de me confronter en tant que comédien à sa langue dans Commerce gourmand coproduit par la Belgique, la Suisse et la France dans une mise en scène de Sireuil précisément. J’ai eu aussi l’occasion d’approcher cette écriture en conduisant un stage sur des extraits de six pièces à la Section Professionnelle d’Art Dramatique de Lausanne. En clair, depuis ce jour heureux où Jean-Marie a subitement abandonné son statut de dramaturge pour aborder les rives de l’écriture personnelle, j’ai été tenu au courant, j’ai eu le privilège de participer au voyage et j’ai compris très vite que quelque chose de fort venait de commencer.
C’est donc très logiquement qu’en 1995 j’ai reçu le manuscrit encore chaud de Les Forts, les faibles. Je l’ai lu dans les jours qui suivaient. Et ce fut un vrai coup de foudre.
L’écriture de Piemme m’arrive, m’interroge, me surprend et m’échappe. Depuis pas mal de temps, j’ai compris que les textes que je souhaite mettre en scène sont ceux qui me touchent, avec « une manière de mystère » et avec cette question : comment donner à voir et à entendre une telle œuvre ? Cela est-il seulement possible ? Il y a chez cet auteur une apparente simplicité, une dramaturgie qui paraît évidente et cependant très élaborée, un sens du fragment et de l’ellipse, mais surtout, surtout, aucune pédanterie. Piemme ne se perd jamais à donner des leçons, à affirmer un savoir que nous n’aurions pas, à afficher je ne sais quelle certitude, à moraliser d’aucune façon. Il a un point de vue clair sur le monde et les êtres, mais jamais il ne pose son interprétation comme une vérité première, au contraire. Lui non plus ne sait pas et c’est à mes yeux son plus grand talent et le carrefour de notre rencontre.
Les thèmes traités dans les pièces de Jean-Marie m’intéressent et me préoccupent. Mais avec Les Forts, les faibles, il abordait plusieurs questions qui me touchaient particulièrement. D’abord, comment essayer de comprendre la montée des idées d’extrême-droite en Europe et à travers le monde, au niveau des individus et non d’une quelconque analyse globale ? Ensuite, comment concilier le choc entre les passions et les opinions ? Enfin, comment vivre nos contradictions personnelles tout en essayant de reconstruire une apparente cohérence ? C’est dans ce sens que la pièce me parle le plus. Nous sommes tous plusieurs des personnages. Les préoccupations des neuf « figures » traversent chacun de nous, à un moment donné de notre histoire dans la grande Histoire, nous constituent et nous détruisent, nous valorisent ou nous pénalisent selon les moments, les modes, les interprétations que nous faisons du monde et des autres. Ce sont les contradictions qui font la vie. Le politique, c’est moi tout seul, dans ma tête et dans mon enveloppe charnelle, je suis le corps du délit et de la délivrance au milieu d’autres corps, le corps électoral par exemple. Si Piemme affirme une chose dans cette pièce, c’est celle-là. Pour le reste, il se garde bien des certitudes, il questionne avec curiosité et humanité, il ne répond ni n’accuse personne. A mon sens, c’est une œuvre fraternelle sans manichéisme aucun.
Les Forts, Les faibles, c’est une histoire bien racontée. La construction est efficace et apparemment très simple. Le dramaturge Piemme sait faire bon usage de ce que l’analyse des grands prédécesseurs lui a appris. Il procède par touches, par fragments.J’irais même jusqu’à dire par musicalité, au sens où il fait entendre une chose à un moment donné et trois scènes plus tard une autre qui résonne en sympathie. Il y a des espaces dans cette écriture, des silences, des oublis conscients, des contradictions travaillées, des générosités excessives, des violences vulgaires, et cependant toujours une véritable tendresse pour toutes les « figures ». En travaillant avec Sireuil en tant que comédien dans Commerce gourmand, j’avais eu l’occasion de me confronter à la langue de Piemme. C’est une expérience difficile et assez singulière. Il n’y a pas de « personnages » au sens classique du terme. Piemme ne cherche pas à reproduire au théâtre le langage du milieu social des protagonistes. On dirait que dans le texte qu’il nous livre, il a enlevé tous les cheminements psychologiques attendus. Il ne reste que ce qui fait mouvement de la pensée, action et réaction aux situations, aux discours opposés, à l’espace mental de l’autre. Il en résulte un théâtre dynamique, toujours en mouvement, toujours en prise directe avec l’axe central de la pièce.