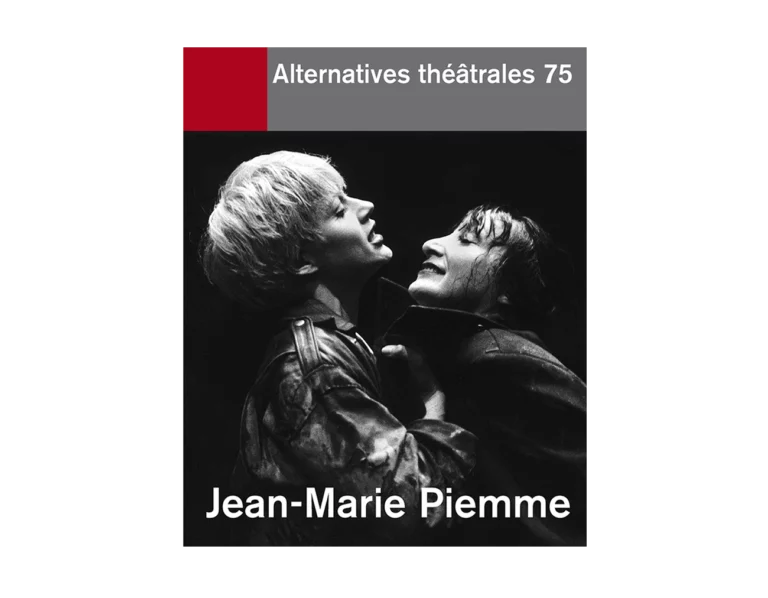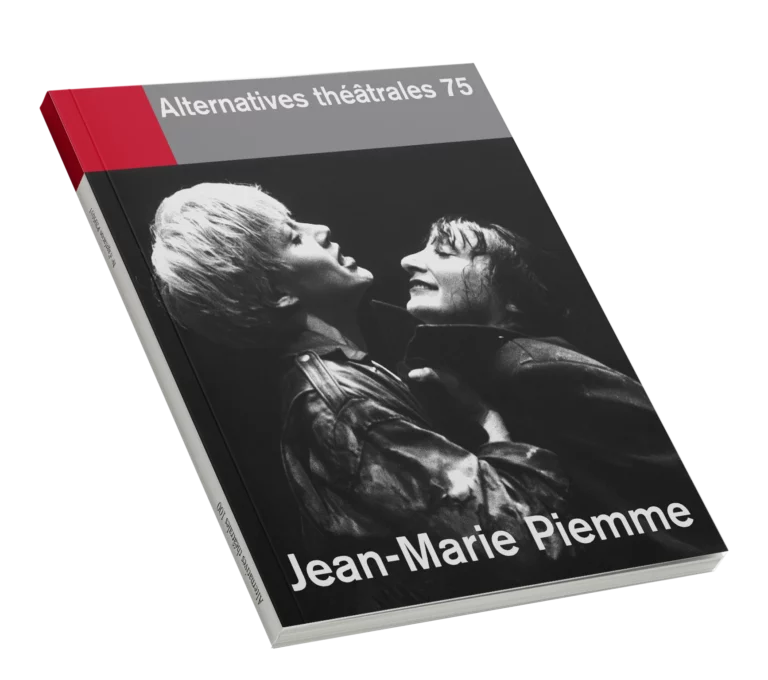Lorsque j’ai découvert LE TUEUR SOURIANT de Jean-Marie Piemme, ce qui m’a d’emblée intrigué était la forme de ce texte : sept pages d’une écriture serrée, rythmée par des paragraphes, sans autre indication de personnages que des caractères majuscules ou minuscules, avec pour seul indice d’une finalité théâtrale, un sous-titre : Texte pour plusieurs acteurs.
Ce texte impose une première approche « géographique », sa matière même oppose une résistance à une appréhension immédiate ou évidente. D’emblée, l’intelligence et la sensibilité du lecteur sont sollicitées pour pénétrer le corps de cette écriture. Bien loin de rebuter par son hermétisme ou un quelconque maniérisme, ce texte incite au jeu, dans tous les sens du terme.Jeu de piste pour en traquer les entrées possibles, plaisir de découvrir de nouvelles règles, et surtout, enjeux d’une appropriation et d’une interprétation qui préservent et restituent la richesse polysémique du matériau brut. A l’exigence de cette forme correspond la densité du propos.
Le TUEUR SOURIANT est un homme de 23 ans qui entre dans une banque avec une arme, prend des otages, tue quatre personnes, et qui, lorsque la juge lui demandé pourquoi il a « délibérément recherché la plus extrême des violences », ne peut que répondre : « Je ne sais pas ».
On identifie clairement le motif du « terroriste sans cause », de cette violence gratuite dont les médias renvoient régulièrement l’écho. Mais J.-M. Piemme pointe au-delà du fait divers l’intolérable de ces questions qui demeurent sans réponse, de cette part d’obscurité qu’aucun discours rationnel (politique, sociologique, psychologique) ne parvient à éclaircir.
Il s’attaque frontalement à ce qui nous échappe et se dérobe à toute explication rassurante. Il nous mène au bord du gouffre et nous confronte à « l’effroi du lendemain » .
Il choisit la reconstitution du braquage comme une mise en abyme du théâtre où chacun vient exposer, re-présenter « sa » réalité. Il donne la parole aux vivants comme aux morts, il donne à entendre le vrai comme le faux et dans cet enchevêtrement de témoignages, de pensées, de monologues intérieurs, il met le lecteur devant la responsabilité de se frayer son propre chemin. Et le metteur en scène devant celle de trouver un traitement qui restitue le vertige de cette écriture kaléidoscopique.
Le texte commence par : Une voix dit : … Avec V. Caye, ma collaboratrice sur ce spectacle, nous avons décidé de suivre à la lettre cette première indication et de nous efforcer toujours de coller au plus près de cette écriture, l’enjeu étant de la faire résonner sans jamais la charger de sens ou d’intentions qui en réduiraient le foisonnement.
Le narrateur, une jeune femme témoin et otage du braquage, raconte : elle est seule en scène, traversée par les voix et les images des vingt-cinq autres protagonistes de cette reconstitution. Nous avons fait avec quelques acteurs un travail d’enregistrement « radiophonique ». Avec d’autres nous avons fait de courtes séquences d’images vidéo. À chaque fois, nous nous attachions à la profération du texte plus qu’à son incarnation, dans le souci de donner à entendre et à voir, plus que d’interpréter. Avec A. Castellon, sur le plateau, nous avons travaillé dans le même sens, nous appuyant sur sa façon singulière de s’emparer des mots de Piemme et de les adresser au public, plus que sur une cohérence psychologique du personnage. Enfin nous avons confronté cet environnement sonore et visuel à sa présence sur scène. La mise en tension de ces différents niveaux de réalité produisait, je crois, une matière théâtrale suffisamment riche et ouverte pour que chacun puisse s’y engouffrer à sa guise.
Après cette première étape de travail, nous avons monté les deux premières parties du triptyque : LES NAGEURS et LA SERVEUSE N’A PAS FROID.. Initialement composé pour trois personnages Eva, Gloria et Léa, nous avons pris le parti, en accord avec Piemme, de faire traverser ces trois pièces par le même personnage : Gloria. Trois moments de son existence donc.
L’écriture évolue au fil des trois textes. D’un récit linéaire qui suit la chronologie des événements dans Les Nageurs, nous passons dans La Serveuse à une forme plus chaotique dont les cloisons structurelles et temporelles éclateront dans LE TUEUR.
Gloria nous raconte sa vie. Elle prend d’abord appui sur un dispositif technique qui pourrait être celui d’une conférencière : un micro, des photographies qui figurent les personnages de son histoire, des films qui la situent dans un contexte. Progressivement cette forme se dérègle, les cartes se brouillent. Son histoire la déborde, lui échappe. On sort des clichés pour arriver à l’intime. Les uns après les autres, elle arrache les écrans pour projeter les images (clichés) des personnages de son histoire sur les murs bruts du théâtre. Seule au milieu de ces spectres, son corps constitue l’ultime rempart, la seule réalité tangible attestant de sa présence au monde. Encore une fois, nous n’avons fait que nous adosser à l’écriture de Piemme en ce qu’elle nous raconte de notre quotidien et des moyens dont nous disposons pour le représenter.
POUR MOI, il n’est jamais aisé de théoriser après coup une expérience théâtrale, quel que fût l’accueil qui lui a…