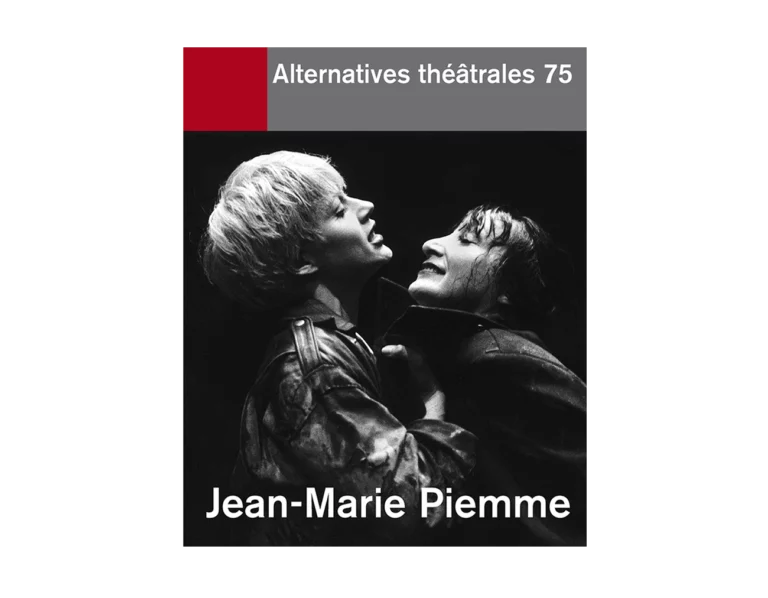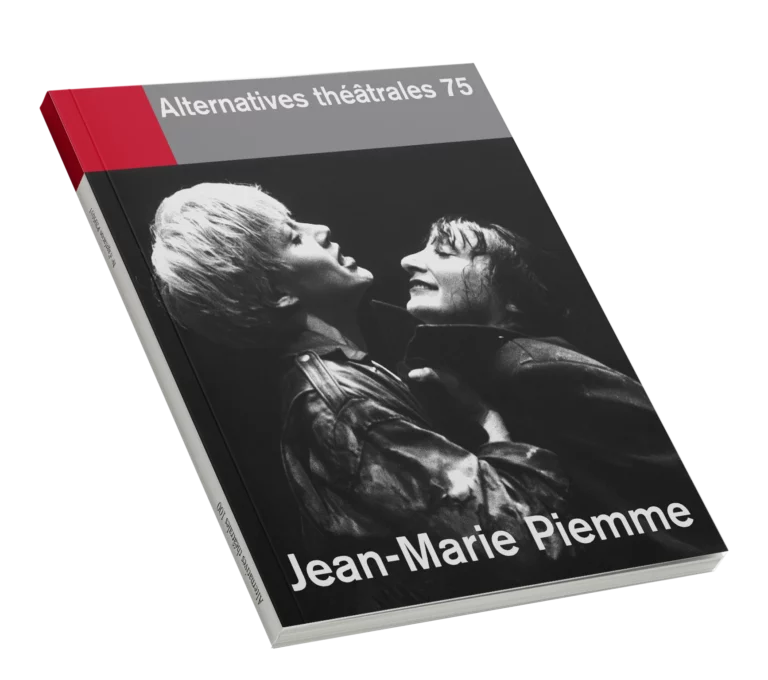LE DOS est le réduit inexpugnable, inaccessible au regard de chacun. Au début, lorsque le monde se présente encore embrumé et confus, nous commençons par découvrir les mains qui voltigent devant nous, sans savoir quelles nous appartiennent. Lorsque nous entrevoyons progressivement les choses qui nous entourent, peu à peu, nous découvrons la surface visible de notre propre corps ; et nous arrivons même à regarder les zones qu’avec le temps nous ne verrons plus. Avec l’âge, seule son élasticité permettra au contorsionniste de voir la plus grande partie de son corps. Mais le dos est en toutes circonstances comme la face cachée de la lune ; nous pourrons le voir inscrit sur une photo ou réfléchi dans un miroir. En réalité, nous ne pourrons jamais le voir. On établit ainsi, naturellement, la différence entre ce que je peux voir et ce que je ne peux pas voir de mon corps, encore qu’il soit à la vue de tous.
L’être vivant est une œuvre génialement dynamique et polysémique. Nous pouvons observer dans l’être humain des inépuisables combinaisons, rarement en consonance, entre l’intériorité, la gestualité, la sonorité des sons et le sens des mots. Cependant, il y a toujours des limites qui conditionnent le nombre de possibilités et surtout celle de ne jamais pouvoir voir notre dos, qui établit dès le départ un rapport dialectique entre ce que je peux voir de moi et ce que les autres eux seuls peuvent voir.
Tout au long de mon expérience théâtrale, je me suis aperçu que la représentation de la femme ou de l’homme en scène avait une dimension d’autant plus humaine que cette représentation avait recours au développement des relations dialectiques entre ce qui est exprimé explicitement ou implicitement par le corps. Ce que dit l’acteur se présente toujours comme dans la vie, dans une relation dialectique avec ce qu’il fait. Même si l’acteur n’en n’a pas la conscience, c’est ce qui arrive, quoique par le biais d’une forme subliminale et souvent cachée derrière la récurrence d’une posture dite du quotidien, qui ne prétend exprimer rien de particulier. Or l’acteur réussit d’autant mieux qu’il prend conscience de ce rapport dialectique. Être de dos, en scène, lorsque l’acteur s’exprime de face, crée un contraste qui devient énigme dans la mesure où il réfléchit le déséquilibre émotionnel et le doute et vient ainsi clarifier l’option dramaturgique qui prétend obtenir une meilleure crédibilité par sa façon d’agir.
L’acteur se voit à travers le regard du spectateur. Il représente mentalement ce qui est observable par le spectateur. Il peut et doit gérer les moyens qu’il a à sa disposition, dénonçant, ou non, ses intentions et contradictions.
Lorsque j’ai lu l’œuvre de Georges Banu, si pertinente et si bien documentée, je n’ai pas pu m’empêcher de me rappeler d’un spectacle qui, par coïncidence, avait beaucoup à voir avec cette thématique. Il me semble aujourd’hui, et après m’être confronté avec L’HOMME DE DOS, qu’à cette époque-là j’ai obéi à des présupposés dramaturgiques qui m’ont conduit davantage à une sorte de mise en place, plus qu’à une mise en scène. Peut-être parce que j’étais plus près de la structure dramaturgique d’un peintre que de la dramaturgie d’un spectacle. Je m’explique : dans NORA1, création que j’ai dirigée au « Théâtre‑O Bando » en 1988, il y avait un personnage qui, pendant plus d’une heure, se maintenait toujours de dos, bien qu’il se déplaçât en cercles. Quand, pour un motif précis, il devait se placer momentanément de face, il se couvrait le visage avec les mains. Il s’agissait d’une des innombrables versions des contes sur les deux frères, qui nous renvoient évidemment à Caïn et Abel, mais aussi à un conte égyptien2 qui date d’il y a environ 3 500 ans et à d’autres contes comme celui d’Amgiad et Assad des MILLE ET UNE NUITS3. Qui était alors ce personnage qui cachait son visage dans tous ces contes ? C’était la mère des deux frères. Au début, elle cachait son visage non seulement à la vue des spectateurs, mais aussi à tous les autres personnages présents sur scène. Après, peu à peu, elle perdait ses défenses devant ceux avec qui elle jouait. À la fin, et en brèves secondes, elle révélait son visage défiguré au public. Ainsi se manifestait son sentiment de culpabilité et sa douloureuse « réinsertion sociale ». J’ai la sensation que je n’ai pas exploré suffisamment, à ce moment-là, l’appropriation, par l’acteur, de la relation dialectique entre cette posture-là et la manifestation de ses affects. Si je me souviens bien, ce personnage se construisait plus comme un conteur moraliste que comme la représentation d’une personne capable de s’impliquer émotionnellement.
I. SI UN ENFANT ÉVEILLÉ ou un journaliste stupide me harcelait avec la question « Quel fut le plus grand…