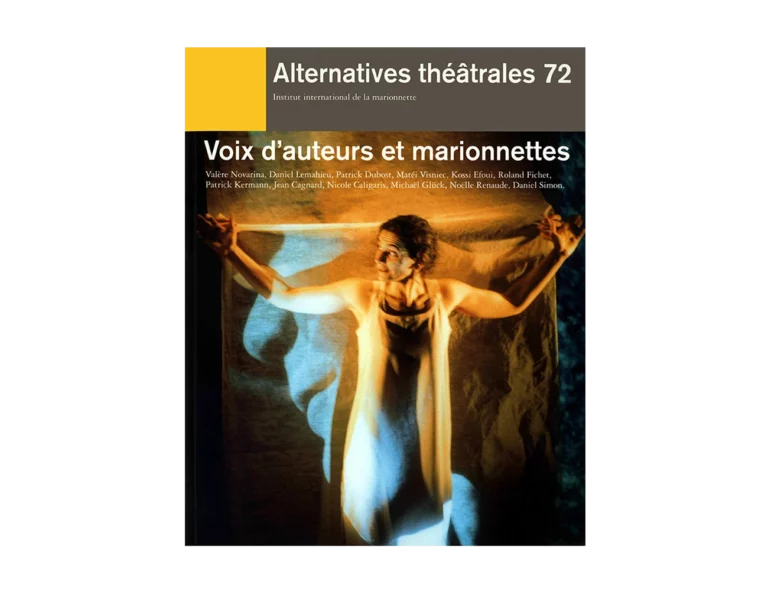« Il ME SEMBLE que l’art de la marionnette aujourd’hui est en corrélation étroite avec l’écriture théâtrale contemporaine » suggère Daniel Lemahieu en démontrant, derechef et non sans humour, la juste application de ses propos. Et Jean Cagnard, autre écrivain, d’affirmer à son tour par une image plus concise : « l’écriture et la marionnette sont deux sœurs ».
Cette forte connivence entre une tendance importante de la création contemporaine — au point nodal d’une expression artistique en plein renouveau — et les écritures francophones actuelles, prend suffisamment valeur d’exemple pour que l’ensemble de ce numéro, parrainé par l’Institut International de la Marionnette, se propose de lui donner un éclairage spécifique.
La double exploration, d’une dramaturgie et d’un mode de représentation, en correspondance avec l’actualité artistique immédiate (créations et recherches), sans prétendre à l’exhaustivité, donne largement la parole aux écrivains eux-mêmes. Elle offre un aperçu de leurs parcours et de leurs écritures, rend compte du travail théâtral de metteurs en scène aux personnalités contrastées et laisse transparaître en filigrane deux questionnements : Qu’est-ce que les auteurs contemporains disent à la marionnette ? Qu’est-ce que la marionnette dit à ces auteurs ?
Un faisceau de convergences
S’agissant d’un art que l’on a eu tendance à ranger (parfois hâtivement mais souvent à juste titre), depuis deux décennies, du seul côté rassurant de l’esthétisme muet, les repères seraient-ils en train de se déplacer ? Très certainement, à en juger par les préoccupations de jeunes compagnies représentatives telles que Trois-Six-Trente, Éclats d’États et le Là Où théâtre, en quête d’une morale de la forme que la fréquentation de dramaturges est la plus à même d’encourager.
Certains de leurs aînés présents ici (François Lazaro, Alain Lecucq, Sylvie Bâillon, Dominique Houdart, Joëlle Noguès) ont tracé cette voie — il faudrait bien entendu y ajouter l’ensemencement artistique d’Alain Recoing. Grâce à eux, comme en témoigne Daniel Girard, son directeur, la bien nommée Chartreuse « du Val de Bénédiction » de Villeneuve-lez-Avignon (Centre National des Écritures du Spectacle) a accueilli de fructueux laboratoires annuels réunissant auteurs et marionnettistes. Et l’association française des Théâtres de Marionnettes et Arts Associés (THEMAA) a pu, dans le même cadre, convier le public, la presse, les programmateurs, des artistes d’autres disciplines et des chercheurs, aux premières Rencontres nationales de la marionnette, en juillet 2001, autour des récentes créations inspirées par les voix contemporaines.
Les encouragements conjugués des diverses institutions évoquées par Didier Plassard dans sa contribution (Institut International de la Marionnette, THEMAA, revues Puck et Mâ), convergent à l’évidence en un véritable faisceau si l’on y ajoute les actions menées dans le même sens par le TJP — centre dramatique national — de Strasbourg, ou par le Théâtre de la Marionnette à Paris, et si l’on rappelle, pour préserver la juste mémoire d’un mouvement, qu’à la tête du Théâtre National de Chaillot, Antoine Vitez avait déjà commandé des textes pour marionnettes à Florence Delay, Danièle Sallenave et Michel Vinaver.
Montage et démontage
Si l’on excepte leur légitime — et néanmoins nouvelle — aspiration à dialoguer avec notre époque, qu’est-ce qui fonde le désir si manifeste chez les marionnettistes français de devenir passeurs de textes ?
La nature même de la dramaturgie francophone. Il suffit de parcourir les quelques extraits inclus dans ces pages pour en être convaincus. Par essence, art vivant du montage — et donc du démontage — la marionnette trouve un écho chargé de sens dans le traitement que les auteurs contemporains font subir à la langue. Délivrée des vieilles dépouilles de la poésie romantique ou symboliste, la scène marionnettique — avec ou sans castelet, avec ou sans marionnettes — offre à la parole inattendue une place laissée longtemps vacante.
Les rencontres humaines et artistiques, évoquées tout au long de ce numéro, viennent d’amener les auteurs à en prendre conscience et connaissance. Le terrain d’échanges entre matières et mots est donc maintenant ouvert.
Premier acte.