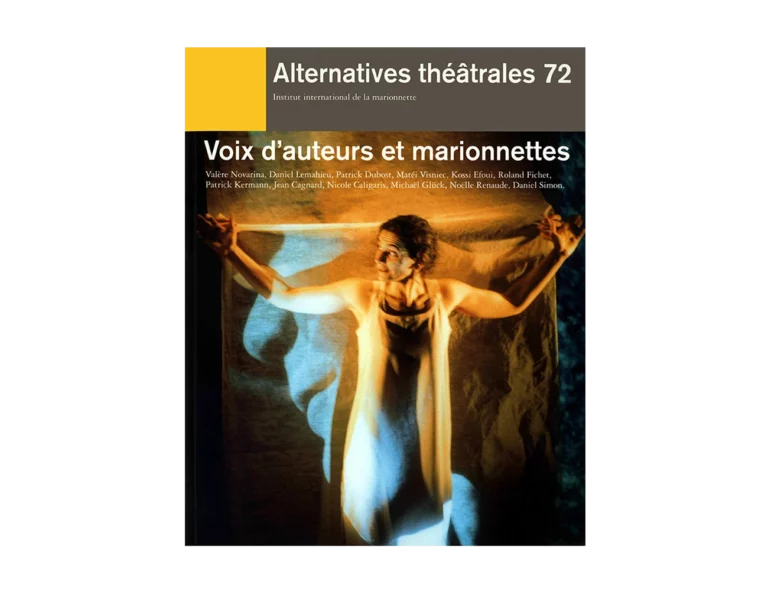QUAND ON ÉVOQUE le monde des marionnettes aujourd’hui, notre imaginaire collectif reste encore profondément nourri par l’imagerie de Guignol. Difficile de parler ou de réfléchir à propos de la marionnette sans que l’ombre portée de cette mythologie populaire ne vienne obscurcir, ou rétrécir, toute possibilité d’invention ou d’avenir. Ceux qui fabriquent, animent et manipulent ces êtres sans vie, qui nous font rêver qu’ils en ont une, sont pourtant de plus en plus nombreux à penser que leur art parle à tous, et pas seulement aux enfants, et pas même à la part enfantine qui sommeille en chacun de nous.
Sans doute les metteurs en scène de théâtre, tout au long du XXᵉ siècle, avaient senti la force créatrice que la marionnette pouvait apporter à leur art : Artaud, Craig, Meyerhold, Kantor, Mnouchkine, Tanguy, Gabily, Novarina, de nombreux concepteurs de l’art scénique du XXᵉ siècle ont senti que les marionnettes pouvaient les aider à ressaisir la force vitale de leur plateau. Sous la forme de textes théoriques ou dans des spectacles-manifestes, ces inventeurs de la scène moderne doivent beaucoup à l’art des mannequins.
D’où cette question : que lui ont-ils trouvé, à la marionnette, si celle-ci reste fortement engluée dans un imaginaire traditionnel, et essentiellement répétitif, pour ne pas dire « conservateur » de formes ? Comment comprendre que les plus grands innovateurs ont puisé là leurs innovations les plus décisives ? On peut répondre, d’une formule, que la marionnette, abandonnant ses fonctions sociales immédiates, a trouvé dans l’élément du théâtre un nouveau terrain qui l’a complètement métamorphosée. Au plus loin des figures conservatrices du monde de l’enfance, elle s’est mise à pouvoir poser des questions au théâtre — des questions que celui-ci ne pouvait formuler par lui-même. La révolution théâtrale qui s’opère au XXᵉ siècle avait absolument besoin de trouver des alliés efficaces pour battre en brèche le réalisme et la psychologie incarnée. Les êtres inertes et sans âme ont servi de précieux auxiliaires pour dépouiller les scènes européennes de ces scories insistantes. La marionnette a en effet une double valeur morale indiscutable : elle ressemble parfaitement à l’être humain — dispensant du coup celui-ci de toute corvée d’imitation réaliste. Elle est par ailleurs capable d’une perfection mécanique que l’homme n’a pas à vouloir égaler. Dans les deux cas (et on peut les penser ensemble, ou séparément), le théâtre gagne tout à déléguer aux marionnettes cette tâche ingrate et nécessaire de l’imitation rigoureuse. Il lui reste alors l’espace, nouveau et complètement en friche, d’une invention de figures en dehors de toute velléité réaliste ou psychologique. Déléguant ce soin à la marionnette, l’acteur se réapproprie alors le soin de toutes les folies. L’être inerte imite (le vivant) pendant que l’acteur (en vie) l’élargit.
Ce détour par l’art de la mise en scène théâtrale est nécessaire pour comprendre ce qui arrive aujourd’hui à l’art de la marionnette. Un siècle plus tard, celle-ci se trouve confrontée aux mêmes questions : comment devenir moderne ? Cette question, si simple en apparence, n’en est qu’à ses premiers balbutiements. Mais le processus semble fermement engagé. Les marionnettes ont quitté le guignol de leur enfance. Elles cherchent d’autres voies, d’autres mots pour dire ce qui fait ce monde-ci. Elles assument clairement de pouvoir en dire quelque chose entre adultes. En dire quelque chose, creuser un sens en dehors des facilités infantilisantes. C’est là le nœud sensible. On sent bien, depuis quelques années, que l’écriture peut, parmi d’autres moyens, permettre ce nouveau développement. De nombreux marionnettistes se posent en effet la question du matériau textuel de leurs spectacles.
Traditionnellement, le texte est considéré par les marionnettistes comme un élément secondaire dans le processus de création. Le cœur de leur travail se situait plutôt dans la conception et dans la fabrication des êtres à animer. C’est la conception et la fabrication des poupées qui semble littéralement énoncer, dicter ce qu’il y a à dire. Mais ce qu’ils disent et comment ils le disent, voilà deux questions qui sont restées longtemps complètement secondaires. C’est sur ce double terrain que les choses commencent à changer — la « dramaturgie » et le « jeu » commencent à devenir de réelles questions.
La marionnette est en train de recevoir du théâtre (et du théâtre de texte) ce qu’elle lui avait donné, un siècle auparavant. Là où la marionnette avait permis la fondation des bases de la mise en scène moderne au théâtre, il apparaît de plus en plus que le texte dramatique est en train de jeter les bases d’une nouvelle conception du monde des êtres inanimés. Après tout, rien de plus évident. Pourquoi des êtres de chiffon, papier, acier, os ou bois ne pourraient-ils pas exister pour dire un texte futur, pour dire un texte par eux et pour eux voulu, comme cela arrive dans le monde du théâtre (malheureusement trop rarement — la mise en scène reste encore un art hégémonique et peu ouvert aux nouvelles écritures) ? L’invention du poème est alors consubstantielle à la création des marionnettes. On dit parfois que les marionnettistes sont les derniers des démiurges, créateurs de monde qu’ils façonnent entièrement à leur image, ultime avatar de dieu dans un monde partout laïcisé. Prenons l’image au mot. Si le marionnettiste est un démiurge, sa création doit bien naître d’un verbe. C’est à ce prix, dans notre Tradition, que les mondes se créent…
L’irruption du texte dans le monde des marionnettistes ressemble vraiment beaucoup à celle du mannequin dans l’univers des metteurs en scène du théâtre d’art. Dans les deux cas, on sent bien que c’est le corps étranger, le moins attendu, le plus éloigné, qui peut, justement, faire avancer le travail. Tout reste encore à faire. On sent bien que les rencontres sont à venir. Mais pourquoi ne pas imaginer que de grandes écritures dramatiques nous viendraient précisément de ces scènes-là ?
UNE ÉCRITURE pour la marionnette devrait être aussi naturelle qu’un texte pour le théâtre, ou alors serait-ce suffisant d’agiter un…