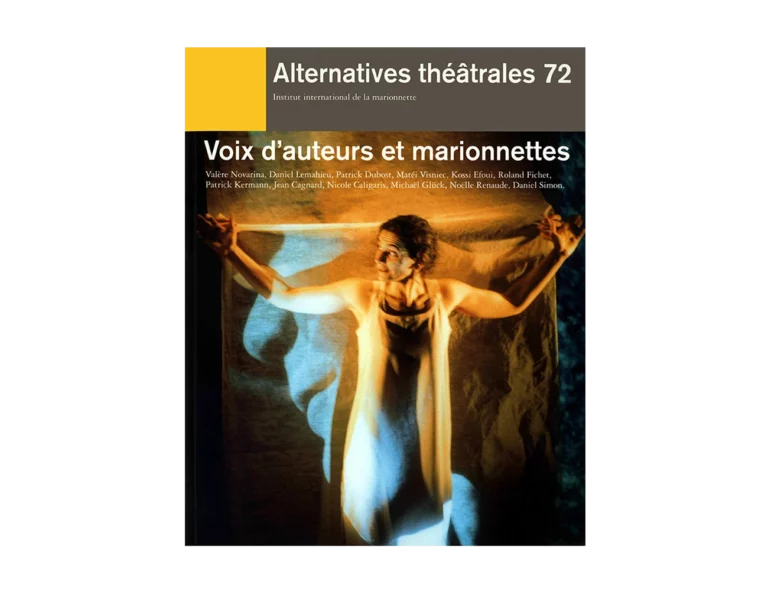Le plus beau de nos mythes n’est ni Faust ni Don Juan, mais le mythe de Pinocchio.
Valère Novarina
ATTENDU DEPUIS LONGTEMPS, anticipé par quelques rares explorateurs tels que Dominique Houdart et Jeanne Heuclin dans leur longue collaboration avec Gérard Lépinois, ou bien François Lazaro dans son dialogue avec Daniel Lemahieu, préparé par des articles1, des rencontres, des ateliers2, le rapprochement du théâtre de marionnettes et des nouvelles écritures théâtrales de langue française est devenu aujourd’hui une réalité de plus en plus perceptible, de mieux en mieux partagée. Nul doute, à ce point, que le rôle pionnier d’institutions telles que l’Institut International de la Marionnette à Charleville-Mézières ou, plus récemment, THEMAA et le Centre National des Ecritures du Spectacle à Villeneuve-lès-Avignon, doit être considéré comme l’un des facteurs déterminants de cette évolution : en effet, l’éclatement et la fragilité endémiques des compagnies de marionnettistes, réfugiées massivement sur le terrain de l’adaptation ou du montage quand elles ne composent pas elles-mêmes leurs textes, ne les prédisposent guère à l’expérimentation d’écritures plus exigeantes ; et, lorsqu’elles s’y risquent de leur propre initiative, la frilosité des programmateurs à l’égard des auteurs immédiatement contemporains contribue assez peu à les encourager. Le changement que nous voyons s’amorcer résulte donc bien d’une politique volontariste de formation, de commande, d’invitation, de mise en relation d’individus et d’expériences, au terme de laquelle il faut espérer que s’établira une relation plus mature entre écrivains et marionnettistes, et que cesseront les pratiques encore trop répandues de l’emprunt inavoué, de l’accumulation hétéroclite et de toutes les formes du bricolage des matériaux textuels.
Entrée des auteurs
Observée depuis l’étranger, ou bien simplement dans l’oubli de l’histoire récente de la scène française, une telle situation apparaît sans doute difficilement compréhensible, et les enjeux d’une entrée des textes de Didier-Georges Gabily, Philippe Minyana, Roland Fichet, Kossi Efoui, Valère Novarina3 au répertoire de ces compagnies ou sur le terrain de ces expérimentations risquent d’être insuffisamment perçus. En effet, il ne s’agit pas seulement, pour les marionnettistes (même si par ailleurs cet objectif n’est toujours pas atteint), d’acquérir une plus grande légitimité symbolique et une meilleure visibilité institutionnelle en s’affranchissant des territoires exigus de l’enfance ou du folklore à l’intérieur desquels on tend régulièrement à les renfermer. Ce qui est en jeu dans la rencontre du théâtre de marionnettes et des écritures contemporaines intéresse aussi et au premier chef ces dernières, dans leurs dimensions artistiques particulières. Pour des raisons historiques qu’il serait trop long de développer ici, mais au nombre desquelles il faut au moins compter la démolition systématique des codes dramaturgiques conduite par les auteurs des années 1950, ainsi que la prise de pouvoir exclusive des metteurs en scène au cours des deux décennies suivantes4, l’écriture théâtrale de langue française a pu, de 1965 à 1985 environ, paraître asthénique aux yeux de l’observateur pressé ou inattentif, et la profession d’auteur dramatique sembler tomber dans l’oubli. Jusqu’au début des années 1990 encore, journaux et magazines continuaient de consacrer des dossiers ou des éditoriaux sur le thème largement rebattu de la disparition des auteurs5, et un jeune metteur en scène pouvait déclarer :
Il y a très peu de grands auteurs par époque. Sur la période de Tchékhov, eh bien… il y a Tchékhov ! Après viennent Brecht, puis peut-être un ou deux autres. Aujourd’hui ? Heiner Millier, Thomas Bernhard… Peut-être pas plus que ça. Mais ça n’est pas grave. On a toujours assez de matière avec toute la littérature théâtrale. Hauteur de théâtre dans le sens classique est une notion qui n’a peut-être plus beaucoup de sens aujourd’hui.6

De manière paradoxale, c’est dans ce contexte général d’indifférence ou de soupçon à l’égard de l’écriture théâtrale contemporaine qu’une nouvelle génération d’auteurs, qui s’impose progressivement à partir du milieu des années 19807, s’engage sur la voie d’une radicalité esthétique et d’une poéticité où aucune dramaturgie (celles de langue allemande exceptées) ne s’est à la même époque aussi massivement aventurée. Le primat de la fable, la restitution réaliste (voire naturaliste) des modes de vie contemporains, l’engagement politique ou social explicite, ces dimensions essentielles de la création théâtrale d’aujourd’hui chez la plupart de nos voisins européens sont ici comme suspendues au profit d’une double exploration : celle des pouvoirs de la langue, ou plus exactement de la parole, d’une part ; et celle des protocoles de la représentation, d’autre part.
L’une et l’autre de ces explorations empruntent les chemins les plus diversifiés. Toutes deux, cependant, partent d’un même refus : celui du laminage de la langue et de l’imaginaire sous la pression des modèles que véhiculent les média. Du côté de la parole, ce peut être le débordement du personnage par une mémoire qui le submerge, la faille qui se dessine entre le réalisme de la situation dramatique et le développement lyrique du dialogue, la découpe en vers libres de la phrase, les distorsions syntaxiques et les néologismes, l’entrelacement des registres expressifs, des parlers régionaux et des langues. Du côté de la représentation, on observe par exemple la dislocation du texte en fragments narratifs, dramatiques et lyriques (ce que Jean-Pierre Sarrazac, dans L’AVENIR DU DRAME8, nomme la rhapsodisation des écritures contemporaines), la transformation des didascalies en narration subjective, la non-attribution des répliques et, de façon générale, tous les procédés par lesquels l’auteur, loin de faciliter le passage au plateau, semble au contraire multiplier les obstacles ou les défis à l’ingéniosité du metteur en scène.
Ceci établi, en quoi pouvons-nous supposer que ces textes intéressent le théâtre de marionnettes, et sur quelles bases spécifiques la relation naissante entre les marionnettistes et les auteurs d’aujourd’hui s’est-elle construite ? Il ne s’agit évidemment pas, ici, d’apporter une réponse générale et définitive à ces questions, mais plutôt d’esquisser des hypothèses de réflexion capables de les éclairer à partir de quelques propositions artistiques récentes.