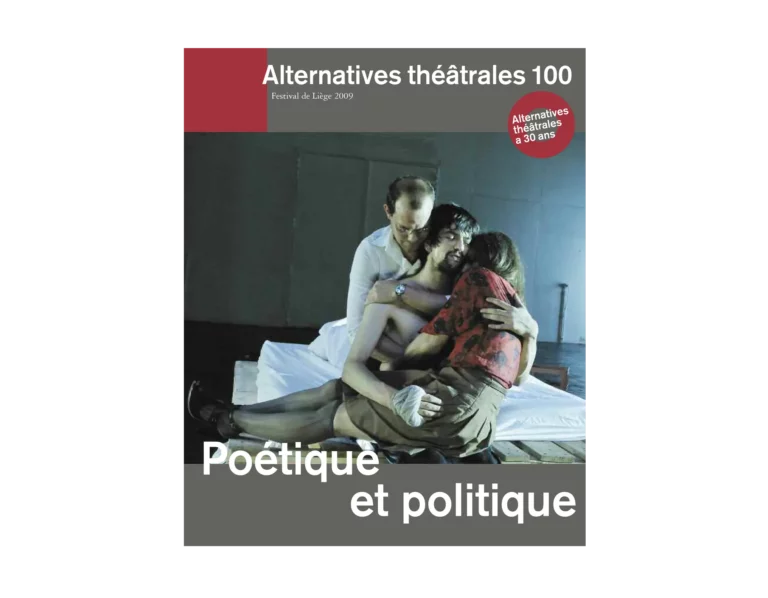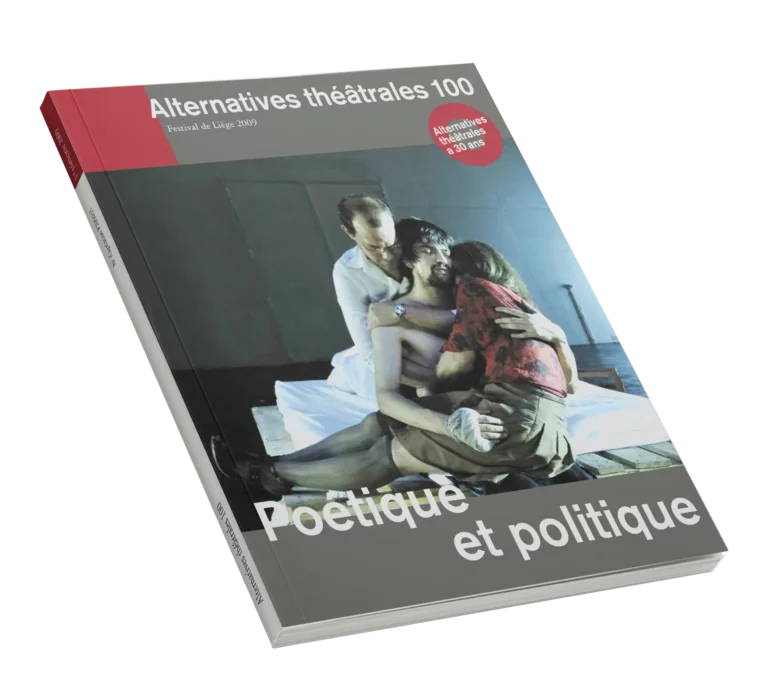LE GARÇON a choisi la mort. Et alors ? On s’en fout, non ? Les deux dames qui composent le chœur s’amusent comme des folles en relatant l’histoire du blanc-bec qui s’est effondré, malade et épuisé, lors d’une expédition en montagne, et qui a choisi d’être poussé dans l’abîme pour ne pas empêcher les autres de continuer leur course. Bien sûr, par bienséance, il faut d’abord lui témoigner un peu de compassion, mais on entend très vite sauter les bouchons de champagne et rigoler au bar. Après tout, c’est sa faute s’il prend la solidarité à la lettre. Dans le capitalisme des bêtes sauvages, les animaux grégaires survivent rarement. Un perdant de plus ou de moins – qu’est-ce que cela peut bien faire ? L’important, c’est de rouler soi-même sur l’or.
Ainsi s’achève CELUI QUI DIT OUI 1de Bertolt Brecht dans la mise en scène sarcastique de Frank Castorf et CELUI QUI DIT NON continue dans le même style hargneux. Comment faire un choix libre sans perdre son esprit révolutionnaire ? C’est la question que pose Brecht dans cette double pièce. Comme dans LA DÉCISION2 qu’il a mis en scène récemment, ce matériau dramaturgique permet au directeur de la Volksbühne de présenter tous les abîmes qui s’ouvrent à l’homme lorsqu’il doit choisir entre l’individu et la collectivité, la vie privée et la camaraderie, l’hédonisme et l’obédience au parti sans oublier l’utopie d’un monde meilleur et les principes révolutionnaires qui, nous le savons aujourd’hui,
ont échoué. Si ces deux courtes pièces didactiques (plus exactement deux opéras d’école) sont d’inspiration marxiste, elles sont moins dogmatiques que LA DÉCISION, ce qui a permis a Castorf d’ôter à ces fables leur aspect scolaire.
Le metteur en scène a choisi de faire du garçon un confirmand un peu gauche, tête frisée et épaules tombantes, la victime personnifiée. Le pas rapide et l’énergie débordante du professeur réduisent très vite le garçon au rôle de bille de flipper sur une scène presque vide : quelques chaises en plastique, deux tabourets de bar et une cabane en planches. On ne peut penser que ce pauvre pantin agité par des pressions qui lui sont extérieures puisse prendre une décision par lui-même ; c’est pourtant lui qui est le pivot et la cheville ouvrière de la fable.
Afin de procurer un médicament à sa mère mourante qu’on voit de temps à autre apparaître sur la scène, traînant son corps exsangue saisi de convulsions épilep- tiques, le garçon souhaite se joindre à une expédition en montagne organisée par le professeur pour ses trois étudiants3 .
Le professeur fixe le visage pâle du « camarade » d’un œil hagard. Cela suffit à faire comprendre que ce n’est pas une bonne idée et que l’ascension ne sera pas sans danger. Mais le garçon ne veut pas en démordre et, finalement, le professeur et sa « collectivité » d’étudiants l’entraînent d’un côté à l’autre de la scène en tournant bêtement en rond – une image qui rappelle des scènes que Castorf a déjà utilisées dans sa mise en scène de NORD de Louis Ferdinand Céline pour évoquer la bêtise des masses endoctrinées.
Malgré tous ces efforts déployés et réunis, il arrive ce qui devait arriver : le garçon s’écroule, à mi-chemin, complètement épuisé. Que faire ? Tout le monde doit-il faire demi-tour et interrompre l’expédition pour sauver un seul individu ? Ou bien, pour pouvoir continuer
et accomplir la mission, doit-on abandonner le garçon à son sort et le conduire à une mort certaine ?
Ce sont des questions délicates auxquelles personne ne peut répondre spontanément et l’homme – cet animal grégaire – se trouve des arbitrages – divin ou juridique ou, comme c’est le cas ici, mythique : une tradition ancestrale que l’on pourrait appeler plus prosaïquement la morale révolutionnaire.
« Écoute bien », hurle le professeur dans l’oreille du garçon, comme s’il crachait son sermon du haut d’une chaire : « Comme tu es malade et que tu ne peux pas continuer, nous devons t’abandonner ici. Mais il est juste que l’on demande à celui qui est tombé malade si l’on doit faire demi-tour pour lui. Et il est d’usage aussi que celui qui est tombé malade, réponde : vous ne devez pas faire demi-tour. » Comme dans LA DÉCISION, on demande à celui qui échoue dans l’entreprise collective s’il accepte qu’on agisse selon les principes de la collectivité. Cette morale révolutionnaire étant le sujet principal des premières pièces didactiques de Brecht, il est étonnant qu’après avoir écouté cette leçon d’obéissance au parti, le garçon reste muet. Dans la mise en scène de la Volksbühne, il fixe d’un œil hagard la caméra portable et son visage vide est projeté, agrandi, sur les écrans vidéo disposés à droite et à gauche de la scène. Est-ce là le visage d’un camarade qui a compris sa leçon ? Ce regard fixe et le silence est plus éloquent que les mots que le garçon pourrait prononcer…