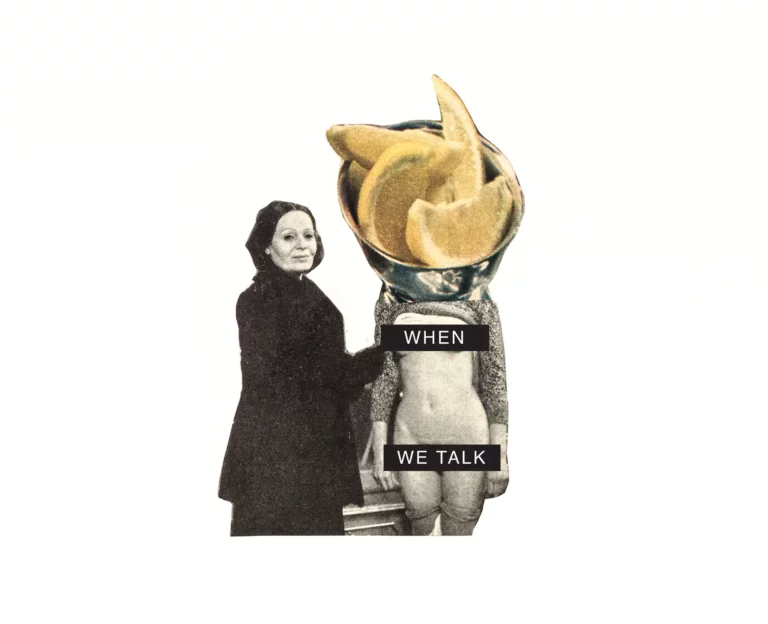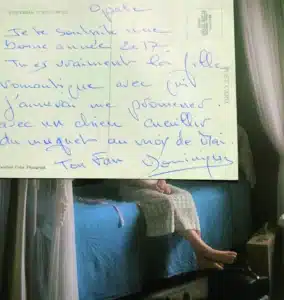On ne peut réduire le sexisme aux seuls actes d’intimidation sexuelle. Prenez le monde de la danse : de l’éternel retour de la nymphette sur nos scènes, aux abus de pouvoir en coulisse et à la nudité banalisée dans les auditions, les danseuses ont des choses à dire sur les répercussions d’une réalité professionnelle qui favorise et profite de limites peu claires.
« La seule différence avec les travailleuses du sexe, c’est que nous, nous pouvons nous cacher derrière le mot art. »
En mai dernier, j’ai reçu une bourse du gouvernement flamand pour mener une recherche sur le sexisme dans le monde de la danse en Belgique.
Je suis moi-même danseuse et, dans le cadre de mes recherches, j’ai commencé à interviewer des collègues féminines qui ont effectué la majeure partie de leur carrière en Belgique.
J’ai débuté chaque entrevue en posant une question très ouverte :
Avez vous parfois le sentiment d’être traitée différemment parce que vous êtes une femme ?
« Lors d’un moment improvisé sur scène, l’un des acteurs masculins m’a soudainement embrassée. L’idée selon laquelle il convient de “suivre ses impulsions” en situation de spectacle est en soi tout à fait recevable, mais l’option du baiser n’avait jamais été discutée pendant les répétitions. J’étais encore stagiaire et, parce que je m’étais déjà attirée des ennuis pour avoir observé que les rôles féminins de la pièce étaient trop succincts, j’ai décidé de ne pas parler… À mesure des représentations, le danseur se permettait des gestes toujours plus déplacés. D’abord un sein, puis une fesse… Ce qui est particulièrement pénible dans ce genre de situation, c’est qu’au lieu de pouvoir se consacrer à son travail d’interprète, on ne cherche qu’à esquiver les gestes inconvenants d’un partenaire, et ce, devant un parterre entier de spectateurs. »
Pourquoi cette discussion a t‑elle été gardée si longtemps sous silence ?
En posant cette question ouverte, je souhaitais instaurer un climat de confiance, afin d’appréhender nos carrières de notre point de vue de femme, sans crainte d’être jugées. Je souhaitais créer un espace où le sentiment d’injustice que nous avions pu éprouver dans certaines situations discriminantes puisse être accueilli et entendu. Ces conversations ont révélé un très large panel de gestes déplacés en tout genre et de gravité variable, allant de comportements subtilement inconvenants, à des exemples flagrants d’habitudes manipulatrices et abusives profondément enracinées.

Nous avons parlé d’espace, d’éducation, d’opportunité, de représentation, d’attente, d’intimité, de dynamique du pouvoir, de maternité et d’intimidation sexuelle. Et la question s’est imposée d’elle-même : Pourquoi cette discussion a‑t-elle été gardée si longtemps sous silence ?
« Quand j’ai commencé à réfléchir à cette interview, à mon travail de danseuse et aux questions d’inégalité, j’ai eu la sensation physique que de la vermine sortait de moi-même. Comme si je venais d’ouvrir une boite de pandore qui serait désormais impossible à refermer. La perspective même d’aborder ces questions était tout à fait perturbante ; cette posture critique risquait en effet de m’amener à une vision très négative de ma profession. »
Les problèmes de harcèlement sexuel sont depuis quelque temps sur le devant de la scène médiatique, en Belgique et dans le monde, dans des domaines professionnels très différents ; en sport, en politique, dans l’industrie du divertissement.
Alors qu’à travers le monde les femmes ont commencé à utiliser #metoo sur les réseaux sociaux pour témoigner de leurs mésaventures, mon projet a connu un regain d’intérêt. Les réactions mondiales massives sur ces questions montrent à quel point sexisme et misogynie imprègnent le tissu social. Le monde politique en Belgique a pris conscience de ces problèmes et envisage aujourd’hui d’inclure le domaine des arts de la scène dans sa législation et prévenir ainsi les problèmes d’intimidation sexuelle sur les lieux de travail.
Ces nouvelles régulations sont indéniablement à saluer mais elles restent souvent purement symboliques ; des cache-misère qui ne s’attaquent pas assez au cœur du problème.
L’inégalité des chances entre les hommes et les femmes apparaît dès le début des études chorégraphiques.
« Tout est plus facile pour un homme sur le marché de la danse. C’est la réalité, il faut le dire haut et fort. Pour donner quelques exemples : il existe un mythe selon lequel l’homme peut commencer la danse plus tard, car il est physiquement plus capable, et plus apte à progresser rapidement. Les femmes, au contraire, sont encouragées à commencer le plus jeune possible. Il est aussi communément admis que l’homme est le chorégraphe, et la femme, la danseuse. Une femme chorégraphe sera aisément confondue avec la “simple” danseuse, tandis que le technicien sera pris pour le chorégraphe. Et la fable du génie, (toujours masculin) et de sa muse, (évidemment féminine) est encore très actuelle. Les femmes ne sont pas envisagées comme des auteures à part entières, mais comme des sources d’inspiration disponibles, prêtes à être utilisées ou exploitées. Ceci nous amène à poser les questions suivantes : Qui jouit des opportunités ? Qui participe ? À qui reviennent les fonctions de direction et de pouvoir ? Pourquoi, enfin, tant de collaborations artistiques reposent-elles sur cette dynamique genrée du pouvoir ?»

Les inégalités en terme d’opportunité apparaissent dès le début du parcours d’une danseuse, au tout début de sa formation. Les danseurs étant moins nombreux, ils sont naturellement confrontés à moins de compétition, jouissent d’un espace plus grand sur la scène chorégraphique, et accèdent ainsi plus rapidement aux fonctions « importantes ».
Vue sous cet angle, la situation semble se résumer à une simple question d’offre et de demande. Mais la réalité est loin d’être aussi simple que cela. Dans une industrie traditionnellement associée au « féminin », force est de constater que, pour occuper une position de pouvoir ou tout simplement faire son travail, il faut soit être un homme, soit être une femme à la personnalité forte et masculine.
« Il existe une habitude culturelle qui consiste à fétichiser notre corps de danseuse. Il semble que les choses soient en train d’évoluer, mais pour l’heure, voici comment la génération dont je fais partie à appris le métier de danseuse : en se regardant dans un miroir tous les jours. C’est une façon très particulière de vivre sa jeunesse, qui plus est pour une femme. Ceci ayant souvent pour conséquence des comportements maladifs tels que troubles de l’alimentation, rapport obsessif à l’entrainement, besoin permanent de discipliner son corps, volonté d’être un corps désirable, etc. »
Le métier de danseur n’est pas un métier « normal ». Notre profession est intrinsèquement liée à notre corps. La chose « corporelle » relève de l’ordre du « privé » dans la majorité des autres professions. Cette coïncidence du privé et du professionnel constitue en soi un point de tension tout à fait crucial et problématique dans notre métier. Les danseurs et les performeurs mettent, littéralement, leur corps au service de leur art, et, le plus souvent, au service des souhaits d’un chorégraphe.
Il est attendu du danseur professionnel qu’il veuille outrepasser ses limites physiques, émotionnelles et psychologiques. Ce réquisit tacitement admis peut très vite amener les danseurs à se retrouver dans des situations extraordinairement fragilisantes. Travailler sous la direction d’une personne qui n’a pas conscience de ce risque, ou pire, qui joue et jouit du pouvoir que sa position lui donne, peut amener le danseur à vivre des situations particulièrement pénibles d’irrespect, d’humiliation, de brutalité psychologique.
« Ce qui était vraiment malsain, c’est que le chorégraphe voulait que je fasse le sound check sans mes vêtements. »
« Il y a encore une chose que je souhaiterais ajouter. Quelque chose de particulièrement déstabilisant. Dans un spectacle, j’étais censée chanter une chanson en culotte. Avant chaque spectacle, nous devions faire le sound check. Ce qui était vraiment malsain, c’est que le chorégraphe voulait que je le fasse sans mes vêtements. C’était tellement gênant d’être là debout, avec les lumières de service, au milieu des techniciens occupés à faire le montage. Il n’y avait aucune raison valable de procéder ainsi. Si j’essayais de faire le sound check habillée, il me disait : non, retire tes vêtements. C’était tellement… comment dire… abusif. »
Ce que les danseuses évoquent très souvent, c’est le sentiment désagréable d’être utilisées comme des objets sexuels dans les spectacles. Il sera souvent demandé à une jeune femme de jouer nue, ou presque nue, de jouer « la jeune fille naïve » et/ou sexy, d’incarner une jeune hystérique ou autre Lolita. Ce qui revient comme une rengaine, c’est que ces femmes ne se permettent jamais d’évoquer leur gêne de peur de s’entendre dire qu’elles ne sont pas professionnelles, qu’elle sont « prudes », ou qu’elles ne conviennent tout simplement pas au travail pour lequel on les a engagées. J’ai été très surprise de réaliser que je n’étais pas, et de loin, la seule danseuse à qui un artiste bien plus âgé avait généreusement expliqué qu’elle devait « embrasser le pouvoir de sa sexualité féminine », et « se libérer de ses peurs sexuelles ».
La manie du fantasme sexuel à l’endroit des jeunes filles est un fait très peu remis en question au sein de notre corporation artistique.
Une jeune danseuse inexpérimentée peut interpréter le fait d’être qualifiée de « prude » de la part d’un aîné comme la nécessité pour elle de donner des preuves de son engagement artistique. Une jeune danseuse est sans aucun doute plus susceptible d’interpréter les choses de cette manière qu’une danseuse plus âgée. De telles manœuvres peuvent sembler faciles à décrypter, mais pour la jeune danseuse inexpérimentée, il est tout à fait possible d’être aveuglée par l’ambition et le charisme de l’homme assis un cran au-dessus d’elle sur l’échelle hiérarchique. (Ce qu’il ne se prive généralement pas de lui rappeler.)
Le stéréotype de la jeune femme hyper sexualisée est un sujet majeur de l’histoire de la danse, et continue d’être un thème très populaire au sein de la « vague de la danse contemporaine belge ». Malgré l’évident problème d’exploitation sexuelle que cela pose, au moment où nous écrivons, les sites internet de Needcompany, Troubleyn et Ultima Vez contiennent tous des images de femmes variablement (dé)vêtues. Remettre en question cette tradition d’une « danseuse-forcément-Lolita », c’est réduire significativement et consciemment ses opportunités sur ce marché du travail.
Ce qui revient également très souvent au cours de mes entretiens est le thème de la nudité.
Il est aujourd’hui de notoriété publique que si vous auditionnez pour certains chorégraphes, il vous sera tôt ou tard demandé de retirer vos vêtements, ou de faire quelque chose de « sexuellement provoquant ». Certaines danseuses utilisent l’expression de « meat market » (ou marché de viande à l’étalage) pour décrire ce qu’elles ressentent de ces expériences, tandis que d’autres se résignent à penser que ce type de transgression fait partie de leur travail.
Aucune des danseuses avec lesquelles j’ai discuté ne rejette, par principe, l’utilisation de la nudité sur scène. Mais quand le recours à la nudité semble gratuit, ces même danseuses s’interrogent, et se demandent si leur corps nus ne servent tout simplement pas à vendre davantage de tickets, à attirer un public plus large, ou encore à assouvir les fantasmes sexuels de leur chorégraphe.
Une des danseuses interviewées m’a parlé d’une scène de bondage. Des gens du théâtre, y compris le directeur du théâtre lui-même, venaient tous les soirs assister à la mise en place des cordes sur le corps nu des danseuses. Cette histoire m’évoque ces individus en surpoids tapis dans l’ombre dans les peintures de Degas. Lubriques, délétères et toujours présents, ils observent les jeunes filles (qui étaient aussi souvent des prostituées), au cours de danse, au vestiaire, dans les coulisses, depuis les loges. Une danseuse, pour qui ces agissements relèvent d’une forme de voyeurisme, dit ressentir de la sympathie pour les travailleuses du sexe : « Il y a des moments où je pense très sincèrement que la seule différence entre elles et moi, c’est que je peux me cacher derrière le mot art ».
Le leitmotiv de l’homme mûr profitant d’une femme plus jeune, qui n’est jamais son égale, est impossible à ignorer.
Mais le sexisme sur et autour de la scène ne s’illustre pas uniquement par la simple objectivation du corps féminin. Parfois, souvent, il prend la forme d’avances sexuelles non désirées et/ ou de déclarations d’amour venant d’hommes en position de pouvoir.
Il existe une quantité troublante d’histoires où le chorégraphe est attiré par la jeune fille sans susciter chez elle une attraction réciproque. Certaines jeunes femmes m’ont dit à quel point elles s’étaient senties punies pour n’avoir pas répondu positivement à ces avances. Elles sont subitement ignorées, ou se retrouvent face à des comportements irrespectueux et manipulateurs. Parfois, il arrive même qu’elles soient poussées, d’une manière ou d’une autre, à quitter la compagnie. Cette mentalité de la chasse et de la séduction s’illustre aussi dans une autre anecdote, relatée cette fois par un artiste.
Alors qu’il disait son désir de travailler avec une danseuse en particulier, le conservateur du musée lui répondit : « Tu peux travailler avec elle, mais seulement si tu la sautes ».
Les histoires qui me bouleversent le plus sont celles où la danseuse, des années après, continue de ressentir un mélange de honte et de responsabilité par rapport à ce qui lui est arrivé. Une danseuse m’a raconté que peu de temps après avoir été diplômée, elle avait été invitée à Paris par un artiste très en vue afin d’étudier une exposition. La proposition avait l’air tout à fait professionnelle, tous les frais étaient pris en charge. Arrivée à l’hôtel, elle s’est rendu compte qu’il n’y avait qu’une chambre avec un seul lit. Elle m’a décrit son incompréhension et sa déception, et a spécifié spontanément : « Non, je n’ai pas couché avec lui, mais il m’a touché les cheveux toute la nuit. J’ai fait semblant de dormir. J’ai pensé que rester allongée là sans bouger était probablement la meilleure chose à faire. Après ça, et pendant longtemps, je me suis sentie complètement stupide, sans valeur. »
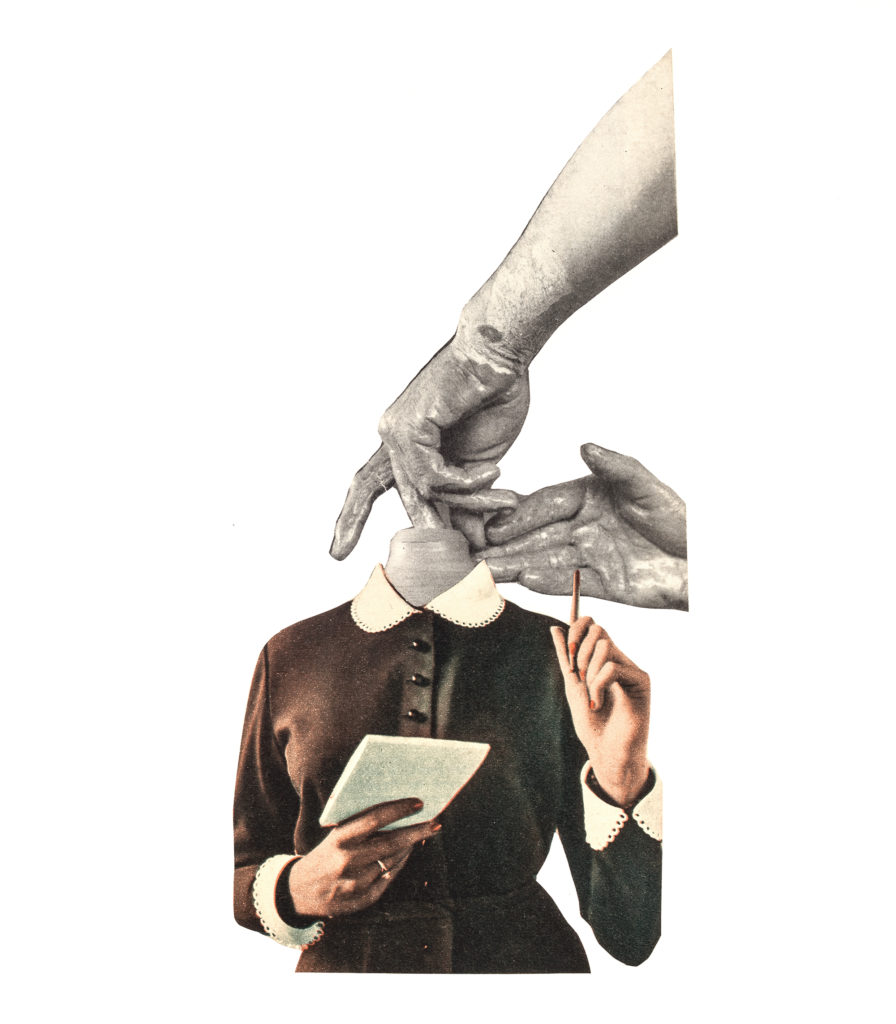
Une simple loi écrite dans un livre ne va pas changer ces structures profondément sexistes.
J’ai entendu énormément d’histoires similaires, où la jeune diplômée se voit proposer un travail atypique, peu (et souvent illégalement) rémunéré par des artistes en général beaucoup plus âgés qu’elles. Parfois, le travail consiste à poser nue devant une caméra, ou relève de l’expérimentation artistique impliquant différentes transgressions en tout genre, et pointant vers une finalité pornographique vaguement explicitée. Très souvent, ces jobs sont accompagnés d’invitations dans des restaurants chics, de cadeaux divers, de messages entreprenants, d’alcool, de drogues. Même si la situation semble d’emblée alarmante, la jeune artiste raisonne ainsi : « C’est un travail, c’est de l’argent, et si c’était l’opportunité dont j’ai toujours rêvé ? » Les danseuses veulent croire qu’elles réussiront à garder le contrôle de la situation, qu’elles sauront anticiper tout risque de dérapage.
Lorsque je demande aux danseuses si elles regrettent ces expériences, je sens qu’elles n’osent pas m’avouer qu’elles ont fait certaines choses contre leur gré.
De fait, on éprouve toujours de la réticence à se représenter soi-même comme une victime.
Il y a toujours ce moment de silence, d’hésitation, de honte. Une danseuse m’a dit : « Je ne parviens pas à me voir comme une victime, et pourtant, après coup, je ne peux nier le fait d’avoir été utilisée. »
Tout le monde sait bien que séduire n’est pas un acte répressible par la loi. Mais force est de constater à quel point ces situations et leurs caractéristiques se répètent. La redondance de ces histoires où l’homme mûr profite d’une femme plus jeune, qui n’est jamais son égale, est impossible à ignorer.
Les jeunes femmes se retrouvent dans ces situations parce qu’elles manquent de confiance en elles. Elles ont reçu une éducation qui les a rendues obéissantes, comme femme et comme danseuse, et, aussi parce que leur entourage ne les a jamais encouragées à dire non. On pourrait parler d’un climat ambiant où nage un ensemble de règles non écrites mais prégnantes, perpétuées délibérément, de façon plus ou moins tacite, plus ou moins revendiquée. Une simple loi écrite dans un livre ne va pas changer ces structures profondément sexistes.
C’est tout un secteur qui doit se réveiller et changer.
Au fur et à mesure de mon enquête, je me suis posé la question de la légitimité de certains éducateurs. Les écoles d’art devraient offrir un espace sécurisé qui permette aux étudiant.es de faire leurs propres expériences, et définir ainsi le type d’artiste qu’ils souhaitent devenir. Le moindre problème d’intimidation, de harcèlement ou de manipulation devrait être très sérieusement pris en compte, et faire l’objet d’un suivi attentif. Les écoles ne devraient pas s’envisager comme de simples « reflets » de la vie professionnelle, mais comme des creusets favorisant l’émergence de changements à mener au sein de la profession, et capables d’influencer le futur de l’espace artistique dans son ensemble. L’éducation devrait encourager et défendre les principes d’égalité et de diversité à tous les niveaux. Ce que j’ai pu constater, c’est que nous sommes encore très loin du compte.
Au moment où j’ai commencé à écrire cet article, (et tout au long de cette recherche, qui n’en n’est d’ailleurs qu’à ses tout débuts) j’ai réalisé que j’avais un choix à faire : nommer ou ne pas nommer. Devrais-je exposer certains chorégraphes, directeurs, institutions ?
Pour être tout à fait honnête, je ne saurais même pas tout à fait par où ni par qui commencer. Il ne s’agit pas simplement de deux ou trois chorégraphes dont les méthodes et le travail seraient profondément misogynes et abusifs. C’est tout un secteur qui doit se réveiller et changer. Un des aspects les plus alarmants du cas Weinstein n’est pas Weinstein lui-même, mais la culture du secret qui l’entoure, et le réseau de tous ceux qui lui ont permis de perpétrer ses crimes sans qu’il n’ait jamais été inquiété. Beaucoup ont caché, excusé des actes abjects, ou ont été prêts à s’en accommoder du moment que l’argent continuait d’affluer, et qu’ils pouvaient en retirer des avantages financiers. Je pense que ceci pourrait être dit de la même façon à propos de certains « rockstar choreographers » généreusement subventionnés de la scène belge.

Alors, par où commencer ? Voici cinq propositions, applicables dès maintenant :
1. Pour reprendre la célèbre formule de la féministe activiste Flo Kennedy : « N’agonisons pas, organisons-nous ! ». Nous devrions certainement travailler à rendre les inégalités visibles en respectant les quotas, mais nous devrions également apprendre à accorder de la valeur aux problèmes qui ne se traduisent pas nécessairement par des chiffres.
Pour comprendre les tenants et les aboutissants de ces inégalités, il est nécessaire de donner de l’importance aux témoignages faisant état d’actes discriminatoires.
Ou, pour reprendre Sarah Ahmed « le personnel est structurel (…) Nous avons besoin de structure pour rendre évident le caractère sexiste et racistes de nos structures. » C’est ce que nous proposons de faire ici en reliant le statistique au personnel, et en organisant les histoires personnelles au sein d’une structure. Nous devons recenser un maximum d’histoires de cette nature. À toutes celles et ceux qui veulent contribuer à cette recherche, merci de me contacter à : whentheytalkaboutsexism@gmail.com
2. Nous devons nous servir de nos syndicats et connaître nos droits. Trop souvent, nous oublions que nos syndicats peuvent apporter plus que le seul soutien aux chercheurs d’emploi. Les syndicats peuvent donner une légitimité à des arguments qui, sans eux, ne seraient tout simplement pas entendus. Non que les syndicats soient par définition des endroits exempts de discrimination, mais ils peuvent en tout cas être un très bon point de départ. En exprimant nos besoins individuels, nous pouvons aider les syndicats à développer des outils spécifiques à notre secteur, comme par exemple en créant des lignes directrices et des contrôles sur l’égalité des chances entre les hommes et les femmes. Les syndicats peuvent devenir des médiateurs importants entre les instituts et les employés. S’investir dans nos syndicats, s’assurer qu’ils fonctionnent en pleine cohérence avec les besoins de ses membres, pourraient mettre en place les conditions d’une égalité effective et pérenne.
En tant que public, nous devrions cesser d’applaudir le sexisme.
3. Informer et évaluer. J’encourage tous et toutes à s’informer sur les problématiques liées à l’égalité des sexes, sur les notions de pouvoir et de consentement. Aussi évident que cela puisse paraître, je vous encourage à commencer par vous-même. Si vous travaillez au sein d’une institution, profitez de ce climat particulièrement propice et engagez un mouvement de réévaluation structurelle. Vous pouvez aussi vous assurer que vos collègues connaissent les recours possibles en cas de discrimination, et que si elles choisissent de témoigner, elles seront entendues.
4. Zéro tolérance. Le sexisme et tout autre forme de violence ou de discrimination ne doivent désormais plus être tolérés, quelles que soient les circonstances. La discrimination doit être reconnue et nommée en tant que telle. En tant que danseurs, nous ne devrions plus passer des auditions ou travailler auprès d’artistes ayant des comportements abusifs. Si vous êtes directeur de théâtre, vous pourriez choisir d’arrêter de programmer des œuvres sexistes. En tant que public, nous ne devrions plus applaudir le sexisme. Enfin, la conscience aiguë de ces problématiques devraient être une condition pour recevoir des subsides, et faire ainsi de l’art avec l’argent public. Si nos gouvernements avaient le courage de ne plus soutenir les travaux sexistes, cela ne témoignerait pas simplement d’un engagement civique important, mais aurait également des répercussions sur la circulation de l’argent au sein de notre société.
5. Soutenir la jeune génération. Il faut casser l’éternel retour de la violence. Nous devons nous unir et nous dresser contre cette culture qui brutalise en particulier la jeunesse. Pour ce qui est des problèmes liés au sexisme, nous appelons par exemple à soutenir et protéger les jeunes femmes au début de leur carrière. Je lance ce message en particulier aux ainées, et de rappeler qu’être victime de sexisme ou d’abus n’est pas un passage obligé dans une trajectoire, et n’est pas la contrepartie nécessaire à une progression artistique. Nous devons tuer ce mythe, une bonne fois pour toutes.
Enfin, aux misogynes et à tous les indignes de notre profession, la honte vous revient. Il est temps de faire amende honorable en laissant sa place à une nouvelle génération d’artistes qui ne considère pas que les violences faites aux femmes soient un moteur à la création. Et, de grâce, faites-vous soigner. Votre présence est toxique. Elle n’est plus acceptable au sein d’une discipline artistique que nous choyons, et aimons profondément.