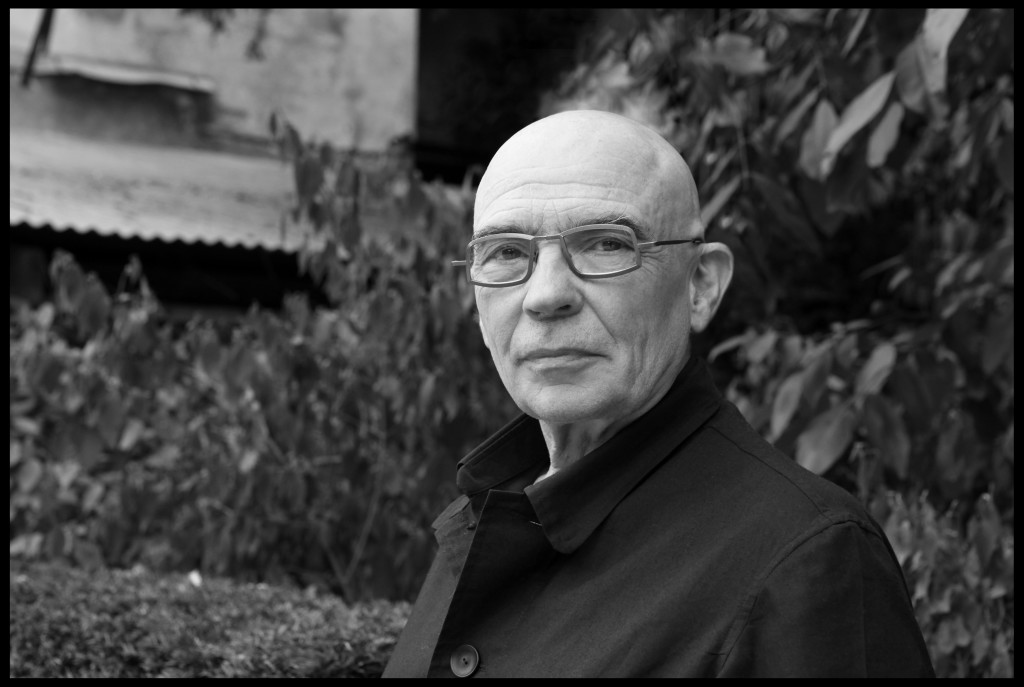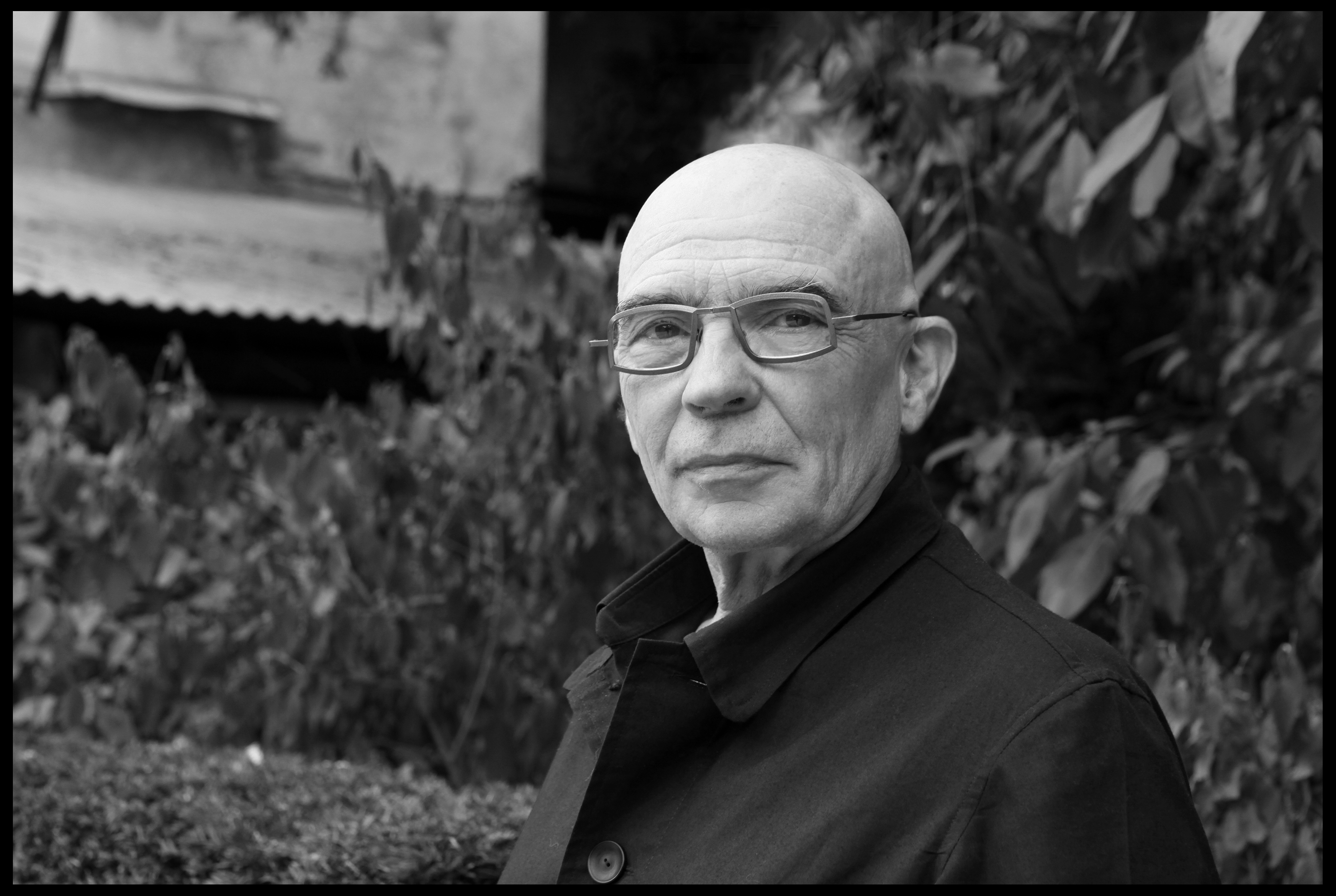- ÉCRIRE ? Oui, écrire. Restituer le roulis qu’on a dans la tête. À l’origine, il y a quelque chose qui roule dans la tête, pas très identifiable, et on essaie d’entrer dans le roulis pour voir ce que c’est. Et on découvre un château hanté. On ouvre des portes qui donnent sur d’autres portes, on dérive lentement, on est soi loin de soi. Ce n’est pas une descente dans les profondeurs, une aventure intérieure, l’autre nom de la vieille introspection. Quand on entre dans le roulis, paradoxalement, on retrouve l’extérieur. Sophocle est là et aussi Shakespeare, et papa et maman, et le grand tamtam du monde. Il faut alors décortiquer, recomposer, coller, disjoindre, bâtir, détruire : écrire. Je crois à des élans de positivité sur fond de terreur, je refuse de dissocier les deux plans, la dissociation est un mensonge.
- LA VÉRITE D’UNE PAROLE n’est pas seulement dans ce qu’elle dit, elle est également dans la façon dont elle le dit. La forme est une conviction.
- PARFOIS, LE RÉALISME, LE SOUCI DE VÉRITÉ NE SONT QUE DES LEURRES qui masquent la banalité de l’écriture et l’indigence de la composition, estimant sans doute que la bonne volonté mise à rencontrer des « sujets de société » et à faire ostensiblement clignoter leur engagement du côté des bonnes causes tiendra lieu de geste artistique. Le plus navrant dans ce cas est l’absence de langue tout simplement, une absence d’art qui permet à l’auteur de passer pour une conscience, de ne pas avoir l’air de prendre le théâtre à la légère, d’être un artiste responsable, alors qu’en paresseux il compte sur le poids émotionnel des thèmes pour faire le travail à sa place. Rappel brechtien : « Et il faut qu’il y ait de l’art pour que devienne humainement exemplaire ce qui est politiquement juste. » Écrits, Pléiade, p.415.
- LA DÉMOCRATIE SE SCIE LES PIEDS chaque fois qu’en masse elle écrase des dons que chacun ne possédera jamais de façon égale. Son rêve d’égalité sans visage aboutit au médiocre, et celui qui incarne le mieux cette médiocrité-là, celui-là en garantit, fût-ce autoritairement, l’usage pour tous. La tyrannie de tous par tous fond l’infini des désirs en un seul : que rien ne dépasse. Elle est un massacre de la vie.
- QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU PHÉNOMÈNE THÉÂTRAL qui en font un art à contre-courant. Le théâtre est un art de la lenteur (dans un monde qui va vite). Le théâtre est un art de la trace par le biais du texte (dans un temps qui oublie). Le théâtre est un art local (à l’heure de la mondialisation). Le théâtre comme spectacle vivant est éphémère (dans un monde qui vénère le stockage d’informations).
- QUELQUES IDÉES FORTES PRISES DANS LE JOURNAL DE LEIRIS, proches de ce que je ressens parfois : le découragement devant l’idée que « tout cela » aboutit à la mort ; le sentiment d’une absence d’enjeu qui engendre ennui, passivité, résignation ; le refus de la culture comme bavardage, même savant.
- CONCEVOIR L’ÉCRITURE COMME UNE RIPOSTE À UN MONDE QUI VOUS TOMBE DESSUS et qu’on ne maîtrise pas. C’est ma façon de rencontrer la réalité sur mon terrain.
- CARL STERNHEIM (I878-I942), MORT À BRUXELLES où il s’est exilé depuis 1930. Théâtre scandaleux qui met en lumière par le comique les vices fondamentaux du monde de son temps, de la moralité bourgeoise. La Culotte, 1911. L’héroïne a perdu sa culotte lors d’une cérémonie. Son mari l’engueule. Elle a été remarquée par un poète nietzschéen et par un garçon coiffeur fou de Wagner. Les deux viennent louer des chambres chez le mari. Au moment où le poète nietzschéen va conquérir la fille, il veut, avant, composer une œuvre mémorable et s’en va. Le mari a une affaire avec la voisine, il fixe un jour par semaine où ils se verront. Pendant ce temps Louise va à l’église et prépare la choucroute au porc. Gide parle de Sternheim dans son Journal (Pléiade t.2, p. 260). Il l’enrôle dans une catégorie d’auteurs où figurent aussi Bernstein et Tristan Bernard, qu’il définit comme « littérature juive ». « Tous ont ceci en commun, dit-il, que dans leur œuvre, toute idée de noblesse est exclue. C’est de la littérature avilissante. Chacun d’eux ne peint l’homme que tel qu’il devient lorsqu’il s’abandonne ; ne peint que des créatures abandonnées, des déchéances. » Entre la conception nazie de l’art dégénéré et la « littérature avilissante » de Gide, où est la différence ?
- HEINER MÜLLER EST UN AUTEUR EXEMPLAIRE. Ses textes forment une matière théâtrale féconde. Ils attendent le plateau. Ils réclament pour s’élucider la pratique de l’expérimentation. D’une certaine façon, on ne met pas Müller en scène comme on mettrait en scène Pinter ou Botho Strauss par exemple. On le met plutôt au travail, on se met au travail avec lui. Müller a‑t-il un sens ? A‑t-il du sens ? Comment ce sens, cet incessant engendrement significatif fait-il théâtre ? Quels types de théâtralité peut-on envisager à partir d’une pareille écriture ? La question est à la fois théorique et pratique. Question théorique, parce que Müller s’inscrit dans la tradition théâtrale. Son travail d’écriture est un perpétuel dialogue avec l’histoire du théâtre, une refaçon permanente de ce qui vient avant lui. Il revisite les Grecs, Shakespeare, Brecht, le tragique, les formes du théâtre politique, etc. Il remet en cause une certaine finalité du théâtre, estimant cet art plus proche du désordre et de la provocation que de l’ordre ou de la pédagogie. Question pratique, parce que le guide du théâtre müllérien est le corps. La recherche du processus significatif chez Müller gagne à s’appuyer sur le corps. Il est des moments dans « Hamlet-Machine » par exemple où pour savoir « ce que cela veut dire », la lecture de texte, le savoir historique ou la pratique du langage ne suffisent plus. Il faut littéralement mettre le texte en corps pour savoir où il peut aller. Sans doute est-ce vrai de tous les grands textes de théâtre, mais cette catégorie du sens à découvrir par le « faire », Müller l’a radicalisée, délibérément produite.
L'archive que nous publions cette semaine est consacrée à Hamlet-Machine de Heiner Müller.
Retrouvez l'extrait 1 d'"Accents toniques" : Le théâtre de consommation culturelle
Alternatives théâtrales a consacré son numéro 75 à l'oeuvre de Jean-Marie Piemme, ainsi qu'un hors-série : "Voyages dans ma cuisine. Conversations avec Antoine Laubin".
Le site officiel de Jean-Marie Piemme