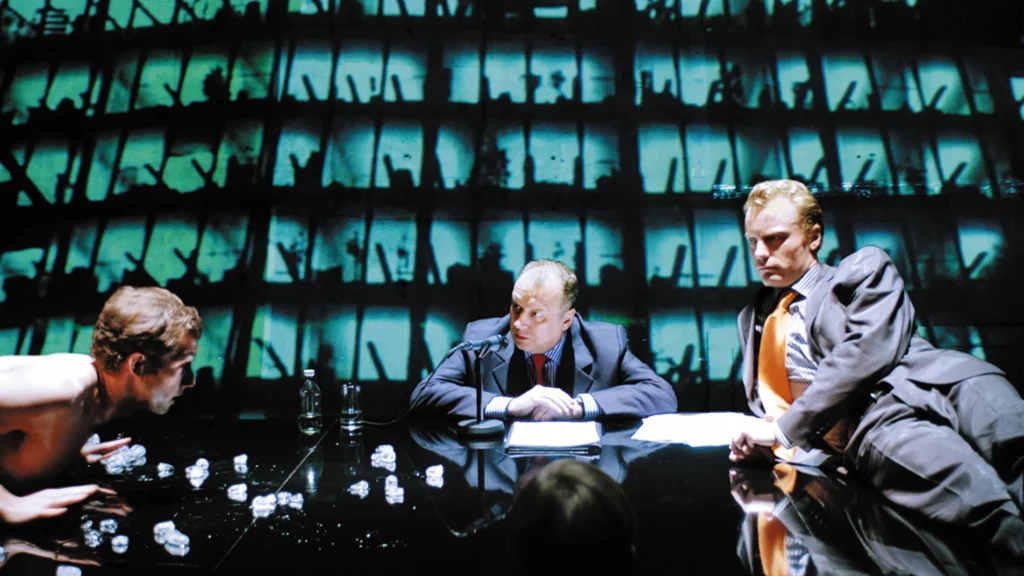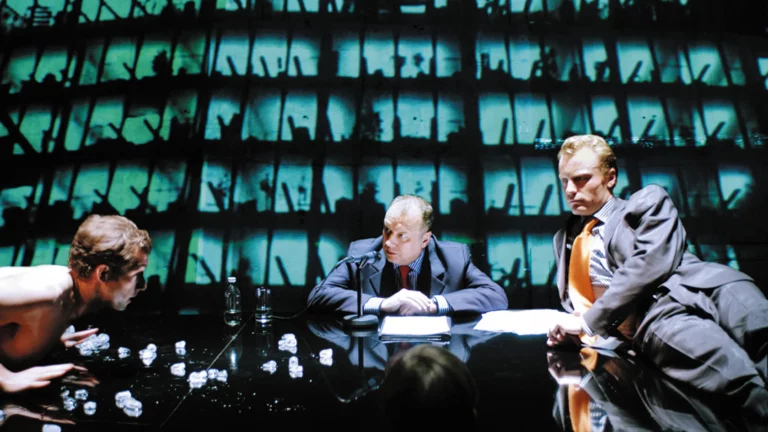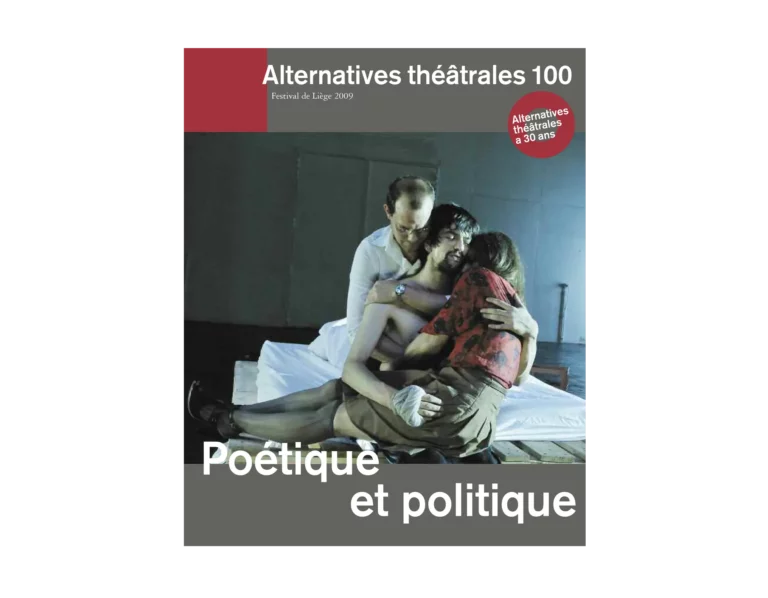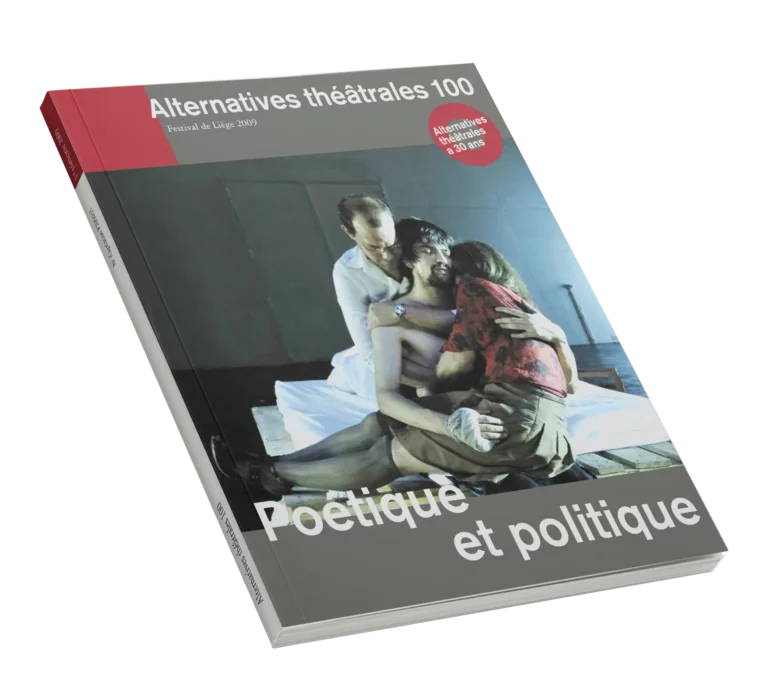En 2003, le metteur en scène et dramaturge Falk Richter publiait LE SYSTÈME. UNE INTRODUCTION, texte complexe annonçant un cycle de pièces et, plus largement, la tentative d’une confrontation plurimédiale avec le nouvel « ordre » du monde. Éclaté dans sa forme, ce « programme » faisait cohabiter des commentaires sur la situation politique internationale avec des notes, un dialogue avec l’expression plus immédiate d’un Je en butte avec ce « Système », somme indéterminée des mécanismes économiques et politiques contemporains. Véritable texte-paradigme, LE SYSTÈME résume aussi bien qu’il matérialise les contradictions dont est porteur le théâtre entre politique et poétique, lorsque cède sans cesse sous le pied – un état permanent dans le texte de Richter – l’assise qui permettrait l’objectivation, lorsque le sujet en révolte est aussi partie prenante dans l’ordre des choses. Ce paradoxe, dans lequel se manifeste une indistinction (du sujet, du monde, du langage…), permet de démêler l’écheveau des formes dramatiques lorsque celles-ci se mêlent du monde, de s’y frayer un chemin, en laissant derrière soi, au passage, les débats sur le postdramatique.
«(Si) tragique contemporain il y a, il semble bien qu’il s’agisse non pas d’un tragique immuable, transmis fidèlement par la tradition, de génération en génération, mais d’un tragique « incarné », qui se nourrit des contingences du milieu dans lequel il fleurit1 » . Parler aujourd’hui de « tragédie » pour aborder la production dramatique contemporaine de langue allemande et associer ainsi un genre spécifique à tel ou tel texte paraît difficile. L’hypothèse d’une présence du tragique, par delà la question du rejet toujours relatif de la dramaticité traditionnelle, permet néanmoins d’aborder la variété formelle des textes qui se donnent pour objet premier des modalités d’existence individuelle et collective modelées par la toute-puissance économique. Roland Schimmelpfennig (PUSH UP, 2001), Marius von Mayenburg ( ELDORADO, 2004 ), Fritz Kater ( TANZEN !, 2006), sont autant d’auteurs qui apportent des éclairages très divers sur un homme qui n’est pas seulement victime mais aussi acteur dans les rouages économiques ; ce n’est plus en termes d’affrontement de « classes » que s’articule la représentation du monde dans le texte contemporain. L’aliénation est autre, située désormais à un degré second : plus question ici de parvenir à une prise de conscience (de classe) là où cette aliénation est vécue et verbalisée comme telle, sans pour autant que puisse être entrevue une échappatoire. Il faudra donc chercher ailleurs le moment politique du théâtre. Parmi d’autres, Falk Richter et Kathrin Röggla, invoqués ici à titre d’exemples, explorent dans leur travail un way of life postindustriel, l’existence de cet « homme flexible » dont Richard Sennett a dressé le portrait .2