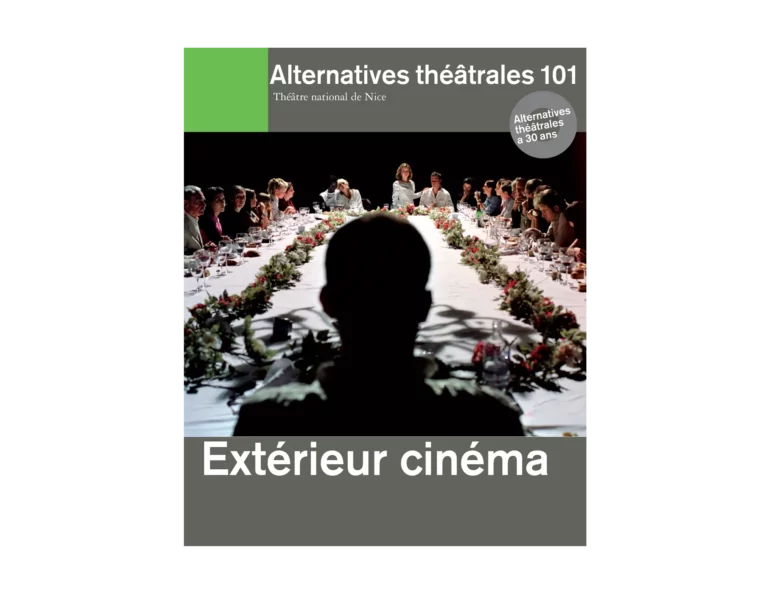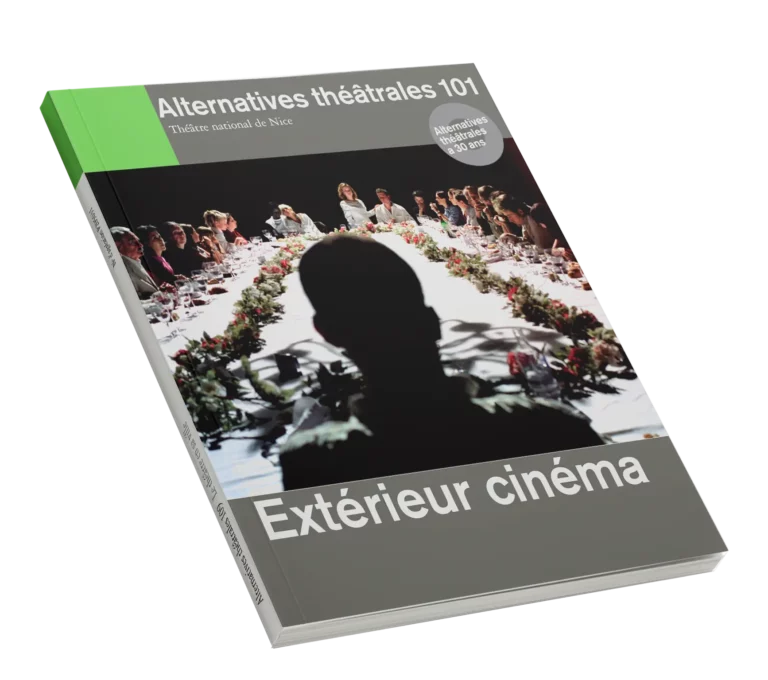LE SPECTACLE RWANDA 94 du Groupov1 commençait par le récit de Yolande Mukagasana, long monologue où « celle qui aurait dû mourir » raconte la mort de ses proches, mari et enfants dans une démarche qui avance sur un fil ténu entre l’horreur du réel et sa représentation.

Le film de Marie-France Collard2 commence par un déterrement. C’est une autre femme rescapée, Marine, qui dirige cette activité macabre. Elle sera interviewée ensuite. Comme dans le spectacle, le cadre est assez large. Une certaine distance est recherchée, pas de gros plans, comme pour permettre à la parole d’être livrée sans contraintes.
Dans le film comme dans le spectacle, un travail sur le temps, les silences, une invitation à l’expression de l’émotion en même temps qu’un appel à la réflexion : le contraire du rythme habituel de la télévision, saccadé, pressé et dont la manière dont elle avait rendu compte du génocide rwandais avait provoqué auprès de Jacques Delcuvellerie et du Groupov ce sentiment de révolte qui avait été l’élément déclencheur de la gigantesque entreprise théâtrale menée durant de longues années qui a abouti à la création du spectacle RWANDA 94, sous titré, on s’en souviendra, une tentative de réparation symbolique envers les morts à l’usage des vivants.
Comme le soulignait Jacques Delcuvellerie en février 2000 dans un des numéros du journal Igicaniro (mot signifiant en Kinyarwanda, feu de camp, veillée d’armes…) qui accompagna le travail des répétitions : « si notre devoir nous semblait de tenter une « réparation » envers les Morts, la nécessité de l’entreprendre procédait bien du souci des vivants. En œuvrant à la réparation, nous avons la conviction de contribuer à ce que les vivants puissent s’interroger sur les étranges rapports qui conduisent périodiquement à exterminer une partie de l’humanité dans l’indifférence, la passivité, en partie avec la complicité d’une grande majorité. »3