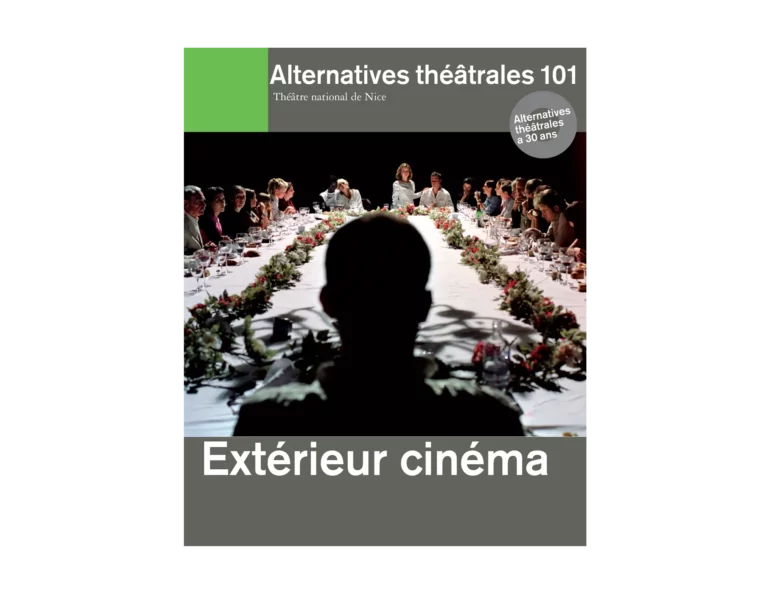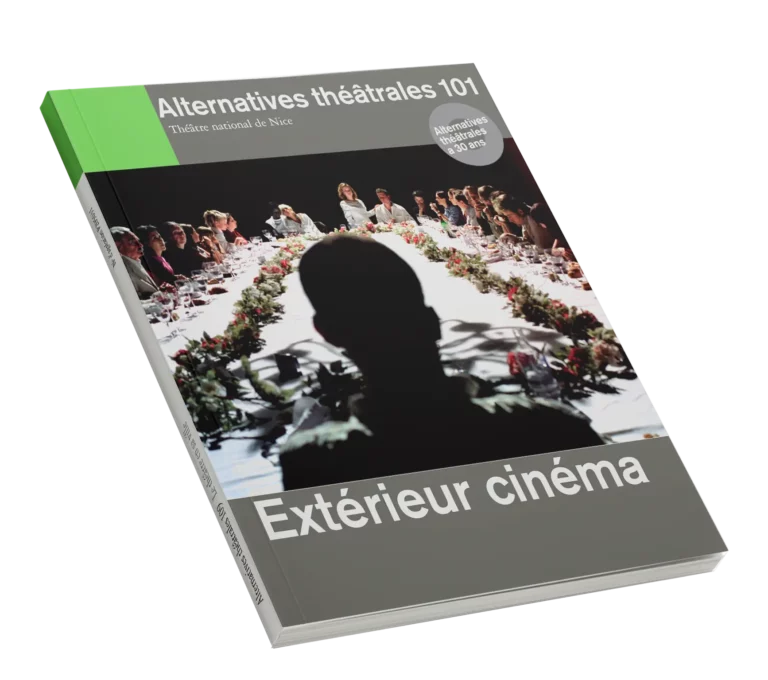Bernard Debroux : Tu m’as fait remarquer qu’en arrivant à Nice tu avais eu cette volonté d’inscrire ta démarche de création dans ce rapport particulier avec le cinéma. Tu as utilisé cette phrase : « le théâtre est un art tellement archaïque que cela lui permet d’intégrer des nouvelles expériences artistiques, des nouvelles démarches qui naissent. C’est une nécessité. » Faces est le point d’aboutissement d’un projet qui est né avec Festen et Misery, et, plus tard, L’Argent des autres. Pourquoi et comment est née cette idée de vouloir prendre appui sur des scénarii de films pour faire du théâtre ?
Daniel Benoin : La première raison, c’est que je ne trouvais pas souvent dans le théâtre un rapport au monde que je trouvais beaucoup plus facilement dans le cinéma. Je me suis aperçu que le cinéma abordait très rapidement un certain nombre de sujets de notre monde contemporain, grâce à la particularité réaliste de cet art. Même si l’écriture, la production, c’est assez long, on a l’impression que le cinéma réagit très vite aux phénomènes de société. Le théâtre a beaucoup plus de retard, mais sans doute parce qu’il porte un autre regard sur ces événements.
La vision du monde actuel, celui qui nous entoure, m’apparaît essentielle pour un homme de théâtre. Parfois cela devient presque une mission. C’est ainsi que je ne sais pas comment je pourrais monter une pièce de théâtre à la rentrée sans que ce soit une pièce qui aborde, d’un point de vue théâtral, la crise. Je ne pourrais pas aujourd’hui monter un Marivaux ou un Musset. Un metteur en scène, c’est quelqu’un qui est dans le monde, et pas à l’extérieur du monde ; qui a des antennes sans arrêt en éveil, en écoute et qui accumule un certain nombre d’informations, de réflexions, d’événements. Ensuite, à travers un spectacle, il redéploie ces informations de manière propre, en apportant quelque chose de différent du journalisme ou de la sociologie.
Je viens d’une génération où l’on allait plutôt d’abord au cinéma. Le théâtre était beaucoup plus solennel ; il fallait s’habiller, se tenir sage, alors que le cinéma était un art immédiat. Sans doute cela a‑t-il joué.
La première raison, c’est donc celle de la proximité du cinéma avec le monde, peut-être parce que le cinéma est un art du réel alors que le théâtre ne l’est pas. Quand on essaie de faire un film qui n’est pas basé sur la réalité, c’est très compliqué. Ces films existent par exemple chez les Surréalistes, mais même si c’était « surréel », cela partait quand même d’éléments du « réel » : quand Bunuel fait venir le piano, la vache, les prêtres, de vrais prêtres, etc. dans
Le Chien andalou, ce n’est pas une approche réaliste mais c’est un vrai piano, une vraie vache…
À partir de là, il ne s’agit surtout pas de faire du cinéma au théâtre. Ce n’est pas du tout la même idée que Robert Hossein quand il montait ses grands spectacles au Palais des Sports, et parlait : « du théâtre comme au cinéma ». C’étaient de grandes fresques, une grande scène avec trois cents personnes sur le plateau, comme ce théâtre à la fin du XIXe siècle ou début du XXe, quand le cinéma n’existait pas ou si peu. À cette époque on imaginait certaines pièces de théâtre de manière très cinématographique. Dans une pièce comme le Napoléon de Grabbe, il y a trois cents personnages. La distribution prend sept ou huit pages ! Dans les arènes de Béziers, par exemple, je me rappelle avoir vu des photos de pièces de Romain Rolland où il y avait deux cents personnes sur scène.
Pour moi, il s’agit au contraire de trouver dans la transposition du cinéma au théâtre quelque chose qui soit propre au théâtre d’aujourd’hui. Ce sont souvent les sujets qui m’intéressent d’abord, et dans un deuxième temps, comme c’est le cas dans Faces ou Festen, c’est la manière particulière de faire du cinéma qui me passionne et que je cherche à transposer au théâtre. Et dans les deux cas ce n’est pas facile, car que ce soit Festen (Vinterberg et Dogma) ou Faces (Cassavetes) vingt ans plus tôt, on est face à un cinéma qui va chercher l’intimité, le détail, le sentiment caché, donc ce que l’on ne montre pas normalement au théâtre.
B. D. : Peut-être que ce qui facilite l’adaptation c’est qu’il ne s’agit pas de films à grand spectacle. Ce que tu dis sur la charte de « la caméra à l’épaule », où tout doit être plus près de l’acteur, cela renvoie au rapport que tu entretiens avec l’acteur, parce que ce sont des films qui mettent en avant l’aspect physique. C’est ce que j’ai ressenti pour Faces, où j’étais dans le public sur le plateau parmi les acteurs ; il y a une forte proximité, une sorte de densité physique.
D. B. : C’est la manière dont j’essaie de faire la translation, de rendre compte de ce cinéma-là par les moyens du théâtre. Que ce soit dans Festen ou dans Faces, je cherche comment montrer l’intimité, cette recherche par la caméra du détail, de la position particulière, d’une proximité corporelle avec l’acteur… Comment montrer ça au théâtre ! Pour Festen, j’avais mis soixante-dix personnes à table avec les comédiens. Ils mangeaient avec eux, fêtaient l’anniversaire du père avec les personnages.
Avant ce spectacle, je n’avais jamais cassé la frontière que je considère encore essentielle entre la scène et la salle. Le rapport frontal était pour moi capital. Je fabriquais un théâtre qui était un théâtre d’images, de visions. Le spectateur voyait ces images, fabriquées par moi pour quelqu’un qui se trouvait en face, et non pas sur le côté ou derrière. C’était un théâtre absolument frontal. Je détestais le bifrontal ou le théâtre en rond. Je me plaçais, comme metteur en scène, au milieu, et il fallait que pour moi ce soit fort. Il y avait donc une place formidable dans toute la salle : la mienne.
C’est en me posant la question de la transposition de cette intimité, de cette proximité dans Festen que je me suis dit qu’il fallait que je trouve une nouvelle manière de faire du théâtre. Ainsi est née l’idée que le public soit très proche des acteurs, qu’il participe, ce qui me semblait jusqu’à ce jour-là parfaitement ridicule ! La participation des spectateurs était une démarche qui me laissait de glace et que je trouvais totalement indigne de l’art dramatique. Mais quand les spectateurs participent malgré eux, par exemple dans FESTEN, lorsqu’on leur demande de se lever à un moment, de trinquer et boire en l’honneur du père, et que c’est à ce moment que Christian, son fils, dit : « Levez-vous tous. Je bois à mon père qui m’a violé pendant toute mon enfance », les spectateurs qui avaient suivi les indications se retrouvent dans la situation des invités de cette fête : le doute, la gêne, les regards angoissés. Il ne s’agit pas de participation potache mais de se trouver au cœur du problème, ce qui n’est pas du tout pareil. Festen, que j’ai créé en 2002 et Faces en 2007, ce sont deux manières très semblables de faire du cinéma. Et Cassavetes est sans doute le prédécesseur de Dogma. Il travaille de la même manière.
Les gens de Dogma, de ce point de vue-là, n’ont rien inventé. Quand on voit le film Faces, tout se passe dans l’appartement de Cassavetes. Il change vaguement de tableau derrière pour qu’on distingue l’appartement de Jane de celui de Maria, mais c’est toujours dans la réalité l’appartement de Cassavetes.
J’ai monté Faces et ensuite, en diptyque, Le Nouveau Testament de Guitry.
Dans Faces, il y avait soixante-quatre canapés de trois places, un grand damier de seize carrés de grands canapés, tous pareils. Je suis parti d’un objet bien réel qui est le canapé et en le multipliant on en fait un lieu abstrait, seize carrés de quatre canapés chacun, une sorte de tableau de Mondrian d’avant 1914 quand celui-ci ne connaissait pas encore la couleur. Il m’est apparu alors que c’était le décor parfait pour toutes les pièces françaises bourgeoises du XIXe et XXe siècle, en particulier celles de Guitry. C’est pourquoi j’ai décidé de monter sur la même thématique que Faces, Le Nouveau Testament. Il s’agit d’une de ces pièces à la fois plus profonde et plus nostalgique de celui qui venait de se faire quitter par Yvonne Printemps. Dans Faces j’avais cherché comment représenter la proximité du spectacle avec le spectateur. J’avais deux idées possibles, une qui était des lits – c’est le lieu de l’intimité absolue – mais c’est très compliqué de mettre des spectateurs dans des lits avec des acteurs. Mais cela aurait été sans doute l’idée la plus cohérente. Le dispositif scénique de Faces que j’ai inventé pour la pièce permet de faire du Nouveau Testament quelque chose de tout à fait différent de ce qu’on peut attendre traditionnellement de Guitry. Ça transforme Guitry, qui devient beaucoup plus proche d’Ibsen, et du coup ça pervertit complètement le drame bourgeois. On est dans le mouvement sans arrêt, la distance, le regard, c’est en cela qu’on retrouve d’une certaine manière le cinéma. Car si Guitry écrit une pièce de théâtre, il en fait un film, et moi j’ai refait un spectacle, non pas à partir de la pièce de théâtre initiale mais à partir du film.
B. D. : Pourquoi à partir du film ?