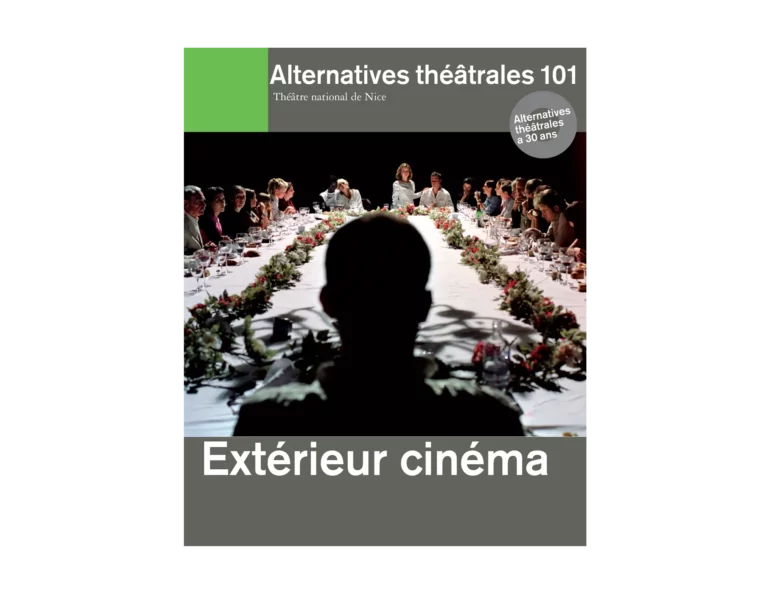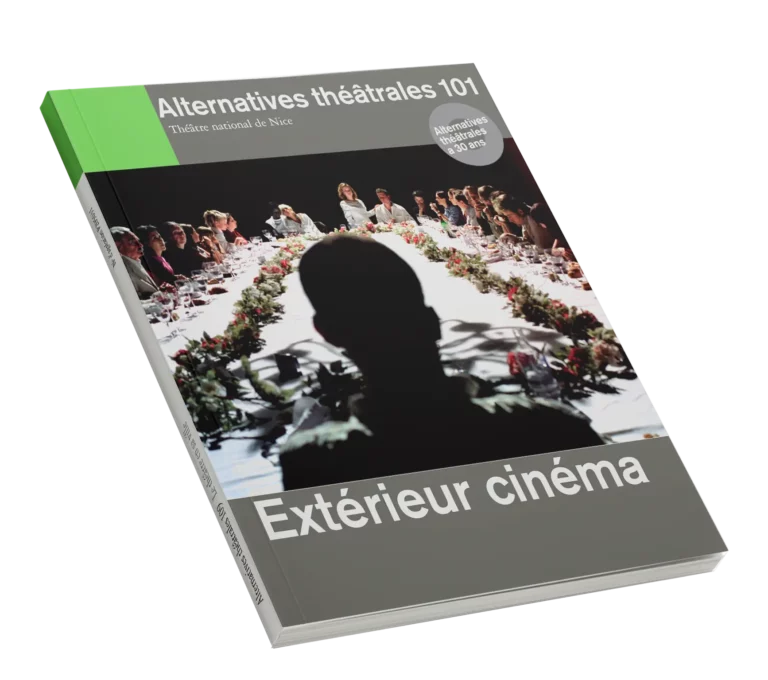AU DÉBUT des années quarante, Tennessee Williams a la vertigineuse impression de vivre la vie de « cinq ou dix personnes » : liftier dans un hôtel, télétypiste, garçon de café, caissier de restaurant, ouvreur, au demeurant écrivain à ses heures perdues.
Un malicieux hasard lui permet d’obtenir en 1943 un contrat pour six mois à la Metro Goldwyn Mayer. Nommé « rewriter », il est chargé d’examiner des scénarios en souffrance, de les remonter et de les retaper pour leur donner une seconde vie.
Bon gré, mal gré, le jeune auteur joue le jeu, mais il ne veut pas se contenter de réécrire les scripts des concurrents. Puisqu’il se trouve à Hollywood, il refuse de laisser passer sa chance : il se dépêche d’adapter pour le cinéma une de ses nouvelles, écrite dans l’année, PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE EN VERRE. Sous un nouveau titre, LE GALANT, il propose son scénario à ces messieurs de la M.G.M.
Devant leur refus sans appel, il reprend son indépendance. Riche des premières économies de son existence (« De dix-sept dollars par semaine comme ouvreur de cinéma, je passai soudain à deux cent cinquante dollars en travaillant à Hollywood »), il s’offre le luxe d’adapter au théâtre… son adaptation cinématographique !
À Chicago, puis à New York en mars 1945, LA MÉNAGERIE DE VERRE triomphe et la pièce ne cessera jamais plus d’être représentée. Avec du recul, Tennessee Williams attribue ce succès à ce croisement étrange et heureux entre deux écritures, cinématographique et théâtrale.
La M.G.M. réussit, à prix d’or, à rafler les droits d’adaptation de LA MÉNAGERIE DE VERRE. Ses « rewriters » se chargent de réviser l’œuvre selon les règles en vigueur à Hollywood. Un traditionnel « happy end » finit d’achever le film d’Irving Rapper (1951) : presque tout a été réécrit sauf le titre !
Je n’ai pas pu prendre connaissance du scénario de Tennessee Williams : est-il archivé dans un fonds de bibliothèque ? A‑t-il disparu ? Entre LE PORTRAIT D’UNE JEUNE FILLE EN VERRE et LA MÉNAGERIE DE VERRE, un chaînon manque. Paradoxalement, ce « manque de cinéma » s’affirme fortement dans la version théâtrale. En revanche, la nouvelle n’y fait aucune allusion, le mot n’apparaît même pas.
Dans la pièce, Tom « en manque » se précipite chaque soir dans les salles obscures. Amanda, sa mère, ne supporte plus cette perte d’argent, de temps, de forces vives ! Elle reproche amèrement à son fils ses divertissements vulgaires et douteux.
Cinéphage, Tom se drogue. Chaque film, n’importe lequel, lui offre un antidote à l’ennui stérile, répété jour après jour, au gâchis de sa vie piégée dans une « boîte » contre un salaire dérisoire. Cette lanterne magique lui permet d’échapper à l’étouffement quotidien, de respirer l’air du large, de rejoindre à travers les mers les pirates rebelles et libres, embarqués dans des aventures extraordinaires, sous les rafales de l’épopée ! Tom enfin vit un rêve éveillé : la profusion des images lui permet d’enjamber la mesquinerie du réel, et de sauter magiquement au-dessus de tous les obstacles !
Quand Tom le narrateur entre en scène pour sa première adresse au public, il rejette d’entrée de jeu l’art du cinéma. On pourrait même croire qu’au-delà de la salle, il apostrophe les illusionnistes d’Hollywood qui ont refusé son scénario. Il brûle publiquement ce qu’il a adoré :
« Oui, je vais vous surprendre. J’ai plus d’un tour dans mon sac. Mais je suis l’inverse d’un prestidigitateur de music-hall. Lui nous présente une illusion qui a l’apparence de la vérité, moi je vous présente la vérité sous le masque de l’illusion. »
Tennessee Williams, pour tourner une page, l’arrache ! Le cinéma, d’origine foraine, garde le goût des trucages, à la manière d’un Méliès : il aime tromper son public. Mais son meilleur truc consiste à donner l’apparence du réel à un trompe‑l’œil. Le spectateur tombe sous le charme d’une illusion, fasciné, il prend des vessies pour des lanternes.
Dès les premiers mots du texte, Tom le narrateur, Tom l’auteur (Tennessee n’est qu’un pseudonyme, il se prénommait Thomas, Tom pour sa famille ), affirme sa foi en un art qui refuse l’illusionnisme. Après avoir pris pour cible le cinéma d’Hollywood, il poursuit sur son élan ; il refuse sur scène le naturalisme qui se targue de reproduire la réalité sur un plateau mesurable en mètres carrés.
Il appelle de ses vœux un théâtre poétique. LA MÉNAGERIE DE VERRE se présente dans ses premières lignes comme un manifeste en ce sens :