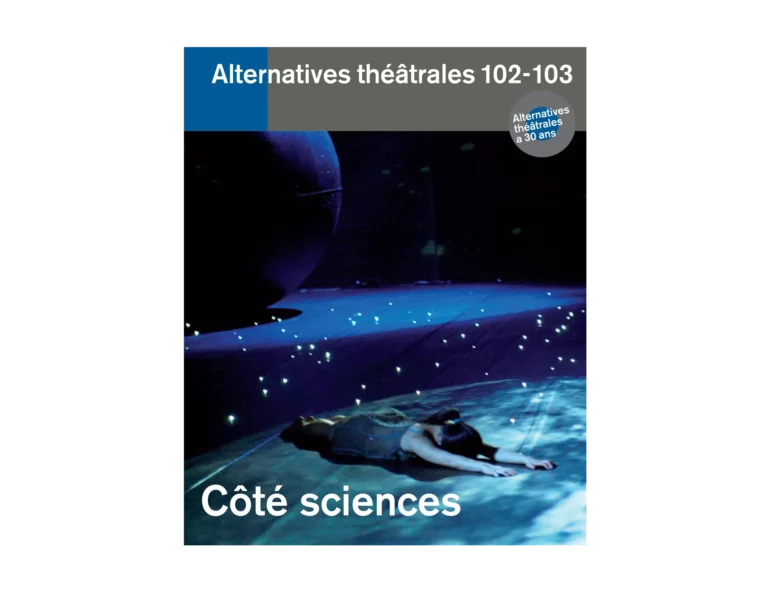EN MAI 2002, le paléontologue, historien des sciences et biologiste de l’évolution américain Stephen Jay Gould décédait d’un cancer ; il n’avait que 61 ans, et se trouvait à l’apogée d’une vie professionnelle extraordinairement active et d’une carrière d’écrivain étonnamment prolifique. Parmi les nombreux projets dans lesquels il était impliqué avant que la maladie ait raison de lui, le plus intrigant est peut-être une pièce de théâtre basée sur les écrits et l’autobiographie de Darwin, dans laquelle il incarnait lui-même le grand scientifique – une sorte de one-man show, avec un scientifique dans le rôle d’un scientifique. J’ai lu une brève note sur ce projet dans le Times Literary Supplement peu après la mort de Gould ; elle m’a intriguée car je n’avais jamais rien vu de tel dans l’histoire du théâtre et de la science. Il existe certes de nombreuses pièces sur des scientifiques bien connus, comme LEBEN DES GALILEI (LA VIE DE GALILÉE) de Brecht, INSIGNIFICANCE (INSIGNIFIANCE) de Terry Johnson (Einstein), QED de Peter Parnell (où Alan Alda jouait le physicien Richard Feynman) et TRUMPERY (TROMPERIE ; sur Darwin et Wallace), ou encore d’autres sur Fritz Haber, Ernest Rutherford, J. Robert Oppenheimer, Niels Bohr et Werner Heisenberg, etc. Mais rares sont celles dans lesquelles un scientifique joue un scientifique, et dont le texte émane essentiellement de ces deux personnages (Gould aurait retravaillé et commenté Darwin).Il aurait été particulièrement intéressant de voir Stephen Jay Gould en Darwin, étant donné le rôle prépondérant joué par Gould dans le débat surnommé la « guerre de Darwin ».
Ajoutez au duo dynamique Gould-Darwin la veine du théâtre italien et le metteur en scène d’opéra Luca Ronconi, du théâtre Piccolo de Milan, et l’histoire n’en est que plus intrigante. Ronconi, qui a succédé à Giorgio Strehler au Piccolo et dirigé aussi bien des productions théâtrales novatrices que de grands opéras à La Scala (Wagner, Verdi, Mozart) et à l’Opéra national de Vienne, entre autres, affiche une longue et émérite carrière de metteur en scène. En 1999, il contacta Pino Donghi, chargé de la communication des sciences à la fondation Sigma Tau, une organisation à but non lucratif sise à Rome, fondée en 1986 « pour avancer la recherche, promouvoir le progrès scientifique et culturel, et préserver les découvertes de la recherche scientifique », ce qu’elle réalise en parrainant des « séminaires, colloques, conférences, tables-rondes et spectacles pour stimuler et diffuser la culture scientifique » (propos tirés du site Internet : www.sigma-tau.it/eng/fondazione_sigma_tau.asp). Durant de nombreuses années, Donghi a été le principal instigateur des expériences novatrices du théâtre dans le domaine de la science ; il a contribué à porter à la scène des productions comme INFINITIES (INFINIS) et BIBLIOETICA, en collaboration avec Ronconi. Donghi rappelle que « le fait même que Luca Ronconi nous ait contactés et nous ait demandé de l’aider à réaliser un projet nous a plongés dans un état de confusion euphorique » 1. Ronconi est convaincu que tutto i rappresentabile : il est possible de représenter toute sorte de textes, même un texte scientifique. Comme il le raconte, Ronconi s’adressa à Donghi « pour tenter de comprendre si l’idée de mettre en scène un texte scientifique a du sens ». Il lui demanda des suggestions, et Donghi lui proposa Gould, selon lui le scientifique idéal pour faire « une série de conférences ou d’entretiens imaginaires » 2.
De janvier 1999 à début 2000, Donghi et Gould correspondirent au sujet de ce projet, Donghi représentant Ronconi dont il transmettait les idées concernant la mise en scène d’«entretiens imaginaires ». Cette correspondance non publiée (gracieusement mise à ma disposition par Donghi) montre l’évolution des idées, amenées avec diplomatie et délicatesse par Donghi face aux longs silences de Gould, ponctués de missives concises et plutôt prudentes. Il semblait intéressé, mais de plus en plus distant ; une impression de réticence récurrente dans les échanges, que l’on peut rétrospectivement attribuer à un emploi du temps extraordinairement chargé (parfois, Gould ne pouvait même pas signer ses lettres, mais devait les dicter), aux préoccupations concernant sa santé déclinante, et peut-être à une pointe de scepticisme concernant l’aboutissement du projet. Nous ne saurons jamais à quoi aurait pu ressembler cette « pièce perdue », l’impact qu’elle aurait eu comme pièce de théâtre, comme contribution à la compréhension de la science par le public, comme nouvelle avancée de l’interface science/sciences humaines – et, tout particulièrement concernant la défense de Darwin, la possibilité de continuer à répandre la théorie de l’évolution face à ce que George Levine a appelé une hostilité de plus en plus alarmante et irrationnelle envers Darwin, en particulier aux États-Unis 3. Gould, après tout, passa l’essentiel de sa carrière à écrire passionnément sur la théorie de l’évolution, corrigeant les idées fausses et les erreurs d’interprétation au sujet de la théorie de Darwin, avançant sa propre version du darwinisme, et se battant avec ce qu’il appelait les « charlots » du Kansas et autres anti-darwiniens fondamentalistes. Je m’appuierai ci-après sur la correspondance de Gould et Donghi pour imaginer la nature du projet théâtral Gould-Ronconi tel qu’il s’esquissait et le rôle qu’il aurait pu jouer en tant qu’alliance entre science et théâtre.
Cette correspondance se compose essentiellement de longues explications de Donghi concernant ses idées et celles de Ronconi, auxquelles Gould répondait très succinctement et avec détachement. Dans la première lettre, par exemple, Donghi détaille l’idée de « conférences ou entretiens imaginaires » :
« Vous pourriez écrire un entretien imaginaire avec Darwin… à la fin du millénaire, examinant ses idées à partir de leurs conséquences, des controverses qu’elles ont soulevées, de leurs éventuels nouveaux développements… Essayer de faire parler Darwin, avec ses propres mots, montrant ses idées et ses sentiments. Ce texte pourrait être présenté, voire joué par vous, si vous vous en sentez le courage, ou représenté en italien par un acteur, puis donner lieu à un débat avec vous. Dans le cas d’un dialogue, vous pourriez jouer le rôle de l’interviewer, même si vous seriez l’auteur de l’intégralité du texte. » (20 janvier 1999)
Gould répondit avec enthousiasme trois semaines plus tard : « Quelle idée intéressante!… Je crois pour sûr que tutto e representable [sic].» Il suggère alors pour matériau certains de ses courts essais mensuels, plutôt que ses livres plus étoffés, « puisque ce sont en général des histoires plus ciblées, parfois conçues à la manière d’un drame classique, avec un début, un milieu, et une intrigue allant de l’avant ». Gould témoigne ainsi d’une notion relativement traditionnelle ou conventionnelle du théâtre, déterminé par la narration et centré sur une intrigue linéaire. Il dit apprécier l’idée d’entretiens imaginaires avec Darwin « ou une autre grande figure de l’histoire de notre science », tout en soulignant qu’il n’a pas le temps de s’occuper personnellement de la rédaction mais serait ravi de faire des suggestions « sur des textes écrits par d’autres, et même (si j’en trouvais le courage) m’essayer à les présenter, même (que Dieu me pardonne) en italiano » 4.
L’éventuelle réserve de Gould peut difficilement être attribuée au manque de confiance en soi et/ou à la peur de jouer, ou d’endosser le rôle de Darwin, Gould ayant longtemps été un locuteur compétent et recherché (je l’ai entendu en 1988, alors qu’il prononçait un discours fascinant à la remise des diplômes de mon université – il fut capable de capter toute l’attention d’une bande d’étudiants exagérément exubérants). Elle indiquerait plutôt selon moi la tension naissante entre, d’une part, le désir de Gould d’essayer de faire sur scène le portrait de l’homme auquel il avait littéralement voué sa carrière et, d’autre part, sa méfiance quant à la forme exacte que prendrait ce portrait. Comme le montre la correspondance, Gould ne se départit jamais dans ses réponses de sa méfiance initiale, malgré les talents d’accoucheur de Donghi.
Donghi répond de manière rassurante, en le remerciant de son « courage ». Il relaie la conception de Ronconi :
« L’idée de Ronconi a cela de radical qu’il veut, par la rencontre avec le texte scientifique, donner au théâtre une autre possibilité d’évolution ; il a besoin de textes ne présentant aucune correspondance avec les langages conventionnels du théâtre, afin d’expérimenter et d’explorer de nouvelles opportunités, d’ouvrir de nouvelles perspectives. En d’autres mots, ce n’est pas uniquement un problème de thèmes : il n’éprouve par exemple aucun intérêt à l’idée de mettre en scène certains cas d’Oliver Sacks, comme le fait actuellement Peter Brook [THE MAN WHO…(L’HOMME QUI…), écrit avec Marie-Hélène Estienne],même s’il apprécie l’idée et qu’il est fondamentalement intéressé par son résultat. » 5