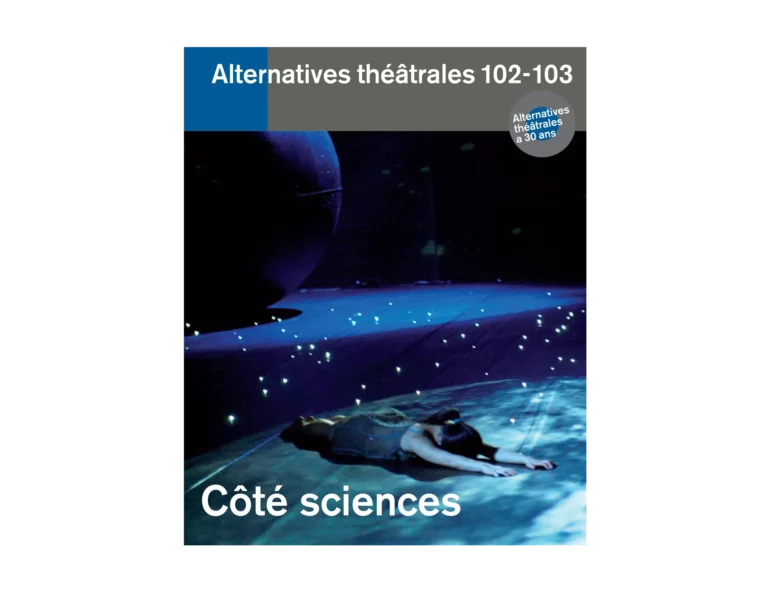DEPUIS quelques années, les sciences exactes sont décidément à la mode dans les théâtres londoniens. Sur la scène du National Theatre, les personnages de Charlotte Jones plaisantent au sujet de la théorie du chaos 1. Au Barbican, la compagnie Complicite couvre allègrement la scène d’équations différentielles. Certes, une horreur feinte est toujours de rigueur : « c’est terrifiant », s’exclamait l’un des acteurs de Complicite au début du spectacle A DISAPPEARING NUMBER, devançant ainsi la réaction du public face à l’équation complexe qu’on venait d’inscrire sur un tableau blanc. Mais les professions d’effroi servent davantage à rassurer le nouveau-venu qu’à lui faire peur. Car depuis le succès d’ARCADIA au début des années quatre-vingt-dix, le discours des mathématiques, de la physique et des sciences naturelles sert régulièrement d’outil dramaturgique à la création contemporaine.
Les exemples les plus célèbres de ce phénomène sont sans doute ARCADIA de Tom Stoppard et COPENHAGEN de Michael Frayn, deux pièces qui transforment des concepts mathématiques et physiques en métaphores pour les situations humaines qu’elles évoquent. Ces chemins métaphoriques ont aussi été explorés par Timberlake Wertenbaker, qui a mis en scène de grands tournants de l’histoire des sciences dans AFTER DARWIN et GALILEO’S DAUGHTER 2. Je donnerai toutefois ici un éclairage différent de cette tendance, en examinant de plus près le rôle du discours scientifique chez les compagnies de théâtre qui l’ont intégré à une expérimentation formelle. Il s’agit de compagnies relativement jeunes, fondées dans les années quatre-vingt ou quatre-vingt-dix, et dont le travail collectif s’est inspiré pendant deux ou trois spectacles d’une science particulière : Complicite et On Theatre à Londres, mais aussi Stan’s Cafe à Birmingham ou Unlimited Theatre à Leeds. Ces artistes trouvent dans le discours scientifique une inspiration formelle, source de schèmes narratifs et scénographiques. Je m’intéresserai ici particulièrement à deux de ces compagnies : Complicite, qui est dirigée depuis 1992 par Simon McBurney, et On Theatre, qui est dirigée depuis sa création par Mick Gordon.
Simon McBurney et Mick Gordon ont tous deux cherché à présenter la rencontre du théâtre et des sciences comme le résultat d’affinités évidentes. Gordon, qui a créé ce qu’il appelle des « essais théâtraux » en collaboration avec le neurologue Paul Broks, parle d’un « langage commun » à la neurologie et au théâtre. Il souligne ainsi l’existence de préoccupations communes aux deux domaines, dans un rapprochement qui rappelle celui opéré par son mentor, Peter Brook, dans L’HOMME QUI ET JE SUIS UN PHENOMENE. L’acteur comme le neurologue doit observer de près le comportement humain, et tous deux interrogent les notions d’identité, d’authenticité et de motivation. Mais la ressemblance est également rhétorique, car Gordon dit avoir été frappé par l’importance des questions narratives dans la neurologie (notamment celle du récit de soi) et son recours heuristique à la métaphore : « du fantôme dans la machine ou l’homunculus aux analogies entre le cerveau et l’ordinateur » 3. Avant même que l’artiste ne s’y intéresse, le discours neurologique serait donc déjà poétique.
McBurney, qui s’est inspiré de la neurologie et des mathématiques, insiste également sur les affinités entre son travail et celui des chercheurs. A DISAPPEARING NUMBER (2007) explore la question de l’«imagination » mathématique et cite fréquemment l’ouvrage de G. H. Hardy, A MATHEMATICIAN’S APOLOGY, qui examine la dimension créatrice de cette discipline. « Le mathématicien », écrit Hardy, « comme le peintre ou le poète, est un créateur de formes» ; « Les formes du mathématicien, comme celles du peintre ou du poète, doivent être belles » 4. Ces phrases sont citées au début du spectacle, et l’intégration des mathématiques au texte de théâtre est ainsi présentée d’emblée comme un rapprochement de deux pratiques formelles et esthétiques. Le terme utilisé par Hardy dans le texte original, « patterns », est d’ailleurs plus précis que le mot « forme » : il évoque l’idée de la régularité et du motif récurrent, et le mot « schème » en serait peut-être une meilleure traduction. Ce terme apparaît également dans l’autre spectacle scientifique de Complicite, MNEMONIC (1999), qui s’inspire de la neurologie et des mathématiques du chaos pour explorer le thème de la mémoire. Dans le prologue de MNEMONIC, McBurney décrit plusieurs « patterns » : les processus neuronaux de fragmentation et de reconnexion qui sont inhérents à l’acte de mémoire, et les formes infiniment complexes de la géométrie fractale. Ces deux schèmes sont présentés comme des idées directrices qui vont structurer la forme fragmentée de la pièce. Dans ces deux spectacles, les sciences sont ainsi perçues comme une entreprise de modélisation du réel, susceptible de fournir de nouvelles formes au théâtre.
Pour ces metteurs en scène, la science est donc plus qu’un thème : c’est un langage dont le théâtre va s’inspirer. Gordon et McBurney se placent dans un rapport affiché d’intertextualité et d’interdiscursivité avec leur matériau scientifique. Dès le paratexte, leurs spectacles se présentent comme un dialogue avec une ou plusieurs voix expertes. Le neurologue Paul Broks est le co-auteur des deux pièces neurologiques de Mick Gordon, ON EGO (2005) et ON EMOTION (2008). McBurney, quant à lui, cite abondamment ses sources dans les programmes et sur le site Internet de Complicite, et parfois dans le texte du spectacle. Le texte publié de MNEMONIC comprend même un appendice bibliographique, dans lequel apparaissent des noms comme James Gleick, Stephen Jay Gould ou Oliver Sacks 5. Lors de la création d’A DISAPPEARING NUMBER, la compagnie a choisi de faire appel à un « consultant » mathématicien, Marcus du Sautoy, dont le rôle était souligné par la mise en ligne sur le site Internet de la compagnie d’enregistrements vidéo des ateliers qu’il avait organisés pour les acteurs. À travers ces multiplesréférences, la scène est présentée comme un espace de dialogue, où les langages du théâtre rencontrent ceux du laboratoire.
Comme tout dialogue, celui-ci peut tendre vers l’accord comme vers le désaccord. De ce point de vue, la comparaison entre Gordon et McBurney est particulièrement intéressante, car ces deux metteurs en scène ont travaillé dans des directions quelque peu différentes. McBurney a développé une poétique de la résonance, où les motifs scientifiques sont repris et amplifiés par le dialogue et la scénographie. Gordon, par contre, cherche davantage à éprouver les concepts qu’il emprunte, et met en quelque sorte le discours neurologique au banc d’essai de la scène. Ce contraste est particulièrement clair lorsqu’on compare les deux spectacles quasiment contemporains que sont A DISAPPEARING NUMBER et ON EGO.
A DISAPPEARING NUMBER s’inspire d’un épisode célèbre de l’histoire des sciences : la collaboration entre le mathématicien cambridgien G. H. Hardy et son protégé indien Shrinivasa Ramanujan, venu travailler avec lui en Angleterre pendant la Première Guerre mondiale. L’amitié et la passion mathématique des deux chercheurs sont perçues à travers le regard d’un personnage contemporain qui vient de perdre sa femme, également mathématicienne. Tandis que Hardy et Ramanujan tentent de percer le mystère des nombres premiers, Al se remémore sa vie avec Ruth et cherche à comprendre son admiration pour l’œuvre de Ramanujan. Ponctué par des scènes de conférence dans lesquelles Ruth explique des notions de la théorie des nombres, le spectacle se construit autour d’une fascination pour la pensée mathématique.
La structure dramatique et la scénographie révèlent une recherche systématique des correspondances entre les concepts mathématiques et la situation des personnages. Comme tous les spectacles de Complicite, A DISAPPEARING NUMBER interroge le rapport de ses protagonistes au passé. D’après McBurney, la compagnie s’intéresse à « une perte de continuité entre le passé et l’avenir ; une perte de connexion entre nos morts et ceux qui ne sont pas encore nés » 6. Son travail contient ainsi une thématique récurrente du déracinement et de la rupture avec le passé, qui rappelle l’«amnésie historique » décrite par Fredric Jameson dans ses analyses de la culture postmoderne 7. Dans A DISAPPEARING NUMBER, ce déracinement est incarné par les personnages indiens : Ramanujan, qui ne parvient jamais à s’adapter au climat et à la vie anglaise, et meurt de tuberculose peu après son retour en Inde, mais aussi Al, un trader américain d’origine indienne qui travaille dans le « marché des futures » et qui retourne en Inde pour la première fois à la fin de la pièce. Les ruptures géographiques et temporelles sont soulignées par les nombreux espaces transitoires du spectacle (chambres d’hôtel, trains, bateaux, avions), ainsi que par l’enchaînement rapide de scènes se jouant à différentes époques. Et l’espace ainsi disloqué est hanté par la mort, car celles de Ramanujan, de Hardy, de Ruth et de son enfant mort-né sont rejouées à plusieurs reprises.
À ces ruptures spatio-temporelles vont répondre des images mathématiques de la division et de la continuité. La fragmentation de la fable caractéristique des spectacles de Complicite est renforcée par les références à la partition et à la décomposition des nombres. Il s’agit de deux modes de division des nombres entiers : la « décomposition » consiste à réduire un nombre à un produit de nombres premiers, et la « partition » à déterminer le nombre de façons dont on peut le diviser en d’autres nombres entiers, la « fonction partition » étant l’un des champs de recherche dans lesquels Ramanujan et Hardy ont fait des découvertes importantes. Ces deux concepts sont employés à des fins métaphoriques et scénographiques. La notion de décomposition est introduite pendant une scène de deuil, où la troupe opère la décomposition du nombre de blessés et de morts pendant la Première Guerre mondiale. Quant à la partition, elle informe toute la scénographie, car la scène est constamment divisée par des lignes de séparation imaginaires ou réelles, notamment par une série d’écrans pivotants qui matérialisent les divisions culturelles et historiques entre les personnages.