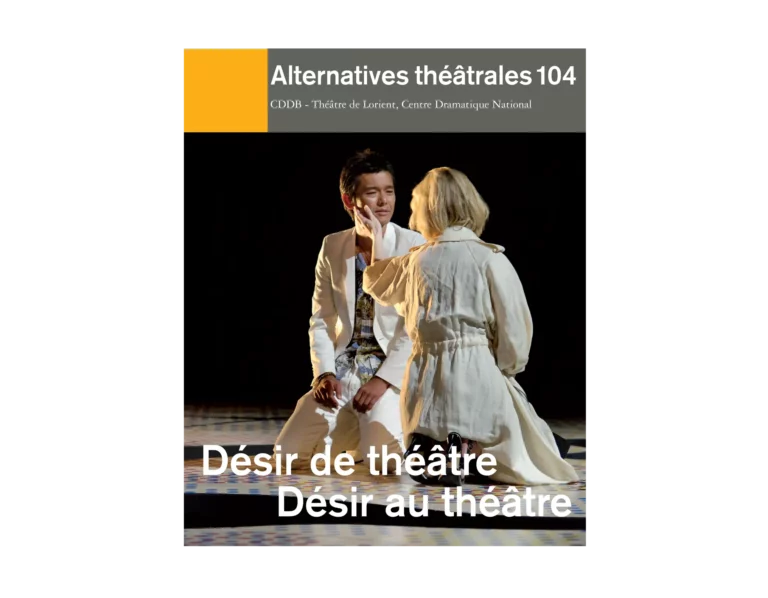ANTOINE LAUBIN : Vous bénéficiez d’une reconnaissance réelle en matière littéraire et cinématographique. Que vous apporte le théâtre que l’écriture et le cinéma ne vous apportent pas ? Quel manque ce désir de théâtre reflète-t-il ?
Christophe Honoré : Il ne s’agit pas vraiment d’un manque. C’est lié à l’adolescence : j’avais créé une troupe de théâtre amateur. À seize ans, j’avais monté LA MUSICA de Duras. Ça nous intéressait de proposer autre chose que ce que faisaient les troupes de patronage. Dès cette période, je suis allé au théâtre avec beaucoup d’intérêt. Mais cet intérêt n’était pas professionnel puisque je savais que je voulais être cinéaste. Ensuite j’ai écrit une pièce de théâtre, LES DÉBUTANTES et ça m’a plu. L’envie de mise en scène aujourd’hui est née de la frustration dans la relation aux acteurs lors des tournages. J’avais envie de temps avec les acteurs et la réalité technique d’un tournage en propose peu.
A. L. : Dans vos films, comme dans ANGELO, les motifs ludiques, procédant d’un décalage face au désir du spectateur, sont nombreux. Dans des registres différents, on peut citer le face caméra inaugural de DANS PARIS, la danse folklorique dans NON MA FILLE TU N’IRAS PAS DANSER ou le traitement des sbires dans ANGELO. À quel désir cela correspond-il ?
C. H.: Je me suis aperçu que c’était constitutif de ma manière de faire : je souhaite remettre le spectateur à sa place de spectateur. J’aime raconter des histoires, j’ai de moins en moins peur du récit, de jouer avec l’identification, mais je considère aussi de plus en plus la présence du spectateur, la possibilité de m’adresser à lui. À mes débuts, je ne considérais pas du tout le spectateur ; aujourd’hui je joue avec son attente. Je déteste les films qui présentent les choses de manière univoque et ne replace jamais le spectateur dans sa position. J’ai besoin d’appuyer le fait qu’on est en train de montrer un spectacle. Je me suis beaucoup amusé à proposer de l’artifice dans ANGELO. Ici, l’enjeu était de mettre en place le mélange du trivial et du sublime voulu par Hugo autrement que par l’alternance des scènes mais dans une sorte de simultanéité : l’inconscient des personnages est traité de manière grotesque par les sbires, dans les étages.
A. L. : Dans vos films, les personnages sont souvent en lutte pour le désir, ce sont des personnages « désirant désirer ». Ici, comme dans plusieurs de vos films, le désir est associé à la fois à une pulsion de vie et à une certaine tendance mortifère.
C. H.: Je m’étais aperçu de ça sur l’adaptation de MA MÈRE de Bataille. La question du désir était très lié à la mort. La mort rode beaucoup dans mes films et des personnages se débattent face à ça. Tout ça n’est pas vraiment délibéré. L’idée que le désir est toujours lié à la vie me semble un peu crétin. J’aime les personnages chez qui le désir est lié à la mort. C’est assez complexe à représenter au cinéma…
A. L. : Dans DANS PARIS, grâce à l’opposition mise en place entre le personnage de Romain Duris et celui de Louis Garrel, c’est assez clair…
C. H.: Oui, dès que j’ai trouvé qu’un des deux personnages serait tout le temps en mouvement et l’autre pas du tout, ça a été très simple. Mais je ne suis pas si certain que la frontière entre désir de vie et de mort soit si claire.