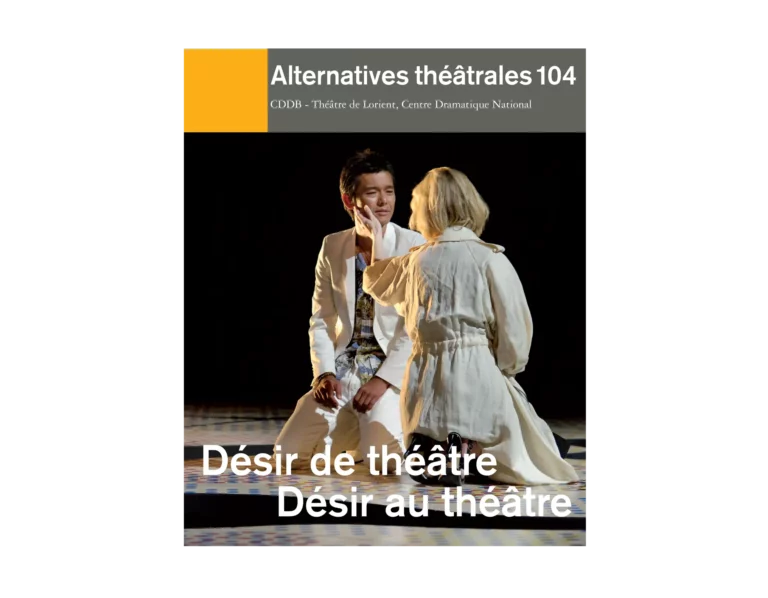La fascination du trouble
TRAVERSÉE DE MANNEQUINS d’une immobilité perturbante, l’œuvre de Gisèle Vienne déploie, pièce après pièce, le trouble de présences qui oscillent entre la vie et la mort. Leur inquiétante étrangeté, union du familier et de l’étrange selon la notion freudienne, agit en correspondance avec le Théâtre de la mort de Kantor qui a ouvert la scène moderne à la loi des contrariétés. I APOLOGIZE (2004) présente des corps revenants ou fantasmés à partir de la reconstitution d’un accident. Faisant de la scène un espace happé par un désir de mort, poupées et mannequins y sont d’une envoûtante hybridité. Avec JERK (2008), Gisèle Vienne se concentre sur une pratique traditionnelle de la marionnette. L’imperfection des marionnettes étant inhérente à leur charge plastique et dramatique, elle s’intéresse moins à la magie de la manipulation qu’au trouble qui en émane : « Les formes anthropomorphes n’ont rien perdu du trouble qu’elles génèrent : on les retrouve dans le champ contemporain, avec la nécessité de la reproduction humaine à travers ces médiums1. »
Inscrite dans une forme artistique nouvelle, l’inquiétante étrangeté prend en compte le cheminement depuis un corps mécanique à un corps libéré. SHOWROOMDUMMIES, créé avec Étienne Bideau-Rey en 20012 et dans une nouvelle version en 2009, croise le réel et l’irréel à travers une poétique du corps qui opacifie la forme. Personnage révélateur de ce type d’hybridité, la femme masquée manifeste une nature non unifiée, dissociée. Proche de l’effroi. Certes, le masque fige la dynamique du mouvement mais, lorsque son corps s’immobilise, l’expression statique de son sourire s’anime. Ce qui choque dans la complexité de son identité est moins sa nature double que celle, essentiellement trouble, qui relève simultanément de l’animé et de l’inanimé. Collant une image sur un corps qui se dérobe, elle crée un personnage fantasmatique, que nous ne pouvons plus délimiter en terme de réel et d’imaginaire. Dans les basculements incessants entre l’émanation de vie qui se dégage des mannequins et celle de mort qui enveloppe les acteurs, tout repose sur un phénomène de simultanéité. De là aussi certainement la fascination de Gisèle Vienne pour les corps androgynes, autre forme de l’hybride.
Corps impossibles
Corps pétrifiés et poupées animées composent une théâtralité du trouble qui aboutit au passage du corps vivant à l’image. La rupture incessante créée par une danse fluide et un jeu réaliste soudain fragmentés, désincarnés, fait surgir cet état fragile et violent où le corps devient image. Gisèle Vienne considère l’immobilité comme une posture des plus intenses, un « basculement ultime vers l’irréel* ». Son langage chorégraphique unit dans une même dynamique corps vivants et inanimés ; la combinaison des instincts de vie et de mort agit simultanément sur tous.
Objets fétiches dans le milieu de l’art et de l’érotisme, chargés d’une lourde histoire faite de contradictions, poupées et mannequins touchent autant la religion que le commerce de l’érotisme dans leur dimension transgressive et immorale. Les poupées en jupette et blazers, jambes ouvertes face au public, offrent imprudemment leur innocence aux regards. Figures immobiles, fillettes immémoriales, la poupée apparaît dans sa forme érotique et provocante. On pense au désordre émotionnel des JEUX DE LA POUPÉE de Bellmer. Corps impossible qu’il dit morbide, l’obsessionnelle poupée y est tout à la fois interdite et offerte. Nous sommes au cœur de la contradiction entre l’interdit et la transgression sur laquelle Bataille fonde l’érotisme, et Gisèle Vienne son travail3.
SHOWROOMDUMMIES fait explicitement référence à LA VÉNUS À LA FOURRURE de Sacher-Masoch, texte clef sur les liens étroits entre les objets anthropomorphes et érotiques, accordant érotisme et répulsion dans un même élan de théâtralisation des fantasmes. Le cérémonial du châtiment, la délectation de la douleur et de l’humiliation, particuliers à celui que la psychanalyse a retenu comme modèle d’une perversion dite « masochiste », est peut-être plus présent dans I APOLOGIZE et UNE BELLE ENFANT BLONDE. SHOWROOMDUMMIES se concentre sur la fascination des femmes impérieuses et les tensions du désir face à une inertie déstabilisante. Sur le plateau, pas de Vénus proprement dite mais des mannequins de vitrine, une Wanda « en série ». Si on reconnaît la Vénus de pierre et le caractère glacial de Wanda à la beauté parfaite, le corps stylisé, icône désacralisée, renvoie un idéal contemporain né du marché du sexe, démocratisé à l’extrême. Dans son éloignement du quotidien, il fait référence à l’univers fantasmatique de Pierre Molinier. Trouvant auprès de cet érotisme fétichiste, au surréalisme immoral, l’expression artistique de perversions sexuelles excessives, SHOWROOMDUMMIES prolonge le désir de Molinier de « préciser » à travers ses photomontages l’image de la femme idéale qui lui donnera la satisfaction suprême et qu’il recompose inlassablement. La pièce interroge l’influence de la représentation du corps sur notre imaginaire érotique, elle la travaille à partir de stéréotypes et crée à partir d’eux de nouvelles figures idéalisées. ÉTERNELLE IDOLE (2008) joue sur la fascination d’un corps proche et lointain, étrangement présent, effroyablement absent. Le parti pris de monter cette pièce dans une patinoire est un choix scénographique et symbolique fort. Dans ce décor de glace, la patineuse –fantôme d’une Lolita assassinée – relie l’immémorial et l’actuel. De l’état de fantôme à celui d’image, elle impose son innocence dans une forme fantasmée.
Figure venue de la nuit des temps, le motif de la fillette morte est une des émanations les plus vives de l’interférence entre l’érotisme et la mort. Le personnage récurrent de la Lolita est lié à un imaginaire récent, depuis Nabokov jusqu’à Robbe-Grillet. L’éternelle idole de Gisèle Vienne est d’ailleurs directement influencée par Laura Palmer dans TWIN PEAKS de David Lynch. Le corps mort se montre dans une beauté souveraine. Son innocence manifeste un érotisme perturbant. Gisèle Vienne appose à l’image de la Lolita son double masculin : jeune homme très beau, rocker un peu perdu, totalement désespéré. Il correspond à un stéréotype issu des années quatre-vingt-dix, avec Gus Van Sant et bien sûr le George Miles de Dennis Cooper. Ces deux figures jumelles, toujours duelles, se rencontrent justement dans THIS IS HOW YOU WILL DISAPPEAR. Que ce soit dans l’innocence ou le désespoir suicidaire, une tension de forces contraires se met en place, de l’innocence à l’impur, de la beauté à la déchéance. La beauté importe ici dans le désir de la profaner, l’essence de l’érotisme étant liée à la souillure, le sens dernier de l’érotisme, la mort.
- G. Vienne, entretien avec Chantal Hurault, 29 janvier 2010.
Les citations signalées par un astérisque proviennent du même entretien. ↩︎ - Voir le texte de Gisèle Vienne et Étienne Bideau-Rey, « Érotisme, Mort et mécanique…» publié dans Alternatives théâtrales no 80, Objet-Danse, 4e trimestre 2003. ↩︎
- Les références à Georges Bataille, sauf indication contraire, sont extraites de L’ÉROTISME, texte essentiel dans l’œuvre de Gisèle Vienne. ↩︎
- M. Blanchot, LAUTRÉAMONT ET SADE, Éditions de Minuit, 1990. ↩︎
- J. de Berg, Cérémonies de Femmes, Grasset, 1985. ↩︎
- G. Deleuze, Présentation de Sacher-Masoch, Éditions de Minuit, 1967. ↩︎