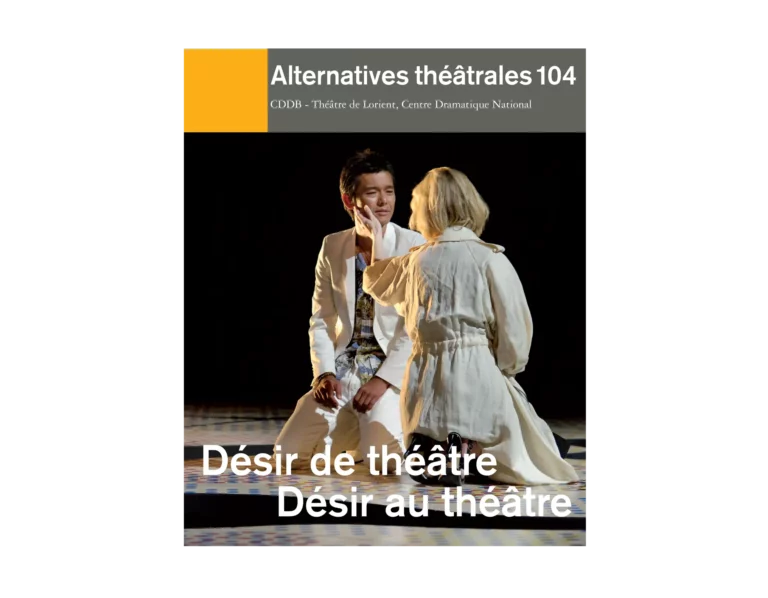« DEPUIS MA PLUS TENDRE ENFANCE il habite parfois un recoin de mon ombre et j’y devine comme une partie obscure qui ne serait pas moi1 ».
Pendant que les derniers spectateurs s’installent, un homme entre en scène, en pyjama et les yeux encore pleins d’un sommeil profond, irrité d’avoir été sorti brusquement de ses songes. C’est Wladyslaw Znorko qui vient présenter en quelques mots sa nouvelle création, MON GOLEM. Il prévient les spectateurs qu’ils ne sont pas au théâtre mais dans une chambre, qu’il ne s’agit pas d’un spectacle à proprement parler mais d’une halte au pays de l’imaginaire. Il les invite à s’endormir. Avant de se retirer, un dernier avertissement : ce n’est pas la vraie histoire…
Immédiatement placée dans une atmosphère poétique, la représentation commence, telle une dérive à l’intérieur de la légende du Golem. En donnant les clefs de son spectacle, et disant en même temps que le trousseau est égaré, Znorko expose les enjeux d’un théâtre qui réclame une distance avec l’histoire, proposant l’espace de la scène comme un lieu de mémoire, lieu de l’écho et de la résonance. Il s’éloigne du « vrai » Golem pour approcher son énigme, privilégiant l’invention sur la restitution : « Après ces années d’études à lire et à relire les différents états civils et le parcours très insolite et souvent à contre-courant du Golem, je me retrouve devant tant de cartes et de certificats authentifiant ses origines et augurant du lieu de ses apparitions futures que je préfère me taire. […] Sans compter sur ce nigaud qui pose toujours la même question : Le Golem existe-t-il vraiment ? »
Si Znorko parle rarement de ses filiations, il précise des ramifications à l’occasion d’un premier travail de création franco-russe effectué autour du Golem en 2008, TROP PRÈS DE L’HORIZON : « Il y a entre l’œuvre de Tadeusz Kantor et celle de Samuel Beckett un espace qui donne le vertige, non qu’il soit vide, mais il semble infini et peuplé de miettes de consistance. C’est sur ces miettes-là que je travaille depuis quelques années, en ayant la certitude qu’après tout ce temps passé à déblayer le sable de la rivière, le chercheur d’or va trouver encore une pépite et son secret. » L’HISTOIRE SANS FIN DE MON GOLEM ouvre un cycle de créations qui reprend chaque fois les restes de ces riens.
On ne sait pas grand chose sur le Golem, hormis qu’il est né des mains d’un rabbi kabbaliste, le Haut Rabbi Loeb, dit le Maharal de Prague. Il aurait créé ce géant à forme humaine à partir d’une masse d’argile pour protéger la communauté juive du pogrom qui la menaçait. Le Golem porte sur son front un signe, le mot hébraïque « EMET » qui signifie « Vérité ». C’est ainsi que le Maharal lui aurait insufflé la vie. Mais si on retire la première lettre, comme le Rabbi le faisait les jours de chabbat, il reste « MET », c’est-à-dire « Mort ». C’est précisément un jour où il aurait oublié d’enlever la lettre que sa créature se serait révoltée, employant soudain sa force pour détruire le ghetto de Prague. Ramené à la poussière par le Maharal lui-même, il réapparaîtrait tous les trente ans. LE GOLEM de Gustav Meyrink raconte à travers la longue pérégrination onirique d’un jeune homme amnésique sa survivance dans la mémoire collective du ghetto de Prague : « Évidemment, je ne sais sur quoi repose l’origine de l’histoire du Golem, mais je suis sûr qu’il y a dans ce quartier de la ville quelque chose qui ne peut pas mourir, qui hante les lieux et garde une sorte d’existence indépendante. » Exception faite de ce roman de référence paru en 1915, Znorko insiste sur la rareté des écrits au sujet du Golem et précise qu’il n’y a qu’un mot biblique pour l’identifier, qui veut dire « peau de terre cuite mal fini sans forme ni contours ».
Le Golem étant intimement lié au Maharal qui l’a créé, la question de la représentation du Maharal s’est imposée au metteur en scène. Il l’a imaginé dans le corps d’une marionnette, retrouvant par là, de façon détournée si ce n’est inversée, sa relation fusionnelle avec sa créature de glaise. Ce choix joue également sur un décalage avec les acteurs. La marionnette au visage d’antan incarne d’autant plus le mystère du Maharal. Elle viendrait de « l’ombre du père qui traîne derrière lui le souvenir de paroles intérieures* ». On parvient à une particularité essentielle du mythe, son interaction avec la réalité. Car le Golem fait partie de ces mythes liés à la réalité, en l’occurrence l’existence historiquement datée du Haut Rabbi Loeb, qui vécut au XVIe siècle. Le mythe a progressivement pris le pas sur la réalité, et la personne « réelle » s’est effacée derrière le personnage légendaire : le Maharal de Prague n’a plus existé qu’en rapport au Golem. C’est notamment grâce à Henri Neher que le Maharal a été détaché du mythe, et que sa pensée a pu être reconnue et étudiée. Ce qui nous intéresse ici est la confusion entre l’histoire et la légende, sachant qu’il y aurait un manuscrit, daté de 1586 et rédigé sous la dictée du Haut Rabbi Loeb, qui relaterait en détail la création du Golem. Face à ce sujet polémique pour les historiens, Henri Neher dit choisir aujourd’hui le doute. Vrai ou faux, le manuscrit ne fait qu’accroître la dimension magique du Golem. Il ne sera pas question chez Znorko de la réalité ou non du Golem, mais de l’irréductibilité de sa présence à nos côtés : « J’étais un enfant très distrait et je traversais la rue sans voir les voitures passer à toute allure. Je sentais parfois une main sur mon épaule, je me retournais et il n’y avait personne. Mais la voiture était passée*.» Travaillant l’indiscernabilité du réel et de l’irréel, le merveilleux nous rend plus familiers de l’inconcevable. La théâtralité fonctionne sur une apparente simplicité qui sert justement à atteindre des zones affranchies de toute logique, un mode de pensée entièrement convoqué par l’imaginaire.
«Et encore ne s’agit-il que du Golem qui est né un jour dans mon ombre, s’il était question, en plus, de parler de celui qui se tapit dans la vôtre, vous imaginez un peu l’étendue du voyage ! »
De pure tradition orale, l’histoire du Golem est passée de bouche en bouche, les grands-mères la racontaient aux enfants pour les endormir, selon leur propre version, selon leur humeur. « C’est ce que j’ai voulu garder* » dit le metteur en scène. Il travaille depuis ses débuts à partir de l’imaginaire commun construit autour de personnages littéraires qu’il relie à d’autres personnages fictifs ou réels. Il aime les histoires dont on se rappelle sans pouvoir précisément les raconter, les personnages que l’on connaît sans savoir vraiment raconter leur histoire. Le Golem fait partie de ses premiers compagnons de route même si ce n’est qu’aujourd’hui qu’il lui consacre une pièce entière. Il lui a fallu se détacher de son Golem pour l’inventer à plusieurs, théâtralement. Suivant la voie du conte et se rappelant les histoires qu’on lui racontait enfant, il l’a invité à entrer dans son théâtre. Le Golem s’est laissé approcher, laissant planer son ombre sur le plateau.
Dès lors, le spectacle croise plusieurs histoires et différentes voix détentrices de ladite « vérité ». On retrouve le précepte décliné dans ALPENSTOCK (1998) où « Rien de tout cela n’est la vérité, rien non plus n’est complètement faux. » Définissant ainsi les enjeux de la fiction, la pièce s’inscrit au cœur de cette problématique. À la suite du « lever de rideau » du metteur en scène, une jeune fille en chemise de nuit ouvre la représentation. Elle s’insurge immédiatement contre le spectacle, reprenant à son compte la sentence originelle : « Ce n’est pas la vraie histoire ! » Elle ne cessera plus après de dénoncer le leurre. La voix de l’enfance est aussi celle qui recueille en son sein le Golem de nos rêves d’enfant, ce « compagnon obscur » dont on était auparavant si familier et que l’on a oublié. La fillette est entièrement rattachée au monde du sommeil. Sachant que la scénographie se compose de trois cabanes, chacune habitée par des personnages différents, son espace privilégié à elle est un buffet dont la partie supérieure est vitrée où elle vient s’endormir, bercée par les histoires qu’on lui chuchote à l’oreille. Celle du Golem sans aucun doute. Celui qui nourrit ses rêves est le Maharal, son père.
Lorsque la jeune fille s’oppose au Maharal en répétant que « ce n’est pas la vraie histoire », les niveaux de narration se brouillent. La marionnette, qui représente l’autorité suprême puisque c’est le Maharal, interrompt la jeune fille à l’instant où elle commençait à nous raconter la vraiehistoire, celle qu’on connaît : comment cette créature de glaise, muette et sans âme, a été créée, comment elle s’est révoltée… Le ton monte, la marionnette-Maharal s’énerve en donnant sa version. Mais si l’on tend instinctivement l’oreille pour connaître enfin la vraie vérité, c’est en langage imaginaire que le Maharal livrera son secret – laissant intacte sa part de mystère.