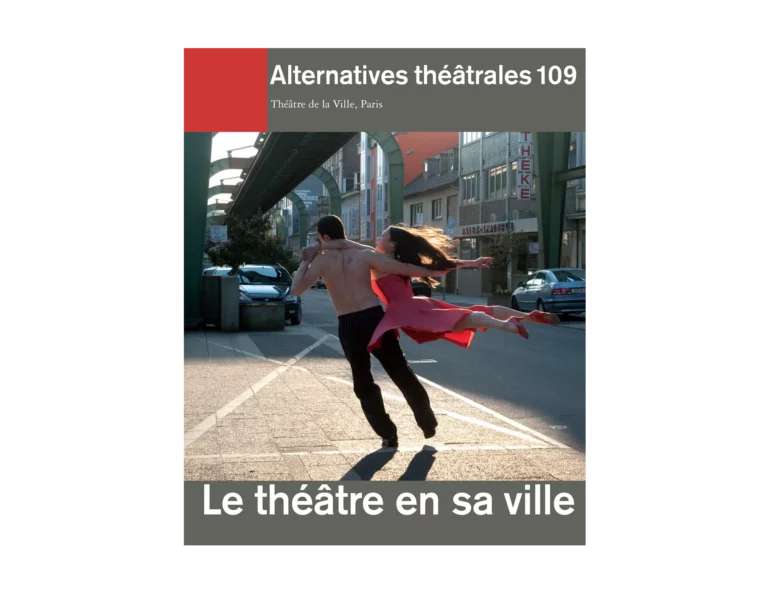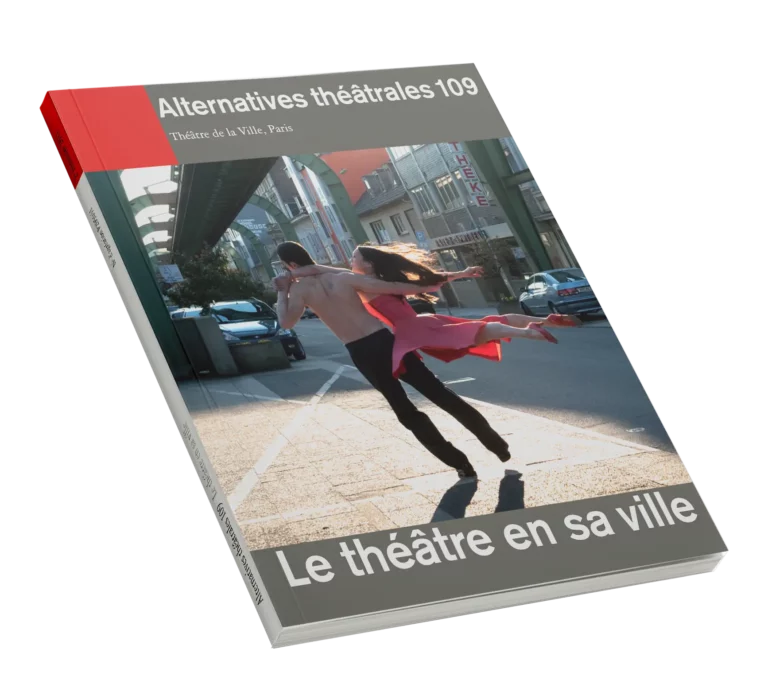À Paris
« À nous deux maintenant. » On connaît ce défi lancé par Rastignac à Paris, à la fin du PÈRE GORIOT de Balzac, lorsqu’après avoir, seul avec un ami, enterré le Père Goriot, abandonné de tous et notamment de ses filles, au Père-Lachaise, il décide d’aller dîner le soir même chez Madame de Nucingen, c’est-à-dire de se lancer à tout prix dans une carrière et de satisfaire son ambition. Tant il est vrai que Paris est pour Balzac la Ville par excellence où un homme doit réussir, auprès d’une femme riche et aimée de préférence, quitte à y perdre toutes ses illusions, comme Lucien de Rubempré dans ILLUSIONS PERDUES.
Le défi est lancé depuis les hauteurs de Belleville, d’où on domine Paris, un peu comme Satan emmène le Christ au sommet d’une montagne pour lui faire contempler l’infini des plaines et lui dire : « Tout cela est à toi si tu m’adores ». Car Paris est aussi bien cette capitale que Balzac décrit dans LA FILLE AUX YEUX D’OR comme une nouvelle version de L’ENFER de Dante, qui aurait quatre ou cinq cercles, ce qui justifie en partie le titre de COMÉDIE HUMAINE, pendant bourgeois, terrestre et mondain du grand poème italien : « Quelques obser- vations sur l’âme de Paris peuvent expliquer les causes de sa physionomie cadavéreuse qui n’a que deux âges, ou la jeunesse ou la caducité : jeunesse blafarde et sans couleur, caducité fardée qui veut paraître jeune. En voyant ce peuple exhumé, les étrangers, qui ne sont pas tenus de réfléchir, éprouvent tout d’abord un mouvement de dégoût pour cette capitale, vaste atelier de jouissances, d’où bientôt eux-mêmes ils ne peuvent sortir, et restent à s’y déformer volontiers. Peu de mots suffisent pour justifier physiologiquement la teinte presque infernale des figures parisiennes, car ce n’est pas seulement par plaisanterie que Paris a été nommé un enfer. Tenez ce mot pour vrai. »1
Or le théâtre n’est pas absent de ce Paris-là, dans la mesure où la représentation théâtrale est à Paris, en ce temps-là, le lieu même où, dans une salle dont les loges se font autant face entre elles qu’elles regardent la scène, chacun peut, lorgnon ou jumelles en mains, découvrir ou vérifier les ascensions et les chutes sociales, les faillites financières, les dégradations morales et les allées et venues amoureuses : conquêtes affichées, liaisons devinables, égarements sexuels, tromperies, trahisons, dérélictions. Malgré tout, il est beau de vivre avec une actrice qui remporte les plus grands succès dans ce Paris-là, et de s’afficher avec elle au théâtre, comme Lucien de Rubempré, dût-on partager ses faveurs avec le riche banquier qui l’entretient.
Mais si le théâtre balzacien rassemble sa ville dans ce moment privilégié qu’est une représentation, c’est qu’il est encore, en ce siècle de la bourgeoisie triomphante, l’édifice lumineux où, le soir, l’espace se concentre en lui-même, où le temps s’intensifie et où, y paraître, c’est comme exister deux fois plus que le jour, comme brûler sa vie par les deux bouts.
Paris joua encore sûrement ce rôle à la fin du XIXe siècle, puis avant la Guerre de 1914 – 18 – c’est le temps de Proust – puis un peu dans l’Entre-deux-guerres, mais aujourd’hui, si mondaines que soient certaines des Premières de notre temps, il m’a souvent semblé, depuis 1945, que leurs modernes invités tentaient de singer comme ils pouvaient cette satisfaction de soi qu’avait eue la bourgeoisie de 1830, délivrée des terreurs de la Révolution et des guerres de l’Empire, pour afficher sans pudeur ses jouissances : « Que veulent-ils ? demande Balzac. De l’or, ou du plaisir ? »
Encore faut-il de nos jours recourir à bien des défilés de mode et des lancements de parfums, ou aux Molières et aux Césars télévisés, pour qu’on se croie invité à un événement important. Le reste du temps, le théâtre est devenu plus spartiate, le théâtre Privé songe avec un mépris mêlé d’envie au théâtre Public, qui le lui rend bien, et l’idée de la Culture, ce badigeon morose, vient compromettre sourdement ce qui pourrait être une soirée heureuse. L’Enfer qui fascina Balzac a fait place à nos longs Purgatoires vespéraux. Mais enfin, il y a parfois des miracles…
LA VILLE, de Paul Claudel
On sait moins que LA VILLE de Claudel se déroule en partie là où se termine LE PÈRE GORIOT. Sur les hauteurs de Belleville, là où Lambert et Isidore de Besme se penchent avec désespoir ou nostalgie sur la Ville de lumière, au moment même où elle va sombrer dans les ténèbres d’une Révolution qui évoque à l’évidence la Commune de Paris, avant de se voir régénérer par le retour au culte catholique, apostolique et romain, en la personne du poète Cœuvre, devenu évêque, à qui revient la charge de célébrer cette espèce de cérémonie finale où il exige et obtient des nouveaux législateurs de la Ville leur adhésion sans réticence au Credo. On me pardonnera ce renversement de la donnée de départ, puisque du Théâtre en sa Ville, je suis passé à La Ville en son Théâtre, et même à La Ville comme Théâtre.2
La Ville maudite et parjure va-t-elle pour autant devenir une Ville sainte, une sorte de Jérusalem lutétienne ? On va voir pourtant combien Claudel avait pu la haïr.
Puisqu’il s’agit de LA VILLE comme pièce de théâtre, Claudel lui invente une spatialité inédite ; la Ville occupe toute la scène, mais de façon différenciée.
La première version, donc, très foisonnante, et qui n’est pas sans rappeler certaines scènes des MISÉRABLES de Victor Hugo, celles où se rassemble une jeunesse vivante et tumultueuse, écrite en 1890 ‑1, indiquait : « Acte premier : Un très grand jardin dans le milieu de Paris. » Paris est donc nommé. « Acte II : Boulevards du Sud. Un endroit découvert d’où l’on voit les hauteurs de Belleville. » C’est dans ce quartier que Claudel habita avec sa famille, non loin du Jardin des Plantes. « Acte III : Les quartiers bas, vers l’Île. »