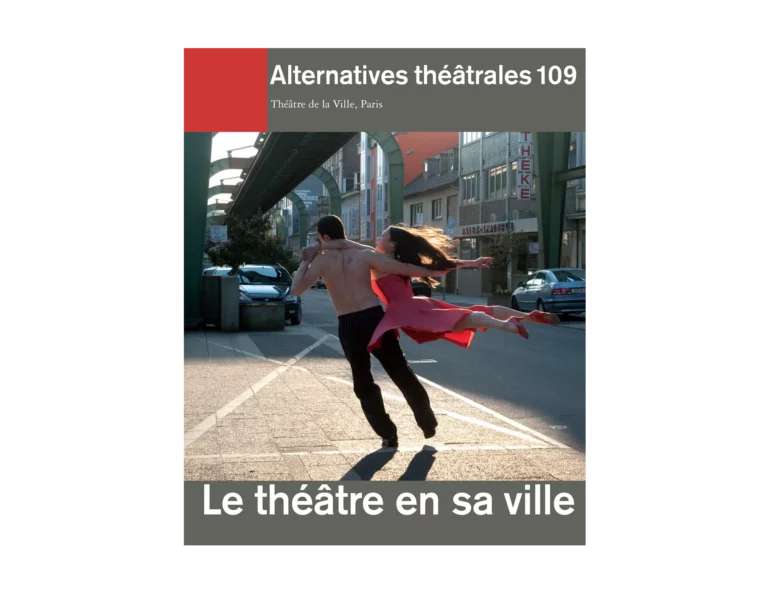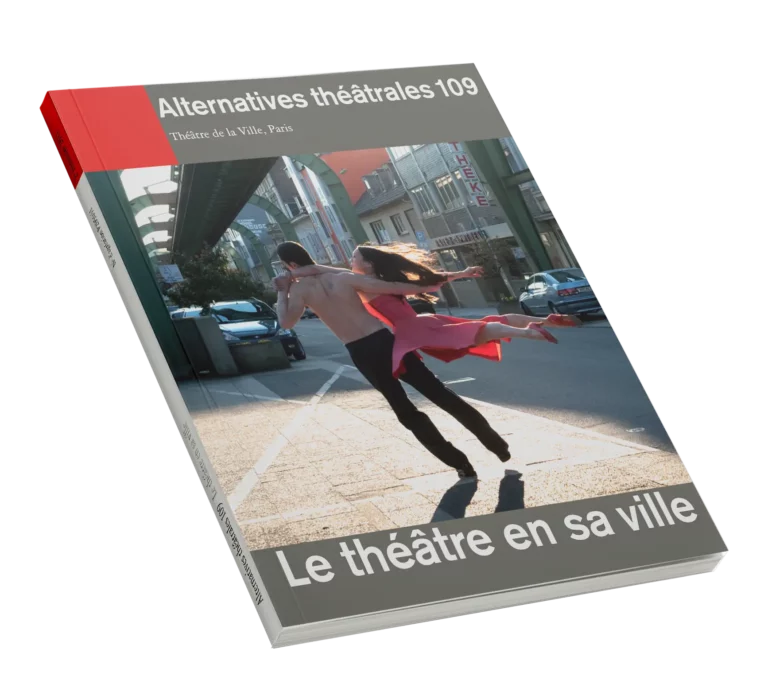Platon voulait chasser les poètes, ces imitateurs créateurs de semblances et non de choses réelles, de sa cité idéale (La République, Livre X). Le philosophe grec visait particulièrement les poètes tragiques, des fabricants de fantômes qu’il opposait à ceux qui créeraient vraiment… Songeant plutôt que les hommes de théâtre sont eux aussi des fabricants de réel, qu’il serait vain de hiérarchiser les catégories d’artisans – tous importants –, et inutile de se répandre en poncifs sur les ponceurs et les penseurs, ce numéro d’Alternativest héâtrales interroge le rôle des théâtres dans nos villes, aujourd’hui.
Conçu en complicité avec Emmanuel Demarcy-Mota, « Le Théâtre en sa ville » explore les liens que la ville tisse avec ses théâtres ; et ceux qu’ils nouent avec leur Cité et leurs cités – banlieues plus ou moins éloignées d’un cœur présumé. Centre et périphérie. Bords et débords… « Le Théâtre en sa Ville » pose la question du lieu et de ce qui s’y joue : du bâtiment et de la programmation : de l’écrin et de son ancrage sur un territoire. Pour Emmanuel Demarcy-Mota, qui a deux patries (la France et le Portugal), un goût pour l’ouverture à toutes les formes d’art, de langues et d’identités, la capitale parisienne excède ses frontières : « Dans Théâtre de la Ville, il y a le mot « ville ». Et je suis assez heureux de me dire que ma ville est un « monde. » (Ma Ville est un « monde »).
Aujourd’hui, de nombreuses villes ont adopté une institution qui porte leur nom, en le faisant parfois retentir autour du monde : « Mais une cité majuscule comme Paris ne saurait se reconnaître dans un seul théâtre, fût-il sa propre exclusivité, une pièce maîtresse de son patrimoine. » Emmanuel Wallon propose une visite guidée de la capitale culturelle, un point de vue sur sa « centralité éclatée », une réflexion sur les scènes de province ou d’Europe qui contribuent à modeler le paysage urbain (Extension du domaine de la scène, Un théâtre sans capitale).
Plusieurs « théâtres-frères » du Théâtre de la Ville, européens, livrent leur vision du théâtre et de son impact. Pour Luca Ronconi, « un théâtre public doit être lié à son territoire. » L’histoire du théâtre en Italie s’est écrite sous le règne du théâtre de tournées, au détriment des lieux permanents (Le Piccolo de Milan : teatro stabile et politiques instables).
Claus Peymann dirige le Berliner Ensemble avec la volonté de ne pas jouer comme dans un théâtre municipal normal. Il veut pouvoir « être présent dans l’espace public, prendre position sans compromis, polémiquer, affronter le monde politique. » (À la recherche d’une tension entre laville et le théâtre). Directeur du São Luiz de Lisbonne, José Luis Ferreira est attaché aux composantes culturelles de sa ville, « première ville multiculturelle du monde occidental, qui intègre la mémoire de ces rapports établis historiquement avec le monde entier, mais aussi les défis de la mondialisation accélérée » (Le São Luiz de Lisbonne : réinventer un patrimoine donné en héritage).
Le Young Vic, dirigé par David Lan, se trouve dans un quartier mixte de Londres, où des maisons très chères côtoient des lotissements sociaux : « Nous voulons que le public dans le théâtre soit le même que celui que nous croisons quotidiennement dans la rue » (Le Young Vic de Londres, un théâtre qui met en danger).
À Bruxelles ou à Buenos Aires, on se soucie aussi des populations. Le directeur du KVS, dont le théâtre est en connexion avec l’actualité politique, se soucie des minorités dans le choix de ses projets artistiques (Le KVS de Bruxelles, un théâtre d’émancipation pour les nouvelles minorités urbaines).
La directrice du San Martín considère elle aussi son théâtre comme un lieu « d’importance vitale pour la culture urbaine… La ville aujourd’hui plus que jamais, doit compter avec lui, véritable refuge qui incite à la liberté et l’imagination de tous ses habitants. » (Le Théâtre San Martín de Buenos Aires).
Pour ces directeurs, comme pour les maires de Paris et de Lisbonne, la culture doit trouver droit de cité dans les théâtres. Pour Bertrand Delanoë « Le Théâtre de la Ville participe pleinement à de nouveaux réseaux, à l’échelle de la Ville et de la Métropole, permettant de sortir de certains antagonismes et de favoriser une dynamique artistique créative » (La culture doit être pour tous un instrument essentiel d’émancipation). Antonio Costa réfléchit au rôle du théâtre comme endroit du croisement des publics et des artistes (Le Teatro São Luiz : un lieu de croisement et de rencontre).
Ces témoignages invitent à penser les théâtres comme des lieux de vie, dont l’image serait révélatrice de nos villes. Marcel Freydefont et Serge Saada ont réfléchi à cette question du reflet de la ville en son théâtre : le premier, sous l’angle de l’architecture et de la scénographie (Une constellation de lieux divers en miroir d’une ville composite); le second, par une analyse des spectateurs (Spectateur pour la première fois).
Loin des « théâtres en capitale », Georges Banu s’intéresse à plusieurs villes, peu ou prou inconnues, jusqu’à l’arrivée d’artistes dont les pratiques exemplaires les ont révélés au monde, telle Pina Bausch à Wupperthal… (« Villes mineures », pratiques exemplaires). C’est enfin à l’histoire et aux exploits d’un théâtre situé à l’est de Cracovie, que Stéphanie Lupo nous convie (Laznia Nowa Teatr / Nowa Huta : « La vie dans le théâtre / Lueurs de l’ombre »).
Il faudrait parler d’autres villes, d’autres théâtres, bien sûr… Cette traversée excédant nos forces, nous avons invité François Régnault à écrire sa poétique de la ville, sur les pas de Balzac ou de Claudel… (À nous deux maintenant).