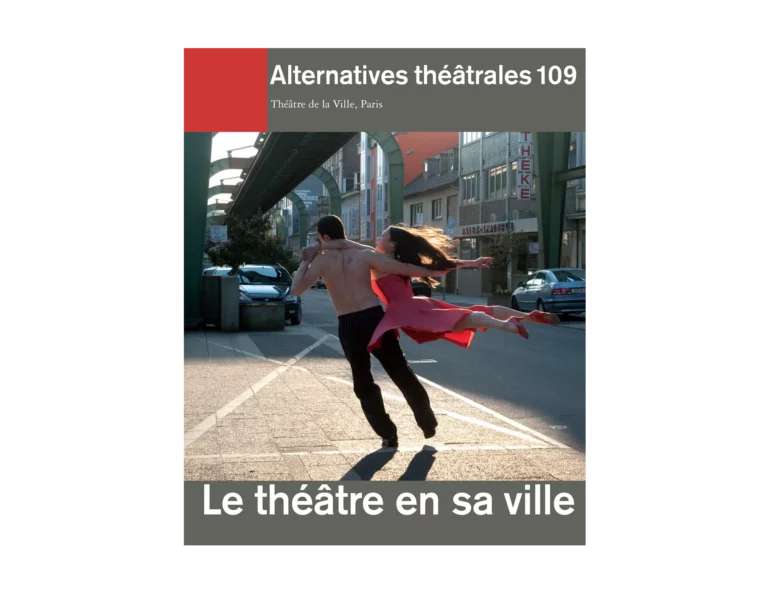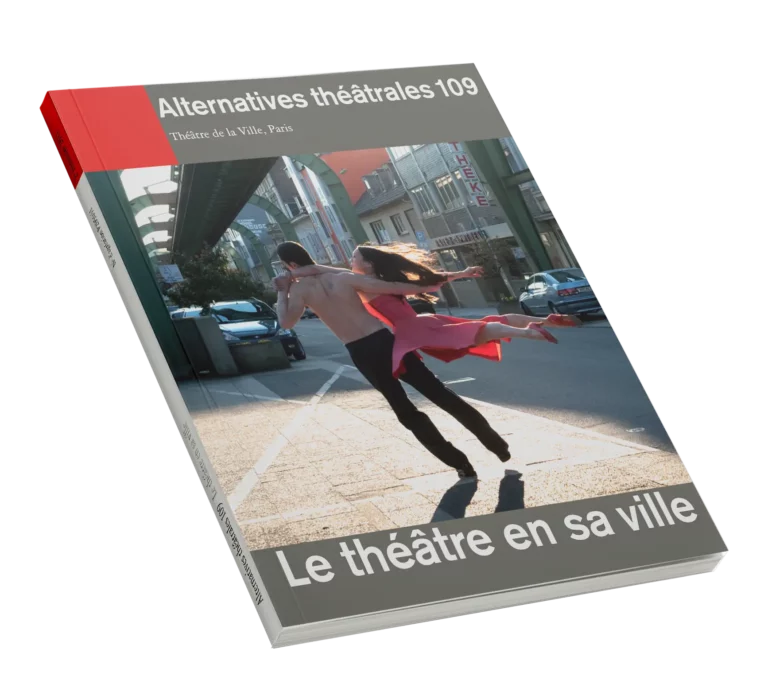BERNARD DEBROUX : Parlons des origines du Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS). Ce rapport à la ville existait-il déjà dans ses missions au début ?
Jan Goossens : Le KVS est un théâtre qui était très lié à l’émancipation culturelle des Flamands de Bruxelles. À l’époque, dans les années 1880, les Flamands étaient majoritaires mais n’étaient presque pas représentés dans la vie politique et culturelle. C’est un théâtre qui, tout comme le NTGent à Gand et le KNS à Anvers était un théâtre de ville, une compagnie de répertoire. Il était lié en même temps à cette volonté ou ce besoin de la communauté flamande de Belgique de développer une vie culturelle propre et plus ou moins institutionnalisée. Bien sûr, il y avait à Bruxelles la spécificité de se retrouver dans une ville où il fallait cohabiter avec les Francophones. C’est ce rôle-là que le KVS a continué de jouer pendant plus d’un siècle, jusqu’au début des années 1990. Il y a eu plusieurs directeurs qui avaient des tendances différentes, de populaires à populistes… Dans les années 1950 – 1960 avec Vik De Ruyter, c’est devenu un théâtre intéressé par l’avant-garde dans la culture flamande. Il a présenté, par exemple, des pièces de Hugo Claus. Mais c’était un lieu organisé de façon plus ou moins traditionnelle avec un directeur artistique-metteur en scène à sa tête, une troupe d’acteurs flamands (tout était joué en néerlandais). Il le fallait, surtout d’un point de vue symbolique. D’un point de vue artistique et culturel, c’était rarement intéressant. C’était une sorte de Théâtre national de la communauté flamande, même s’il y a toujours eu d’autres théâtres, à Anvers et Gand. Dans la Communauté flamande, il y a toujours eu ce désir ou cet espoir d’en faire un théâtre national flamand et une compagnie nationale flamande.
Vers la fin des années quatre-vingt, début des années nonante, il y a eu une crise dans ces trois théâtres et surtout au KVS. Crise artistique, parce qu’à partir des années quatre-vingt, des développements intéressants ont vu le jour dans les arts de la scène flamande. Mais tout se passait en dehors de ces trois institutions, et très souvent directement en réaction à ces institutions. Ces trois théâtres n’avaient plus de liens avec le paysage artistique flamand, ni avec les villes où ils étaient implantés. Le KVS, surtout, restait un théâtre exclusi- vement flamand, avec un répertoire plutôt traditionnel, en langue néerlandaise, et toujours les mêmes comédiens, des Néerlandophones vivant en dehors de Bruxelles. Un projet artistique de ce type, dans une ville où les flamands étaient devenus une vraie minorité, très bien protégée mais une minorité quand même, n’avait plus vraiment de sens. On l’a senti très fortement et très directement pendant la première année qu’on a passée à Molenbeek, en 1999 – 2000, au Botelarij1. Le projet était toujours très flamand et plutôt traditionnel.
B. D. : Il y avait quand même déjà des ouvertures à ce moment-là ?
J. G. : Oui mais structurellement parlant, pas tellement.
B. D. : Je me souviens de la Fura del Baus qu’on avait présenté dans le cadre de Bruxelles 2000 pour lequel je travaillais.
J. G. : C’était des accueils ou des festivals particuliers, ce n’était pas à l’échelle de la production propre, de l’ensemble du répertoire. La qualité avait augmenté depuis que Frans Marijnen était arrivé à la direction, mais la vision et la mission étaient restées plus ou moins les mêmes. Pendant cette première année à Molenbeek, il est devenu très clair que ce KVS était un ovni dans cette commune et à Bruxelles. Le public traditionnel flamand ne venait plus parce que c’était soi-disant beaucoup trop dangereux, et les nouveaux Bruxellois du quartier n’avaient aucune raison de s’identifier avec ce KVS. Il y avait aussi d’énormes problèmes financiers, on ne savait pas quand la rénovation du théâtre serait terminée, il n’y avait plus de public, plus de sous, et bien que l’infrastructure soit intéressante dans ce lieu, elle exigeait une approche complètement différente. C’est après cette première saison que Fanz Marijnen a démissionné. Il fallait donc, soit réinventer la mission de ce théâtre, soit l’abandonner. Cette question a vraiment été posée dans le secteur culturel et même politique.
B. D. : En comparaison, le Kaaitheater avait bénéficié, grâce aux investissements, de développements artistiques importants…
J. G. : Oui. Et les artistes émergents comme Anne-Teresa De Keersmaecker, Wim Vandekeybus, Jan Lauwers, DitoDito, à Bruxelles, ne voulaient surtout pas travailler au KVS ! Alors que le KVS continuait à « manger » la majorité du budget culturel flamand. C’était pénible.

C’est alors que nous nous sommes posé la question, en dialogue avec des Bruxellois mais aussi avec des gens d’en dehors de Bruxelles de comment réinventer avec pertinence la mission de ce théâtre. Il s’agissait bien d’une réinvention, parce qu’on ne rejetait pas complè- tement ce que le KVS avait essayé d’être dans cette ville et dans cette Communauté flamande. Dès le début, on s’est dit qu’on allait réinventer et transformer ce théâtre, en le faisant évoluer d’une compagnie de répertoire flamand plutôt traditionnel, en vrai théâtre urbain qui prendrait comme point de départ la réalité de cette ville. La mission originelle dans le sens de l’émancipation restait aussi au cœur de ce projet. Mais peut-être que le KVS pouvait à présent jouer ce rôle d’émancipation dans ce combat vis-à-vis d’autres minorités et d’autres communautés…
Nous avons l’ambition, en toute modestie, de contribuer à la ville et à la nation de demain. C’est ce qui m’intéresse dans la notion d’un théâtre national, ce n’est certainement pas la restauration ni la préser- vation, mais la construction d’un avenir partagé dans des villes où l’on sait que de plus en plus de gens qui y vivent n’en partagent pas le passé mais pourraient un jour en partager l’avenir. C’est ce qu’on essaie de faire depuis dix ans.