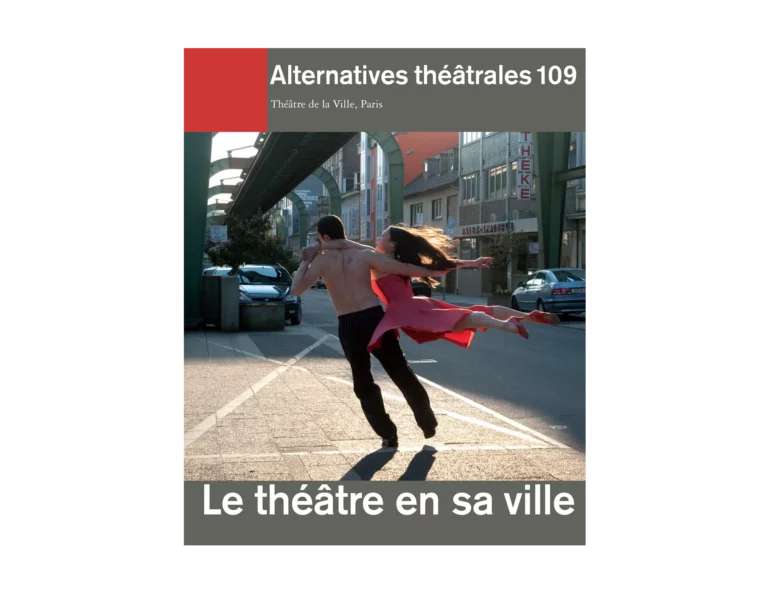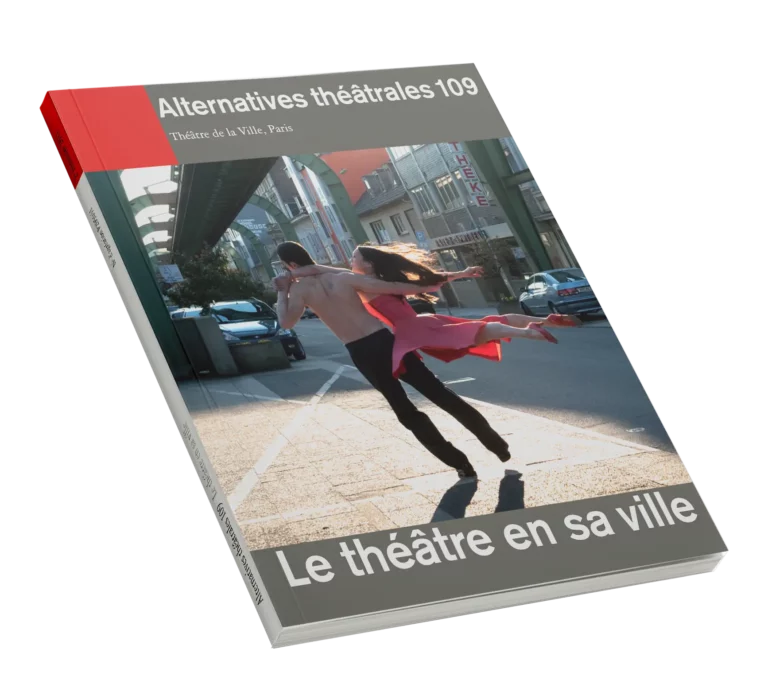INTRODUISONS notre sujet par un paradoxe : le théâtre dit à l’italienne qui constitue au XVIIIe et au XIXe siècle l’expression accomplie de la société occidentale est un lieu divisé : la séparation est nette entre la scène et la salle ; la salle étagée elle-même est un espace de séparation. Cependant, le théâtre paraît une forme rassembleuse et unificatrice. L’édification de ces lieux à partir du début du XVIIIe siècle, leur monumentalisation de 1780 à 1880 font de ces architectures le signe distinctif de l’urbanité, le miroir d’une ville et un marqueur décisif de centralité. Libérée de ses remparts, la ville demeure homogène, même si la poussée des faubourgs, le développement de l’activité industrielle et des transports, altèrent son unité : il y a bien d’un côté la ville et de l’autre la campagne.
Cette démarcation se brouille au XXe siècle en raison de la prolifération urbaine qui semble dissoudre l’idée de ville jusqu’à l’informe. La dimension composite des conurbations contemporaines qui s’étalent à infini est une évidence. À cette constellation urbaine hétéroclite dont on ne sait pas toujours identifier le visage ne répond plus un seul lieu de représentation et de rassemblement, un seul modèle, une seule architecture, mais une constellation de lieux scéniques, souvent de conceptions différentes. Ce qui semble les rapprocher tous, c’est leur volonté d’engendrer un lieu unifié, un lieu unique, estompant la coupure entre scène et salle, effaçant tout marquage dans la salle au profit d’une vision égalitaire. Ce lieu est unique au sens où il propose une sphère participative plutôt qu’un cube optique, une scène ouverte, par opposition à une scène encadrée, un espace malléable et non un espace fixe. Dans le même temps, le théâtre est devenu un art minoritaire. Vaste sujet… À Paris, la transformation récente de la Gaîté-Lyrique, sorte de pendant à distance du Théâtre de la Ville, prend acte de l’oscillation actuelle entre théâtre et arts numériques. De plus, ces deux exemples sont des restructurations de grands théâtres du XIXe siècle qui ont façonné l’image de Paris. Mutations générales. À l’ouest de la France, la constellation nantaise offre une carte parfaite de la diversité des lieux scéniques aujourd’hui dans une ville recomposée. De Paris à Nantes, en passant par Berlin, Bruxelles ou Barcelone, nous allons faire l’inventaire de ces lieux scéniques multiples qui tissent le portrait métissé de la ville d’aujourd’hui.
La remise en cause de la fonction du théâtre dans la cité : la quête d’un espace juste

Dès 1961, Denis Bablet a mis l’accent sur « la remise en cause de la fonction du théâtre dans la cité, de ses moyens d’expression scénique et de la dramaturgie » dans le fil d’une remise en cause des arts, des cadres perceptifs et esthétiques, modifiés radicalement par les transformations scientifiques, techniques, politiques, économiques, sociales qu’a connues le monde occidental au XIXe siècle et au XXe siècle. De même que, depuis l’impressionnisme, les artistes ont défaitl’espace cubique perspectif élaboré à la Renaissance à partir d’un point de vue fixe, de même les scénographes ont multiplié les points de vue, éclaté et modelé l’espace scénique, au nom d’un réalisme nouveau. Comme le note Luc Boucris, tout le travail de la scénographie au XXe siècle est d’avoir cherché à « assouplir l’espace, le rendre malléable, flexible et mobile, voire fluide ».
La recherche d’un espace adapté implique d’une part l’architecture théâtrale au nom de « l’indispensable accord entre l’œuvre et le lieu de représentation » pour reprendre les termes de Charles Garnier en 1871 qui voit dans l’architecture l’accomplissement du drame, et, d’autre part, ce qu’il était convenu d’appeler au XIXe siècle le décor,« complément indispensable de l’œuvre » (André Antoine, 1921). En 1948, le philosophe Raymond Bayer s’est interrogé sur la morphologie de l’encadrement du drame, avec le souci d’épouser l’émotion tragique. Il concluait à la nécessité d’une adaptabilité du cadre afin de s’ajuster à l’œuvre concernée : « Dilatation ou, au contraire, resserrement ; rétrécissement avec quelque chose d’également mobile dans le cadre, pour la mobilité même du genre tragique ». Les différentes recherches effectuées depuis 1890 témoignent de cette quête pour un espace juste, dans la variété de leur dénomination : espace libre, vaste et transformable (Appia, 1890), mille scènes en une, espace vide(Craig, 1905 – 1922), théâtre sphérique (Weininger, 1922), théâtre total (Gropius, 1927), lieu unique sans barrière(Artaud, 1932), théâtre simultané (Syrkus, 1937), théâtre mobile (Poliéri, 1958), théâtre adaptable ou transformable(Izenour, 1960), théâtre polyvalent (Allio, 1961), théâtre à scènes multiples et à contrepoint (Agam et Parent, 1962), lieu juste (Brook, 1976), vide inspirant (Mnouchkine, 1989), lieu pris dans la vie (Kantor, 1989), espaces perdus (Régy, 1998), etc. Elles conduisent à identifier trois principaux concepts d’espace : Espace vide – Espace total – Espace brut, avant d’en repérer la traduction urbaine et architecturale.
La liberté de l’espace vide
Peter Brook en fait le titre d’un ouvrage célèbre où il souhaite libérer la source de vie théâtrale du carcan architectural : « Je peux prendre n’importe quel espace vide et l’appeler une scène. Quelqu’un traverse cet espace vide pendant que quelqu’un d’autre l’observe, et c’est suffisant pour que l’acte théâtral soit amorcé ». Vacuité, liberté, nudité, disponibilité, potentialité, réversibilité, virginité, indéfinition, minimalisme, caractérisent cette conception. L’espace vide est un espace effacé et effaçable : une sorte de page blanche, d’espace zéro, où tout peut advenir sans obligation préalable, où rien n’est pré- formaté, où l’on peut « tout créer » (Chéreau, 1989). Ce vide doit être « inspirant » (Mnouchkine, 1989) sans être envahissant, neutre sans être stérile (Brook, 1976) et la technique doit y être discrète, « réduite au minimum » (Chéreau, 1989). L’un des premiers, Craig a bien saisi la valeur de l’espace vide : « Une nécessité m’apparut : le théâtre doit être un espace vide avec seulement un toit, un sol, des murs ; à l’intérieur de cet espace, il faut dresser pour chaque nouveau type de pièce une nouvelle sorte de scène et d’auditorium. Nous découvrirons de nouveaux théâtres, car chaque type de drame réclame un type spécial de lieu scénique » (1922).
L’efficacité de l’espace total
En concevant en 1927 le projet d’un Total Theater pour répondre aux aspirations de mise en scène de Piscator, Gropius fait de cette architecture un instrument : « Mon Théâtre synthétique (…) permet à chaque metteur en scène, grâce à des dispositifs appropriés, de jouer à l’intérieur d’une même représentation sur la scène à l’italienne ou sur le proscénium ou encore sur l’arène circulaire, voir simultanément sur ces trois scènes. (…). Le but de ce théâtre n’est donc pas d’accumuler matériellement des dispositifs et des trucs techniques raffinés, mais des moyens en vue d’obtenir que le spectateur soit entraîné au centre de l’action scénique, qu’il ne fasse plus qu’un avec l’espace où l’action se déroule. (…) Au reste, l’architecture d’un théâtre a pour mission de rendre l’instrument théâtral aussi impersonnel, aussi souple et transformable que possible. (…) C’est une grande machine spatiale ». Cette conception se donne les mêmes objectifs que l’espace vide : souplesse, flexibilité, liberté. Mais, ici, la référence à une machine spatiale est centrale et la technique toute puissante : c’est le règne de la fonctionnalité efficace. Cette idée implique la neutralité de l’espace de base. La malléabilité est assurée par un ensemble de dispositifs appropriés. « Total » signifie le cumul dans un même espace de tous les rapports scène-salle connus par le théâtre dans son histoire, tout en permettant d’inventer de nouveaux rapports spatiaux. « Total » signifie aussi la synthèse des arts par le truchement de tous les moyens techniques : plateaux mobiles, lumière, son, image projetée.
La poésie de l’espace brut
C’est Kantor qui définit le mieux cette aspiration qui se défie des théâtres institués et privilégie les théâtres improvisés : « Le meilleur endroit pour mon théâtre, c’était une blanchisserie en Pologne… et une gare, avec de vieux trains. Nous avons joué aussi sur un glacier en Yougoslavie, et dans les salons du Palais de Tito (…), puis dans un casino, et même sur une plage. (…). Je cherche des lieux qui ne soient pas destinés au théâtre. Le théâtre est le dernier endroit où l’on peut jouer un spectacle ! Alors, il nous faut trouver un lieu qui soit lié à la vie. » Pauvreté, hasard, fortune, opportunité, tels sont les qualificatifs qui s’attachent à cette démarche : le lieu est récupéré, recyclé, détourné, investi. Il est déjà là. À certains égards, cette démarche relève de Marcel Duchamp avec le ready made. L’espace brut renvoie lui aussi à l’objectif de la disponibilité, d’une liberté offerte. Mais cette disponibilité n’est pas sans contrainte. Et l’espace brut est aux antipodes de la neutralité : il a une personnalité. Dans cette conception, l’homme de théâtre devient un Bernard l’Ermite qui vient occuper des coquilles désertées. Ici, le lieu trouvé – l’espace perdu dont parle Claude Régy – peut offrir l’indéfinition d’un espace désaffecté tout en racontant lui-même une histoire. Cette quête d’un « vrai lieu » (Chéreau), hanté par ce qui l’a habité, constitue un des pôles d’oscillation spatiale du théâtre entre abri et édifice. Antoine Vitez a défini ces oscillations que connaît le théâtre dans sa stratégie d’occupation de l’espace : le théâtre « peut être encaserné (…), ou campé, à l’improviste, dans une grange, une cartoucherie (…) sans oublier les lieux proprement fonctionnels, parfaits outils techniques, confinant à l’univers usinier»(1978), mettant en évidence la tentation du lieu banal et investi, en raison de l’espace disponible qu’il offre, mais aussi de la mémoire qu’il recèle et de l’imaginaire qu’il permet de développer. Ces concepts se sont traduits au cours du XXe siècle par les modèles suivants qui parsèment les villes contem- poraines à Paris comme à Nantes pour en composer le visage multiple, parfois de façon inattendue.
Le théâtre historique ou théâtre dit à l’italienne et son devenir