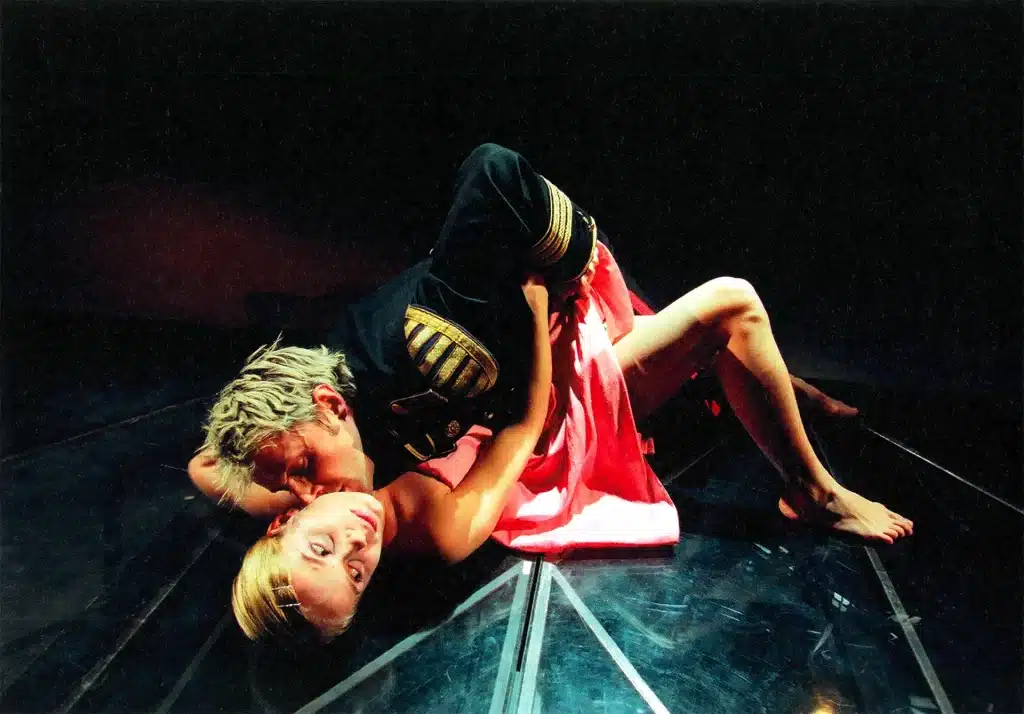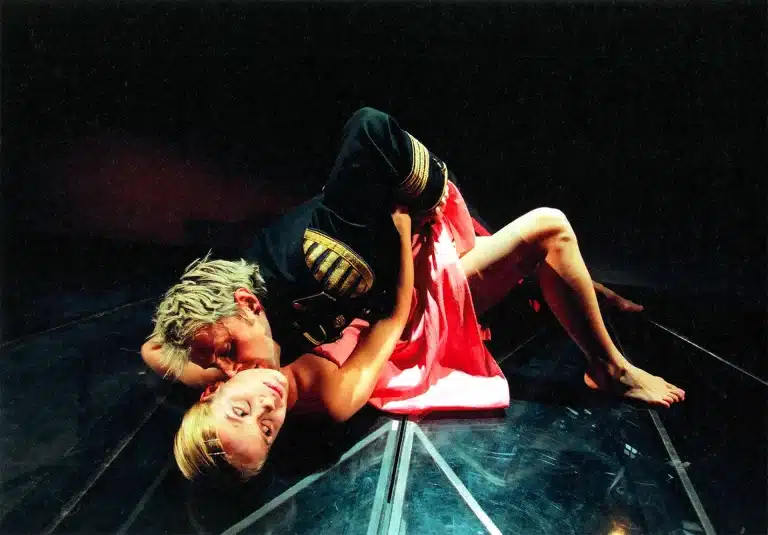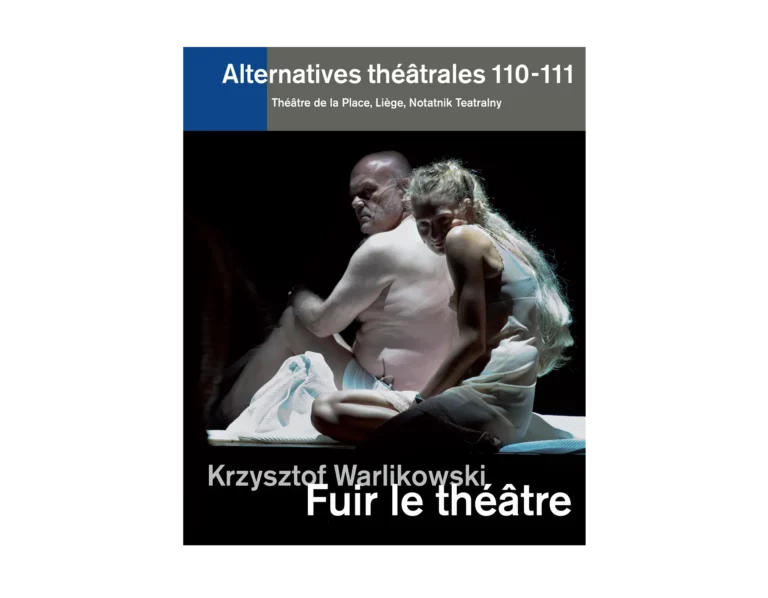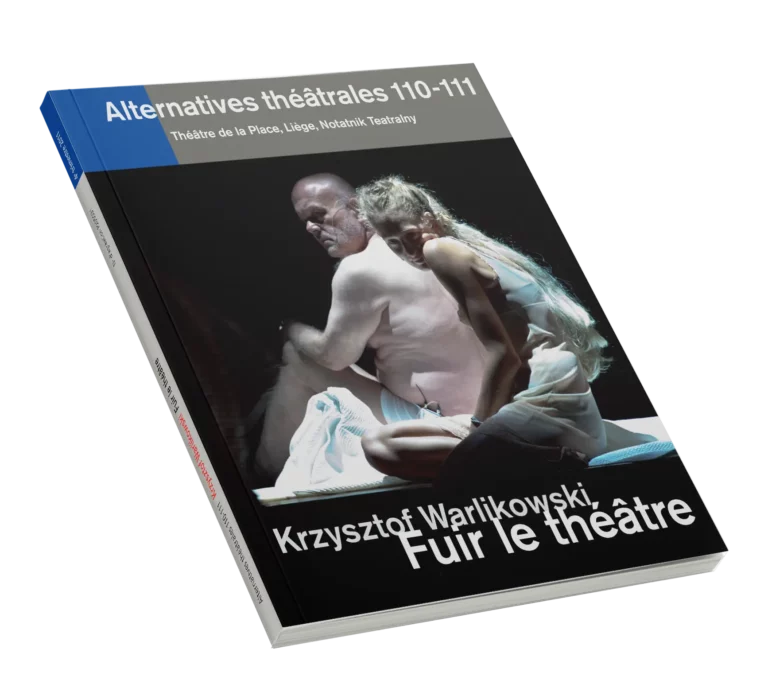Bernard Debroux : Le grand écrivain argentin Ernesto Sabato, qui est mort il y a quelques jours, disait que toute œuvre est une autobiographie, qu’un arbre de Van Gogh est le portrait de son âme. Partages-tu cette conception de l’œuvre d’art ?
Krzysztof Warlikowski : La question de l’autobiographie est une question de temps. Au début on ne se rend pas compte à quel point ce que l’on fait est autobiographique. Avec le temps, cette réflexion vient obligatoirement.
On ne peut pas y échapper. Je crois qu’il y a une première période de maturation d’un artiste où il est plutôt en lutte contre la société. C’est la première rencontre artistique et humaine. Il ne se rend pas encore compte qu’il s’agit de lui-même, qu’il va de plus en plus vers lui-même. Les premières obsessions d’un artiste sont proches de lui, sans qu’il sache encore où ilveut en venir. Ensuite vient l’âge de révolte de chaque artiste envers la société, son engagement dans les problématiques du réel. Puis la révolte passe et il passe à un autre niveau, où la réflexion commence à être difficile. Quand la réflexion se met en place, le théâtre se fait plus difficilement.
Georges Banu : C’est la grande réflexion inspirée par Kantor. Il est devenu autobiographique en soixante ans. Il a tout d’un coup accédé à l’autobiographie après être passé par la lutte contre les dogmes de l’esthétique officielle. On n’est, en effet, pas autobiographique au début.
Krzysztof Warlikowski : Ça revient de plus en plus, parce que la réflexion générale est de plus en plus forte. Indépendamment du contexte, puisque moi, j’ai été très imprégné par le contexte polonais. Tout œuvre provenait de là. Avec le temps, cette source d’inspiration se tarit. Il y a vingt ans, les changements du monde extérieur étaient tellement forts qu’on devait s’y confronter. Aujourd’hui ça s’endort. Il n’y a que l’artiste qui reste éveillé.
Et la réflexion se généralise aussi. C’est pour cela que je vais vers des auteurs comme Coetzee, qui me nourrissent. Ce n’est plus la réalité polonaise qui m’inspire.
Georges Banu : Ton changement récent par rapport aux textes, ton intervention plus radicale, est-ce que ça correspond à un dépassement du stade de metteur en scène d’un texte pour transformer le matériau textuel en un matériau de réflexion personnelle ?
Krzysztof Warlikowski : Cela correspond aussi à mon expérience humaine. Quand j’ai commencé à faire de l’art, la question de trouver un équilibre entre l’art et la vie s’est posée. Et la vie finit par t’abîmer.…..
Bernard Debroux : Il y a peu ou pas de metteurs en scène de ta génération qui ait autant travaillé Shakespeare. Au début, tu faisais presque un Shakespeare par an. Or tu viens de dire qu’au départ l’artiste est en révolte contre la société. D’où vient donc cette envie ou ce besoin de monter du Shakespeare ?
Krzysztof Warlikowski : C’était facile à l’époque de travailler Shakespeare ; le théâtre national pouvait le présenter. Dans la cave où j’étais à Varsovie, une toute petite pièce, où j’ai monté
Hamlet, ce n’était pas un Hamlet qui aurait pu être présenté au National, parce que les acteurs parlaient mal, ils n’avaient pas le look qu’on pouvait attendre d’une reine ou de Hamlet. La vie en Pologne n’avait rien à voir avec la vie culturelle et le langage culturel. J’aimais travailler Shakespeare, un auteur monté au théâtre national, avec une distribution qui contestait complètement ce théâtre. Il fallait ramener la langue de Shakespeare à la rue ! Pour qu’il n’y ait plus cette dichotomie entre la vie et le théâtre, parce que le théâtre a depuis longtemps oublié la vie. Il y a des mendiants dans la rue qui te médisent et t’insultent parce que tu ne réagis pas, et à côté de cela des grands acteurs avec leur polonais impeccable qui ignorent cette réalité. J’ai pu compter sur Shakespeare comme maître. Je me disais que puisque mon partenaire était bon, je pouvais aller loin ! J’ai eu des expériences au début où je prenais un auteur et, arrivé au milieu des répétitions, je me rendais compte qu’il n’y avait rien derrière. Mais c’était trop tard bien souvent, et je devais y aller quand même. Que je sauve en quelque sorte l’œuvre en y trouvant une profondeur qui n’y est pas. Avec Shakespeare c’est le contraire. On a déjà exploité toute sa profondeur. Par la suite j’ai ressenti une certaine familiarité avec lui. J’ai des théories sur sa vie, comment il était, d’où son art lui venait. Je savais mieux traduire les conventions de son époque que celles de la nôtre. J’ai essayé de dire des choses fortes en supprimant les conventions qu’il était obligé de respecter. Je suis resté quand même loin des grands titres, pendant longtemps : La Mégère apprivoisée, ou Le Marchand de Venise. C’étaient des textes moins connus. J’ai monté Hamlet, bien sûr, et Le Songe d’une nuit d’été, mais je préférais les titres moins connus.
Georges Banu : Dans ton nouveau projet, Les Contes africains, trois textes sont réunis : Othello, Le Marchand de Venise et Le Roi Lear. Ils parlent tous trois de marginalité.
Krzysztof Warlikowski : Il s’agit surtout de trois personnages, Othello, Shylock et Lear, joué par un seul comédien et d’un homme qui traverse une crise, qui reflète en fait ma crise de la cinquantaine. Mais je traite ces personnages avec une grande liberté. Othello et Le Marchand de Venise sont les pièces les plus politiques jamais écrites, avec La Mégère apprivoisée, qui est très féministe et très engagée aussi. On ne sait toujours pas aujourd’hui siLe Marchand est une pièce antisémite ou pas.
J’essaie d’y mettre ce que moi j’y retrouve : l’ambivalence du personnage juif, du personnage noir et du vieux, surtout. Parce qu’on n’en veut plus aujourd’hui, des vieux. Cette société n’en veut pas. J’ai vécu cela en Israël, alors que j’étais jeune metteur en scène, je suis allé enseigner à l’école de théâtre là-bas. J’étais même plus jeune que mes étudiants ou en tout cas j’avais l’air plus jeune. Bizarrement, là-bas, alors que les liens familiaux sont très forts, les vieux sont complètement mis à part. Le vendredi, par exemple, tu vois la place principale de Tel-Aviv emplie de tous ceux qui ont survécu à l’Holocauste et les jeunes qui ont une vie complètement différente.
Georges Banu : Comment travailles-tu sur les textes ? Tu as demandé à Wajdi Mouawad d’intervenir. Comment s’est composée la structure de la pièce ?
Krzysztof Warlikowski : La structure est toujours en cours. J’ai pensé au départ à la marginalité, à cette exclusion de la part de la société, puis ça s’est amplifié en un discours plus général et plus humain. Sans vouloir faire un manifeste du racisme ou de l’antisémitisme. Wajdi a écrit les textes des trois femmes : Cornelia pour Lear, Desdémone pour Othello et Portia pour Shylock, qui est un peu en même temps la figure de Jessica. Dans la première partie, je voulais montrer les hommes qui sont enfermés dans un rôle que la société leur impose : être roi, chef, mari, homme, héros, etc. Dans la deuxième partie, j’explore les facettes de l’homme chez Shakespeare : l’esclave de son rôle social, avec beaucoup de discours de femmes. Dans le livre de Coetzee, L’été de la vie, il se présente en mort. Un biographe anglais écrit un livre sur lui mais sous forme de comptes-rendus de femmes qui ont été ses maîtresses et d’un homme qui a été son amant.
Son biographe se déplace au Brésil, en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, en France, il suit toutes ses femmes, qui ignoraient qu’il s’agissait d’un écrivain qui, de plus, avait eu le prix Nobel. Elles racontent des choses du temps où il était jeune, soit quarante ans auparavant, sur l’impossibilité de l’amour, comment il était esclave de lui-même, qu’il ne comprenait rien au sexe, de ses fantasmes, notamment sur la musique de Bach… Ce qui m’a intéressé c’est justement cette folie d’Othello, de Shylock et de Lear qui tombent dans leurs propres pièges. Et ça se termine avec Cornelia et Lear aujourd’hui. Lear est passé par un moment de folie mais il n’est pas fou. Ilse retrouve à l’hôpital où il est en train de mourir d’un cancer de la gorge et ne peut plus parler. À la première scène, le monologue écrit par Waijdi, la femme demande à être aimée. C’est dans cette prison qui représente la société pour les hommes. Le discours des femmes montre la folie, la perdition, la victimisation des hommes par eux-mêmes…
Bernard Debroux : Dans le livre d’entretiens que tu as fait avec Piotr et auquel Georges a collaboré, tu évoques plusieurs fois la convention du théâtre, puisque le théâtre est un art de la convention. Tu dis que Shakespeare parle dans ses pièces de choses qui n’ont finalement pas beaucoup changé au cours des siècles. Il utilise des masques alors que toi, au contraire, tu voudrais faire tomber ces masques et retourner le fer dans la plaie.
Krzysztof Warlikowski : On ne peut bien sûr pas reprocher à Shakespeare d’écrire de cette manière. Si on voit un texte de théâtre d’aujourd’hui, avec la didascalie qui dit quelque chose du genre « la cuisine donne sur…», on n’a même pas envie de le lire. À l’autre extrémité, dans les textes de Sarah Kane, par exemple, il y a des didascalies qui disent « les rats mangent les membres des personnages mutilés ». Entre les deux, je préfère bien sûr mettre en scène les didascalies de Sarah Kane. On voit dans Shakespeare certains goûts de l’époque, certaines conventions auxquelles on ne peut échapper. J’ai cru, en éliminant ou en réduisant ces conventions, pouvoir approcher l’essence du problème. Par exemple, dans La Mégère apprivoisée, ily a trois tailleurs qui, sur une commande de Petruchio, préparent un costume humiliant pour Catherine. Petruchio veut qu’ils fassent un vêtement le plus moche possible. J’ai trouvé cette scène vraiment cruelle, et pas drôle du tout. Moi, j’ai choisi trois travestis, qui doivent apprendre à Catherine à être une femme.
Du coup, ça devient plus politique puisque les travestis sont des hommes qui savent comment doit être habillée une vraie femme. C’était plus pervers et moins banal, je trouve, de changer ce point de vue. Dans le choix des personnages, il n’y a que des marginaux. Le black, par exemple, dans toutes les mises en scènes que j’ai vues d’Othello, provoque toujours la discussion : faut-il défendre Shylock et comment, ou bien faut-il aller au bout de la haine, montrer qu’il veut vraiment tuer, la vengeance.
Georges Banu : Sellars l’avait transformé, c’était un black qui jouait le Juif.