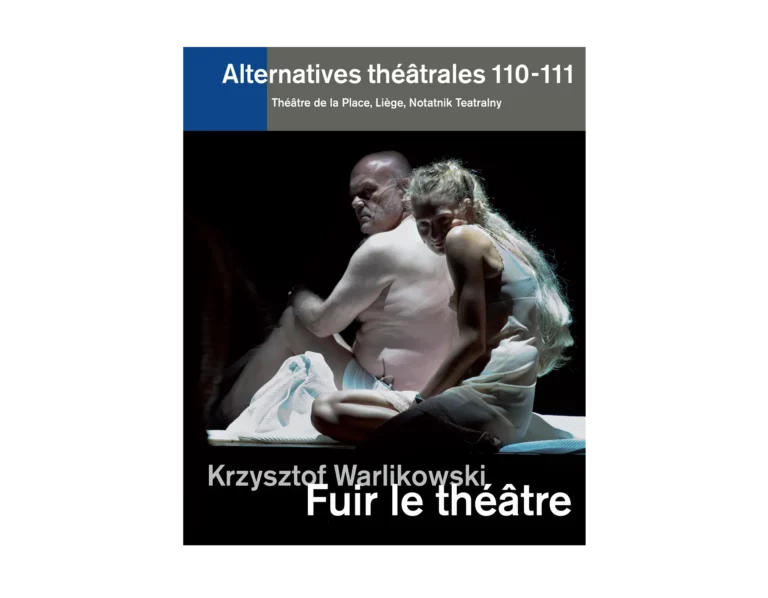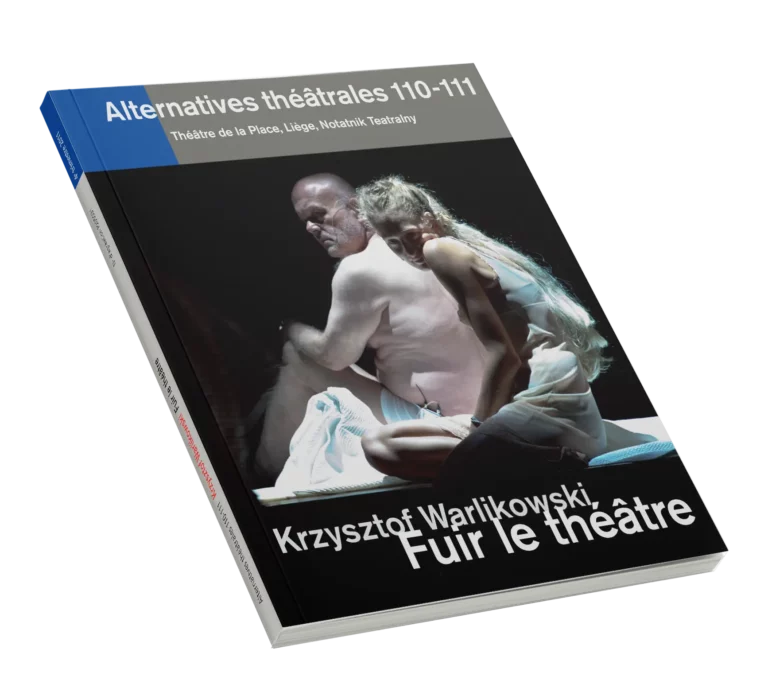Au XIXe siècle on croyait encore que l’Histoire résultait des actions des rois, des généraux et des hommes d’État, expliquées et interprétées par les historiens et les artistes. Rien d’étonnant donc, comme l’affirme Frank Ankersmit1, que la conception de l’Histoire comme conséquence de l’influence de diverses forces sociales ou historiques — et non comme le résultat des actions individuelles de dirigeants ou de politiciens quelconques — a conduit à réserver la notion de passé au passé collectif. Le paradigme romantique aidait cette collectivité à construire son identité, à lutter pour la liberté de l’individu et de la nation et à obtenir l’indépendance jusqu’au moment où, à la fin du XXe et au début du XXI : siècle, il en est devenu la première victime. « Nous sommes témoins d’un cruel paradoxe, écrivait alors Maria Janion. L’indépendance pour laquelle le romantisme a contribué de manière notoire, en donnant à l’art le droit de juger de la condition sociale, d’envisager prophétiquement son avenir et de prendre le rôle de guide sur le chemin de la transgression, détruit maintenant la base de son action. »2
Jusqu’en 1989, l’art en Pologne s’occupait de répondre à la question existentielle et collective la plus importante : « Comment obtenir la liberté ? » L’acquisition de l’indépendance a amené la nécessité de répondre à « Comment obtenir la modernité ? ». Et la voie vers la modernité est passée par l’éclatement de ce but unique qui avait prévalu jusque-là, par la polarisation des idées et le pluralisme des motivations, par l’instabilité axiologique. Ce fut l’hégémonie du paradigme de masse au lieu du paradigme individuel romantique. La liberté a, ainsi, mené à un changement de valeur dans la vie sociale, attaquée par le monde occidental de la frustration et de la consommation. Dans le théâtre polonais, dont l’excellence était marquée par les noms d’Andrzej Wajda, Jerzy Grzegorzewski, Jerzy Jarocki ou Krystian Lupa, sont apparus des jeunes doués qui ont tiré la conclusion de ces changements. Ils ont estimé que, dans ce contexte de grands bouleversements politiques et sociaux, de modifications profondes dans le mode de vie traditionnel, le théâtre devait chercher de nouveaux moyens de parler du monde. Ils ont donc déclaré que le héros de leur théâtre serait l’homme actuel, empêtré essentiellement en lui-même, dans cette réalité confuse et dans sa douleur existentielle.
Dans un monde où tout est permis, où l’art a cessé d’être la soupape de liberté, le théâtre est devenu la projection des réflexions d’artistes libres de puiser dans n’importe quel texte, de le déconstruire de toutes les manières possibles, de lui donner de nouveaux sens. Ils pouvaient contester les conventions théâtrales et en détruire les canons, introduire de nouvelles techniques esthétiques et adopter les stratégies de la culture pop. En annonçant dans cette Pologne indépendante, la fin du paradigme romantique, Maria Janion offrait en même temps aux cultures alternatives la chance de pouvoir revenir à la conception romantique du monde et, en dépassant ses stéréotypes, de reprendre sa philosophie de l’existence, d’assumer le risque d’exprimer des idées controversées et de définir de nouveaux canons. Ce qui constitue l’acte fondamental du romantisme. Le point de vue de Maria Janion semble être en accord avec celui d’Ankersmit qui annonçait une « privatisation du passé » postmoderne contemporaine. Ankersmit, suivant en cela les traces de Maurice Halbwachs3 qui, dans son ouvrage Les Cadres sociaux de la mémoire, affirme que ce qui est le plus individuel et le plus privé reflète l’ordre social et prouve que la mémoire en tant que clef de la conscience historique postmoderne est liée de manière indissociable à l’histoire des mentalités. Elle représente tout ce qui a été rejeté, oublié ou étouffé dans le passé de l’individu. À la charnière du vingtième et du vingt- et-unième siècle, le théâtre qui décrit le monde par le paradigme du quotidien et du privé, a cessé d’être une tribune politique et a renoncé à la catégorie du « nous » tout en révélant le « moi » subversif du héros romantique ; héros immature, inadapté, en conflit intérieur, à la sensibilité exacerbée et en rupture avec le monde.
Dans l’art polonais, et surtout dans le cinéma depuis Les Amants de Marona d’Izabela Cywiñska, en passant par Katy d’Andrzej Wajda, jusqu’à La petite Moscou de Waldemar Krzystek et Le Jeudi noir d’Antoni Krauze, nous pouvons observer la création d’une histoire contemporaine alternative:une histoire existentielle qui s’intéresse au rapport personnel que l’individu entretient avec le passé et la place qu’il s’y donne, mais qui s’occupe aussi de son genre et de sa sexualité, de son déchirement entre la vie et la mort. Elle fait ainsi ressurgir l’espace des désirs et des peurs et compose l’image postmoderne du romantisme. Dans le théâtre contemporain, bien que l’on ne manque pas de mises en scène d’œuvres romantiques, le seul romantique postmoderne semble être Warlikowski. En mixant les sphères privées et publiques, il insère les problèmes dans la corporalité qui définit les limites de l’intimité humaine. Il polémique avec l’ethos de la victime à travers l’histoire, le sacré et le profane, la religion par un messianisme qui n’est pas national mais existentiel.
Lors de la répression policière arbitraire et sans limites de l’époque communiste, lorsque toute activité publique était un compromis, l’intégrité des artistes de théâtre n’était possible que grâce à la métaphysique romantique. Aujourd’hui, dans la Pologne indépendante, Warlikowski parle du monde de manière métaphysique et se défend devant l’asservissement qu’apportent les possibilités de choix illimitées. Il crée un théâtre qui réveille les âmes du passé et ravive la mémoire nationale. C’était ainsi dans Le Dibbouk, où il a confronté l’histoire du dibbouk entré dans le corps de la fiancée racontée par An-ski et l’histoire de Adam S, un américain visité par l’esprit de son frère, trahi et envoyé à la mort dans le ghetto de Varsovie. C’était ainsi dans La Tempête, dans laquelle ce ne sont pas des actrices mais de simples femmes en costumes populaires de la région de Eowicz qui ont célébré à la place des déesses, le rituel du mariage entre Ferdinand et Miranda et les ont bénis en apportant sur la scène les traditionnels sel, pain et vodka.
Se référer à la tradition permet à Warlikowski de construire un théâtre dans lequel l’identité du personnage scénique est inscrite dans une perspective éthique universelle propre au discours romantique. Il a imposé aux héros de Angels in America de Tony Kushner trois comportements caractéristiques des romantiques : héroïque (Prior luttant pour la vie des malades du SIDA), opportuniste (Louis, terrifié et perdu qui abandonne son amant) et rituel (l’Ange qui provoque letourment moral des héros). Les héros du spectacle représentent les modèles de comportement romantique : la vengeance (le juge intransigeant, Roy M. Cohn, qui a envoyé Ethel Rosenberg à la chaise électrique), la compassion (Belize, l’infirmier qui soigne les malades atteints du SIDA) et le pardon (Ethel Rosenberg, Prior). De tous les Anges issus d’Europe, d’Afrique, d’Océanie, d’Asie, d’Australie et de l’Antarctique présents dans le drame de Kushner et impliqués dans divers processus narratifs — qui représentent plus des attitudes sociales déterminées que des manifestations de la transcendance — il n’en est resté qu’un seul : l’Ange chrétien, douloureux, déchu. Le metteur en scène a, ainsi, composé le monde de la scène dans une conception romantique de la réalité et de la religiosité. Prior accuse l’Ange et en même temps tremble devant lui, mais c’est justement en l’affrontant qu’il retrouvera son identité et c’est lui qui « s’arrêtera sur la route et l’attendra ». À la fin du spectacle tombent des paroles qui constituent l’annonce romantique d’un projet d’avenir:«Les morts ne seront pas oubliés, ils continueront à lutter avec les vivants. Nous ne disparaîtrons pas. Nous ne mourrons plus en cachette. Le monde avance. Nous en serons des citoyens. Ilest grand temps. Le grand travail commence. » Dans le monde mélodramatique de la scène, on parle avec beaucoup de sérieux de la foi, de l’espoir, de l’amour, de la grâce, de la vérité, du pardon. Chaque grand romantique se noie dans les larmes et cela ne traduit pas obligatoirement du sentimentalisme : Angels in America ne manque pas non plus de sanglots.
Peu de gens prônent aujourd’hui l’idée d’universalisme, conscients qu’ils sont de ses pièges et de ses dangers. Certains sont des opposants déclarés à cette idée d’universalisme. Ils ne veulent pas s’occuper de ce qui est répandu et n’accordent leur attention qu’à ce qui est unique et particulier. Le théâtre social, comme, par exemple, celui de René Pollesch, ne suit aucune ligne narrative, ni logique ni psychologique, et se base sur une transformation de textes et d’essais sociologiques et anthropologiques, sur des fragments de débats politiques, sur des dialogues issus de feuilletons télévisés que les acteurs clament sur scène en criant plus fort les uns que les autres dans des monologues infinis. Ce théâtre se réfère au paradigme de gauche des années de l’entre-deux-guerres alors que celui de Warlikowski, centré sur les transformations de l’âme, les dilemmes existentiels et identitaires, semble lié aux expériences romantiques et modernes. Les spectacles des jeunes metteurs en scène d’aujourd’hui ne se préoccupent pas de spiritualité brisée, de nostalgie d’une identité humaine stable, bien qu’impossible, mais de la condition humaine dans une société à la communication médiatique schizophrénique, soumise aux lois du marché libre et à une politique oppressive.
Warlikowski construit un théâtre existentiel, parabole de la représentation métaphorique de la réalité, lieu de mémoire, miroir de l’histoire et des expériences humaines liminaires. Il ne procède pas, comme c’est la mode aujourd’hui, à la déconstruction du théâtre comme médium. Ilcrée un théâtre, métaphore constante du monde s’échappant vers l’univers ésotérique de l’imaginaire. On peut risquer l’affirmation que lorsque la jeune génération des metteurs en scène actuels lit Giorgio Agamben — pour lequel la langue se trouve toujours en tension avec le monde car les mots ne seront jamais complètement adéquats pour décrire la réalité à laquelle ils se réfèrent — Warlikowski, lui, lit Anthony Giddens qui se prononce pour un projet d’identité individuelle plastique. La majorité des créateurs contemporains s’élève aujourd’hui contre une matrice hétéro-normative de la représentation théâtrale mais, tandis que certains se limitent au questionnement sur la séparation entre masculin et féminin avec l’idée que le genre appartient à la culture et non à la biologie et qu’il y en a autant que l’on peut en produire, Warlikowski, lui, s’intéresse à l’amour romantique révolutionnaire. L’amour romantique cache, en effet, en lui ce potentiel romantique qui lie de manière indissociable l’aspiration à la liberté, à l’épanouissement et à la spiritualité. C’est pourquoi, contrairement au théâtre post-dramatique
dans lequel l’acteur est, au fond, comme le dirait Pollesch « un cochon capitaliste » utilisé par le metteur en scène pour construire son œuvre, dans le théâtre « romantique » de Warlikowski, les acteurs construisent les personnages scéniques avec toute l’échelle de leurs motivations psychologiques : ils en sont les coryphées spirituels. « On m’humiliait lorsque je charmais et maintenant que je ne le fais plus, on m’humilie toujours » dit, sur scène, l’héroïne de Rogazzo dell’Europa, racontant ses frustrations. Dans le théâtre de Warlikowski les acteurs n’ont jamais perdu leurs « charmes ». Ils s’appuient sur la conviction romantique que l’expression sincère d’émo- tions authentiques possède une telle puissance d’action qu’elle permet aux spectateurs d’éprouver ces émotions.
Warlikowski est l’exemple de l’émigré romantique. Il a quitté, il y a longtemps, sa ville natale de Szceczin, cette ville sans âme et sans maître avec ses Terres Recouvrées, ses Polonais, ses Juifs et ses Lituaniens. Puis la ville de ses études, Cracovie et son marasme, son provincialisme et son manque de tolérance envers les opinons divergentes. Fasciné par les couleurs de la culture en France, en Allemagne ou en Hollande, il a émigré, laissant pour de nombreuses années sa patrie. Il a ressenti à l’étranger le poids de la « polonité » et le caractère étranger de cet Occident où les gens ne vont pas au théâtre pour trouver des réponses aux grandes questions du temps présent. En accord avec l’ethos de l’artiste romantique, il a dû se révolter et lutter contre les entraves et l’oppression des mœurs et contre la xénophobie. Et c’est cette tension entre le particularisme local et l’universalisme, la tradition et le déracinement, le lieu et sa transgression, le mythe et la forme sensuelle du monde, si caractéristique pour l’art romantique,
qui est devenue la marque constante de son théâtre.
Il semblerait donc que Warlikowski ne soit pas un occidental pragmatique mais un idéaliste slave sur lequel la « terrible slavitude » imprime son empreinte. Dans tous ses spectacles, sur le modèle romantique, il revendique ce qui est caché, étouffé, rejeté à la marge. Il s’occupe des problèmes existentiels de l’Autre qui se débat avec son destin, sa mémoire, ses complexes, avec la mort, la folie et Dieu. « La création romantique et post romantique », écrit Maria Janion, « est sans cesse consciente de l’état douloureux de l’oubli ou de la méconnaissance. Cet état se manifeste dans le trauma slave, le sentiment d’appar- tenir aux plus faibles, à ceux qui ont été persécutés, asservis, humiliés, privés d’un héritage mystérieux, injustement oubliés et, soit repoussés, soit broyés par un processus que l’on a appelé progrès »4. Ce trauma du rejet du plus faible est précisément le thème de Angels in America, spectacle qui ne traite pas tant des gays de l’Amérique de Ronald Reagan, ni de la guerre de Sécession, ni de la diaspora juive, ni de la perestroïka, ni du fait qu’il est difficile d’être à gauche, que du fait que seules les expériences existentielles décident de ce que nous sommes, car il y a au monde autant de raison et de rationalité que l’on pourra en imposer par sa propre expérience. Dans Angels in America, dans un monde où les plus hautes valeurs perdent leur valeur, la maladie est la métaphore du changement du monde —c’est grâce à elle que l’homme devient capable d’aimer, d’entreprendre ce qui le dépasse, de croire en la transcendance. « Dieu » dans la vie de l’homme ne signifie pas un ordre meilleur, un idéal auquel il faut soumettre sa vie, mais la possibilité d’un changement, la foi dans la transformation de l’ordre actuel.
La réponse à la question : « Qui sommes nous ?» pose le principe de la foi dans une nouvelle naissance et de la remise en cause de toutes les notions et valeurs qui donnaient un sens à la vie. L’expérience de la maladie pour les héros de Angels in America, comme pour les romantiques, consiste en un dépassement des difficultés de sa propre existence et rend possible l’ouverture aux Autres. Angels in America parle de la nécessité d’une nouvelle vision du monde, de la faute et du pardon, d’autres sexualités dans un seul espace comme si le monde ne se composaïit pas de majorités et de minorités mais était construit sur la diversité et l’équilibre.
Si la maladie dans le spectacle de Warlikowski est la métaphore de la transgression, ses héros dépassent leurs propres limites au nom de l’amour. Les conflits avec la transcendance ne manquent pas. La rencontre avec l’Ange est aussi réelle qu’une averse ou une rue, que le sexe ou la maladie. Le personnage de l’Ange dans ce spectacle s’inscrit dans un ensemble de stéréotypes romantiques : l’Ange-femme boiteuse est comme le corps souffrant de Polonia, d’un côté obscur et menaçant et de l’autre, lorsqu’elle découvre son visage, magnifique. Comme les romantiques, Warlikowski convainc que le monde n’est composé que d’Autres, de despotes et de vengeurs auxquels la mort n’apportera pas d’apaisement mais aussi de gens qui ne savent pas aimer et veulent apprendre, et de gens qui ne veulent pas pardonner et pardonnent. Ce sont justement ces faibles, ces exclus, comme dans le drame romantique Kordian, Konrad ou Mazepa qui portent l’espoir d’un changement du monde, car ils tentent de se changer eux-mêmes et ont la chance de changer le monde. Les Anges les aident seulement dans la difficile acceptation d’eux-mêmes.

Le théâtre romantique est donc le théâtre de la transformation, le théâtre qui se concentre sur le verbe incarné, sur le verbe en acte. La conscience romantique de Warlikowski se révèle dans le type de héros, mais avant tout dans la permanence du conflit interne entre la défense de sa propre autonomie et de sa propre mémoire et la nécessité de sa déconstruction dans la crainte.
- F Ankersmit, Narration, représentation, expérience. rééd. E. Domañnska, Krakéw, 2004.*F Ankersmit, Narration, représentation, expérience. rééd. E. Domañnska, Krakéw, 2004. ↩︎
- M. Janion, Sauras-tu ce que tu as vécu ? Warszawa, 1996, p. 14. ↩︎
- M. Halbwachs, Les Cadres sociaux de la mémoire, traduit par M. Krol, Varsovie 2008. ↩︎
- M. Janion, Niesamowita Slowiańszczyzna, Krakéw, 2006, p. 28. ↩︎
- A. Mickiewicz, Œuvres, tome XI, Warszawa, 1998, p. 138. ↩︎