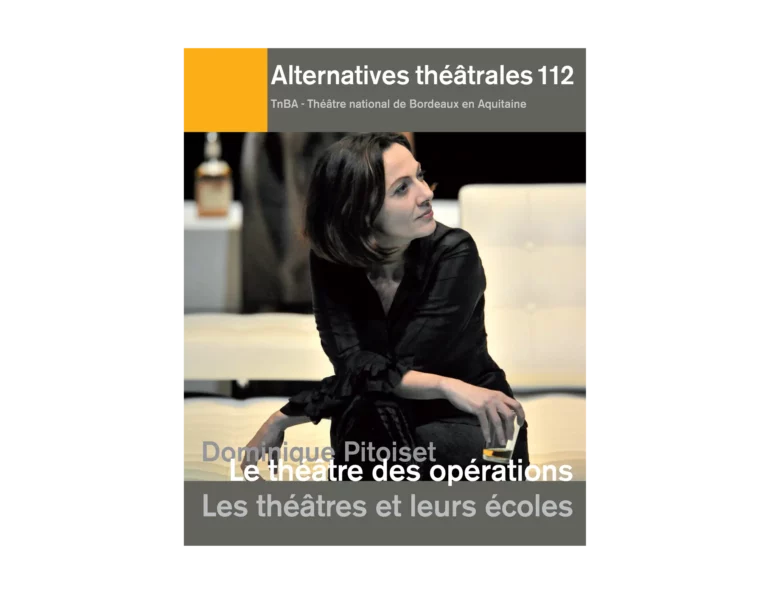LE XIXe SIÈCLE, en son hégémonie bourgeoise, avait depuis Napoléon érigé le Conservatoire de Paris, ex-École royale de chant et de déclamation, créé en 1784 sur ordre de Louis XVI, comme le modèle unique et exclusif de l’enseignement national et centralisé de l’art dramatique. Imité dans un moindre élitisme par les conservatoires de province et ceux d’arrondissement, le plus souvent réduits quant à eux à une classe d’art dramatique parente pauvre et négligée d’un conservatoire de musique et de danse tout puissant, le Conservatoire de Paris, comme son nom l’indique, avait pour mission de « conserver », de reproduire et de transmettre, par-delà le temps et les générations, un code de jeu immuable, comme se plaisait et se plaît encore à penser l’idéologie bourgeoise, porteuse de valeurs d’éternité et d’universalité : celles entre autres du bon goût français. Temple de la « reproduction » auraient pu dire Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron, « appareil idéologique d’État » aurait pu ajouter Louis Althusser, le Conservatoire veillait à faire respecter, au même titre que l’Académie ou la Comédie-Française(s), des choix de répertoire hérités de Boileau ou de Voltaire – le bon Molière et le mauvais Molière, le bon Corneille et le mauvais Corneille –, ainsi que des choix esthétiques liés aux contraintes de l’époque – toiles peintes et carton pâte, éclairage à la rampe, machinerie théâtrale héritée de la scène à l’italienne… Mais par-dessus tout, y étaient inculquées une grammaire et une rhétorique du jeu fondées essentiellement sur le statisme corporel de l’acteur, figé dans l’image décorative comme un personnage dans un tableau académique ; sur la contrainte de se positionner à l’avant scène, de préférence au centre, pour bénéficier des feux de la rampe, unique source d’éclairage jusqu’à l’adoption de l’électricité ; sur la réduction du corps à son organe vocal, enfin, qui fera de la diction, de l’articulation, de la déclamation, de la profération, voire de la prosodie et de la versification, les enjeux exclusifs de cette pédagogie très circonscrite. Tout dans cet enseignement technique prédisposait l’acteur à dégrader son jeu par le recours aux trucs, aux recettes, aux ficelles et autres facilités complaisantes efficacement éprouvées sur un public lui-même complaisant, qui préférait le confort et la sécurité d’un modèle déjà connu et reconnu au risque aventureux de la nouveauté, de l’inconnu et de la perturbation. Comme le martelait récemment à la télévision le sketch d’un humoriste qui précisément traitait de l’actualité du théâtre privé dans les salles parisiennes : « jamais surpris, jamais déçu ! » Écoutons le metteur en scène et historien du théâtre Sylvain Dhomme évoquer la dégradation de la scène française dans les années 1880 :
« À l’état de l’écriture correspondait l’état de la scène. Le théâtre entier était livré aux fabricants d’effets, au cabotinage le plus parfait. Les acteurs étaient les rois de la scène. On écrivait pour eux, ils régentaient les auteurs, choisissaient leurs costumes et montaient sur les planches comme sur un piédestal, en frappant du talon pour avertir la claque » (LA MISE EN SCÈNE D’ANTOINE À BRECHT, 1959).
Indignation
C’est à cela, bien sûr, que réagit André Antoine avec l’invention d’un jeu naturaliste et de ce qu’on appelle « la mise en scène moderne », bientôt suivie par les recherches expérimentales de Lugné-Poe et du théâtre symboliste en matière d’onirisme et de désincarnation. Et pourtant, trente ans plus tard, entre la fossilisation académique des théâtres officiels (Comédie-Française et Odéon) et la vulgarité de plus en plus débridée des théâtres de boulevard, rien n’a beaucoup changé. Voilà donc ce qu’en 1913 écrivait un « jeune homme en colère », un siècle ou presque avant Stéphane Hessel et les centaines de milliers de jeunes gens qui de par le monde lui emboîtent aujourd’hui le pas :
« Par bonheur, nous avons atteint l’âge d’homme sans désespérer de rien. À des réalités détestées, nous opposons un désir, une aspiration, une volonté. Nous avons pour nous cette chimère, nous portons en nous cette illusion qui donne le courage et la joie d’entreprendre. Et si l’on veut que nous nommions plus clairement le sentiment qui nous anime, la passion qui nous pousse, nous contraint, nous oblige, à laquelle il faut que nous cédions enfin : c’est l’indignation.
Une industrialisation effrénée qui, de jour en jour plus cyniquement, dégrade notre scène française et détourne d’elle le public cultivé ; l’accaparement de la plupart des théâtres par une poignée d’amuseurs à la solde de marchands éhontés ; partout, et là encore où des grandes traditions devraient sauvegarder quelque pudeur, le même esprit de cabotinage et de spéculation, la même bassesse ; partout le bluff, la surenchère de toute sorte et l’exhibitionnisme de toute nature parasitant un art qui se meurt, et dont il n’est même plus question ; partout veulerie, désordre, indiscipline, ignorance et sottise, dédain du créateur, haine de la beauté ; une production de plus en plus folle et vaine, une critique de plus en plus consentante, un goût public de plus en plus égaré : voilà ce qui nous indigne et nous soulève. » (Jacques Copeau, APPELS, RÉGISTRES I, Gallimard, p. 19 – 20).
Ce texte est publié sous la forme d’un manifeste dans la Nouvelle Revue Française (NRF), que Jacques Copeau avait fondée quatre ans plus tôt avec la complicité de ses amis Gaston Gallimard et André Gide. Ils s’y étaient déjà attaqués à la forteresse imprenable de l’illusion de réalité, cet artifice également hégémonique du roman académique bourgeois. Copeau, épaulé par ses amis Jouvet et Dullin rencontrés deux ans plus tôt, s’en prenait cette fois au théâtre bourgeois, à sa démagogie et à son état de corruption. Ce manifeste est rédigé quelques semaines avant l’ouverture du Théâtre du Vieux Colombier et lui sert en quelque sorte de programme ou d’éditorial. En bonne place, au chapitre V, juste après celui consacré à la troupe, figure le projet de création d’une école d’élèves-comédiens adossée au théâtre et à son objectif de régénération : «[…] nous y appellerions d’une part de très jeunes gens et même des enfants, d’autre part des hommes et femmes ayant l’amour et l’instinct du théâtre, mais qui n’avaient pas encore compromis cet instinct par des méthodes défectueuses et des habitudes de métier » (ibid., p. 29).