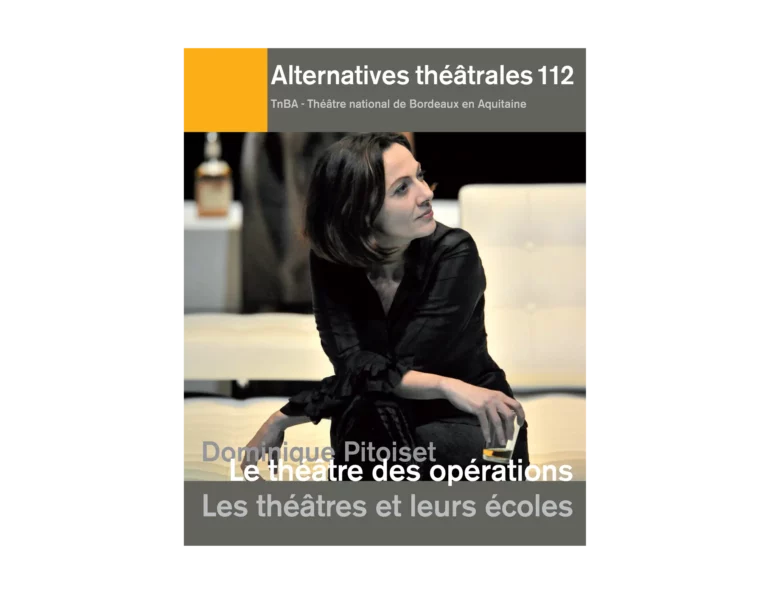KEVIN JACQUET : Dans quel contexte avez-vous hérité de l’école du Théâtre National de Bretagne dont vous êtes le directeur ?
Stanislas Nordey : L’école du Théâtre National de Bretagne (TNB) est une école jeune, un peu particulière, fondée à l’intérieur d’un théâtre, par un directeur et un artiste animés par le désir d’une école « pas comme les autres ». Christian Colin l’a fondée avec Emmanuel de Véricourt, à l’époque directeur du TNB. J’en suis le quatrième directeur après Christian Colin, Dominique Pitoiset et Jean-Paul Wenzel. La notion d’héritage est assez juste dans mon cas car je n’aurais pas pris la direction d’une autre école. Celle-ci me semblait disposer de tous les atouts pour construire un réel projet pédagogique, d’abord parce qu’elle a été créée par un artiste au cœur d’un théâtre, mais aussi parce qu’elle n’a qu’une seule promotion tous les trois ans, luxe incroyable, qui permet de bien accompagner un groupe tout en recréant l’école tous les trois ans. Cette notion de renouvellement est importante. Il n’y a que deux professeurs permanents dans la structure : le directeur et le responsable pédagogique. Cette situation permet de suivre chaque promotion à son aune. C’est évidemment très précieux et l’une des raisons pour lesquelles j’ai décidé de rejoindre cette école. Il y avait aussi à Rennes une tradition d’une école que l’on pourrait qualifier d’alternative, liée à la programmation qu’il y avait dans le théâtre. « Alternative » est peut-être un grand mot mais c’est une école qui a directement fait appel, dès sa création, à Claude Régy, à François Tanguy, personnalités hors des sentiers habituels. Ceci me correspondait bien, au vu de mon parcours. J’ai à la fois prolongé quelque chose qui s’était inventé, tout en accentuant certaines choses comme on le ferait, effectivement, d’un héritage. Je suis actuellement en train de quitter l’école – je la dirige depuis douze ans – et j’essaie à présent de transmettre à Éric Lacascade, comme j’en ai hérité, quelque chose de la tradition et de la particularité de cette école.
K. J. : Vous dites que le TNB est une école « pas comme les autres », « alternative ». Quels seraient selon vous les travers des écoles plus traditionnelles ?
S. N.: Je suis passé par ces écoles-là en tant qu’acteur ; j’ai étudié au conservatoire de Paris. J’en étais sorti depuis à peine dix ans lorsque j’ai pris la direction de l’école du TNB. Sans doute était-ce très précieux qu’un homme encore jeune dirige une école parce que j’avais un souvenir assez vif des défauts et qualités de l’ensei- gnement reçu, souvenir qui m’a servi pour rêver cette école. J’avais développé avec Didier-Georges Gabily cette idée de créer une structure pédagogique qu’on aurait appelée « L’Innovatoire », par réaction immédiate et un peu bête au Conservatoire, parce que je pense qu’une école de théâtre doit aujourd’hui ouvrir plutôt que fermer, déplacer plutôt qu’enfermer. Le principe d’une école se fonde souvent sur la volonté de transmettre quelque chose qui serait de l’ordre de la tradition, de perpétuer. À Rennes à l’inverse, l’idée est plutôt de donner des fondamentaux – c’est l’une des écoles de France où les élèves sont les meilleurs techniciens, et je suis très attaché, comme artiste, à la question de la technique et à la maîtrise de l’outil – et, en même temps, d’offrir un regard sur les différents types de théâtre. Au Conservatoire, nous étions dressé à devenir de bons produits de l’institution théâtrale susceptibles d’intégrer de grandes productions ; le rêve étant de jouer Hamletau Théâtre de l’Odéon ou quelque chose du genre. Je trouvais que c’était une vision très réductrice du théâtre car il n’y a pas qu’un seul théâtre ! Il y a le théâtre dans les grandes institutions, le théâtre itinérant, le théâtre pour les enfants, le théâtre croisé avec la danse ou le cirque, etc. Il y a énormément d’expériences, énormément de chemins. L’idée de cette école, et ce système de promotion triennale le permet, est d’éveiller les jeunes acteurs à un désir de théâtre précis, celui qui leur convient. Quand les étudiants arrivent à l’école, je les confronte en premier à des textes de Roland Barthes ou de Michel Foucault, afin de les déplacer immédiatement, afin de les extraire d’où ils viennent. Dès le début, on les déplace de sorte qu’ils ressentent que l’art de l’acteur est avant tout un art de la curiosité qui intègre un large spectre de possibilités. On organise des rencontres avec des praticiens qui les emmènent dans des territoires différents et, en même temps, on les éveille dès l’entrée à l’école à ce qui se passera à la sortie de celle-ci, ce qui manque dans bien des formations. À leur entrée, je leur dis souvent que ce que je cherche est qu’ils puissent sortir d’ici comme des acteurs « heureux et intelligents ». Par intelligence, j’entends, en référence au terme intelligo, la compré- hension par l’acteur de ce qu’il est et de l’environnement où il évoluera ; en d’autres termes, choisir un chemin qui lui convient. L’acteur heureux est celui qui sait dès le début que le métier qu’il pratique est intermittent. Même un acteur qui travaille beaucoup ne travaillera que six à huit mois par ans, et non douze. On dit souvent à ces jeunes gens qu’il est important pour eux d’être « acteur et…»: acteur et écrivain, acteur et pédagogue, acteur et metteur en scène, acteur et ingénieur du son, etc. L’autre singularité de l’école du TNB réside dans son cursus. Il n’y a pas de cours techniques réguliers à l’école, nous fonctionnons par master class. On a fait le choix de l’immersion, qu’il s’agisse de chorégraphie, de danse ou d’autres disciplines, notamment en réaction à ce que j’ai personnellement vécu dans les écoles à l’intérieur desquelles les disciplines techniques étaient picorées.

Photo Caroline Ablain.