LA MUSIQUE, toutes les musiques innervent en profondeur l’univers scénique d’Ivo van Hove : depuis le début, c’est « un élément constitutif » de son théâtre, « un acteur à part entière »1. Sa première pièce, GERUCHTEN (Rumeurs, 1981), swinguait entre le tango et le disco, et sa deuxième, ZIEKTEKIEMEN (Germespathogènes, 1982), accolait un morceau de Queen, « Oh ! Darling » des Beatles, un air chanté par Yves Montand dans LE MILLIARDAIRE, des extraits des bandes-son de JamesBondet de CitizenKane. Plus récemment, David Bowie voilait le ciel d’ANGELS IN AMERICA de Tony Kushner (2008), Neil Young alanguissait OPENING NIGHT et Bruce Springsteen débridait HUSBANDS d’après Cassavetes (2006 et 2012). L’insertion des chansons obéit elle-même à une modalité d’ordre musical : écho du contexte d’écriture, interlude ou ostinato, accompagnement ou point d’orgue émotionnel, caisse de résonance du sous- texte ou variation sur un thème parfois teintée de parodie (« Honesty is such a lonely word » de Billy Joel dans LE MISANTHROPE). Mais il n’est pas rare que la musique soit aussi jouée en direct, composée par Harry de Wit pour UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR (1995), par le groupe Bl!ndman pour les TRAGÉDIES ROMAINES (2007) et THÉORÈME d’après Pasolini (2009) – des morceaux originaux d’Éric Sleichim encadrant l’interprétation de quatuors de Beethoven et de Webern –, ou encore par Eef van Breen pour LE PROJET ANTONIONI, où retentissait aussi la Marche funèbre de SIEGFRIED (2009)… Du disco à la musique symphonique, en passant par le rock, la pop, le jazz et l’électroacoustique, les choix sont indénia- blement éclectiques, auxquels il conviendrait encore d’ajouter la mise en scène de la comédie musicale RENT de Jonathan Larson (2000) ou la création d’une nouvelle CARMEN sur une musique de Stef Kamil Carlens (2002).
Si l’ancrage de la musique ouvre la voie aux incursions dans l’opéra, non moins éclectique paraît de prime abord le répertoire lyrique : LULU de Berg (Vlaamse Opera, 1999), L’AFFAIRE MAKROPOULOS de Janácek (Nederlandse Opera, 2002), IOLANTA de Tchaïkovski (Nederlandse Opera, 2004), LE RING de Wagner (Vlaamse Opera, 2006 – 2008) et IDOMÉNÉE de Mozart (Théâtre royal de la Monnaie, 2010). Ces œuvres, autant la disparité des styles et l’amplitude des formats paraissent les éloigner, autant un fort coefficient de théâtralité les rapproche, qu’elles tirent de la mythologie ou de personnages légendaires. Est-ce une coïncidence si plusieurs ont été montées par Chéreau – ou si Chéreau, du moins, a monté des opéras écrits par les mêmes compositeurs, à l’exception notable de Tchaïkovski ? Sans doute pas. Car s’il est un metteur en scène qu’Ivo van Hove admire tout particulièrement, pour l’intensité du jeu qu’il imprime aux chanteurs et pour sa direction des chœurs, c’est justement lui. Il n’est donc pas fortuit non plus que, dans sa propre interprétation du troisième acte de la WALKYRIE, il rappelle, comme en hommage, les chevaux de Chéreau présents en 1976 (on sait qu’ils ont disparu ensuite, qu’ils n’étaient qu’un « principe initial » ou une « étape de l’apprentissage »)2. Chéreau, pourtant, est venu plus vite, plus tôt, à la mise en scène lyrique. Pourquoi van Hove a‑t-il attendu ? Par manque d’occasions ? Par insécurité ? Peut-être. Mais, par-dessus tout, la connaissance du plateau lui semblait (et lui semble toujours) indispensable pour retrouver, dans un art aussi « discipliné » que l’opéra, la même liberté qu’au théâtre – une liberté sensiblement écornée par celui qu’il qualifie de « premier metteur en scène », le compositeur, et celui qu’il désigne sous le nom de « second capitaine du navire », le chef d’orchestre. Le théâtre est son territoire et l’opéra sa conquête. Théâtre-laboratoire, opéra-mise à l’épreuve. Désormais, depuis une dizaine d’années, une circulation s’est établie entre les deux formes et l’activité lyrique va s’intensifiant : en 2012 – 2013, Ivo van Hove va mettre en scène DER SCHATZGRÄBER de Schreker au Nederlandse Opera, MACBETH de Verdi à l’Opéra de Lyon et MAZEPPA de Tchaïkovski au Komische Oper3.
LULU, le premier opéra qu’il monte en 1999, lui permet à la fois de renouer avec la matrice de l’œuvre, la pièce de Wedekind qu’il a mise en scène en 1989, et d’affirmer, ici comme au théâtre, son intérêt pour les personnages féminins plus grands que nature, « forts et vulnérables à la fois », souvent torturés, parfois névrosés, toujours aliénés, marginaux, peut-être monstrueux – des « outsiders » comme il les nomme. Lulu, femme fatale s’attirant les faveurs de tous, meurtrière malgré elle, prostituée assassinée dans la détresse ; Emilia Marty, diva esseulée, fatiguée de liaisons superficielles comme d’une immortalité sans lendemain, mourant pour retrouver sa condition humaine ; Brünnhilde, brisant la loi paternelle, amoureuse solaire et trahie, entraînant dans son immolation la chute de l’ordre ancien ; Électre, furieuse et vindicative, double sombre de la prisonnière Ilia qui parvient, elle, à « transcender sa douleur » par un amour salvateur. Blanche Dubois et Hedda Gabler ne sont pas loin…
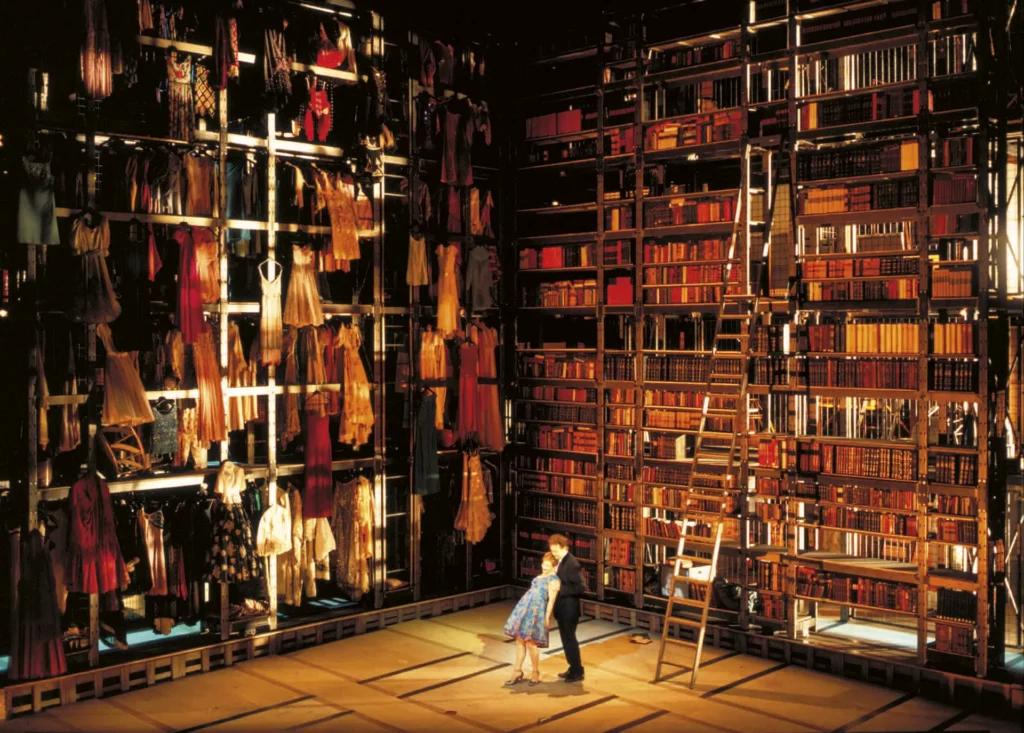
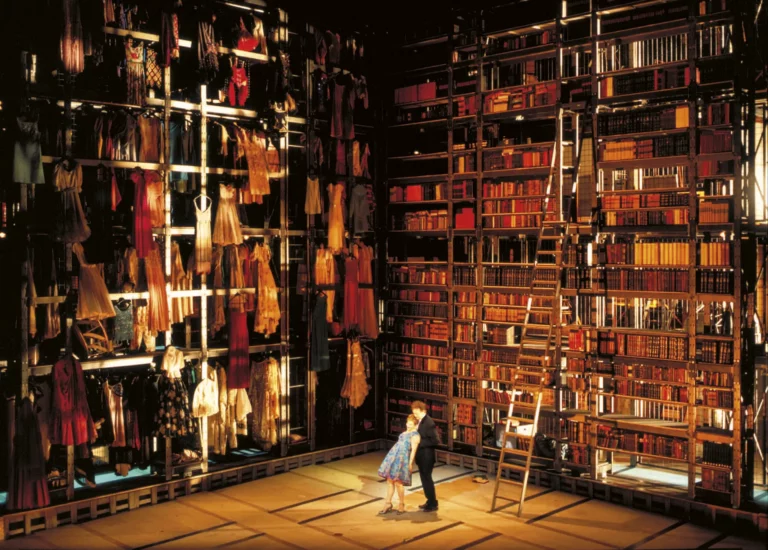




![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)
