DENISE WENDEL : Vous avez imaginé et mis en scène plusieurs productions pour le théâtre et l’opéra, basées sur des œuvres telles que WOYZECK de Bruckner, FAUST de Goethe ou UBU ROI d’Alfred Jarry. En 1998, votre première production à l’opéra, IL RITORNO D’ULISSE de Monteverdi, était une collaboration avec la Handspring Puppet Company, basée à Johannesburg, lors du KunstenFestivaldesArts à Bruxelles. Elle a été suivie de LA FLÛTE ENCHANTÉE au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles en 2003 puis de l’opéra LE NEZ de Chostakovitch au Metropolitan Opera de New York en 2009. Vous êtes un artiste international dont on connait l’implication dans les décors à travers les œuvres d’art générées par ces projets, par exemple LEARNING THE FLUTE, une installation présentée à Goslar, en Allemagne, où vous avez remporté le prix Kaiser Ring en 2003, ou les eaux fortes réalisées pour LE NEZ, exposées une première fois au MoMa à New York. Votre travail de metteur en scène de théâtre est peut-être moins connu.
William Kentridge : Il y a des metteurs en scène qui enchaînent huit productions par an pendant vingt ans, alors que j’ai fait, en tout et pour tout, huit productions en trente ans. Alors parfois je me demande « Mais qu’est-ce que tu fabriques ? Tu te prends pour un metteur en scène ?» Je n’ai pas tout à fait l’impression d’être un charlatan de la mise en scène, mais j’ai du mal à me comparer aux metteurs en scène qui ne font que du théâtre.
D. W. :Quand vous êtes venu à Paris pour intégrer la classe de Jacques Lecoq à l’École Internationale de Théâtre dans les années 1980, vous aviez l’intention d’étudier le jeu d’acteur et la mise en scène.
W. K. : J ’étais à une étape de ma vie où je ne savais pas ce que je voulais faire, et où j’avais le choix entre trois choses : soit je continuais à étudier l’art et je devais aller dans une école d’art reconnue, comme la Slade School ou la Central School of Art à Londres ; soit j’étudiais le cinéma, à la New York Film School ; soit je poursuivais le théâtre, mais je voulais dans ce cas une école qui s’intéressait à l’improvisation – Jacques Lecoq était donc un bon choix. Cette année-là, 1981 – 1982, à Paris, se révéla être l’année d’enseignement la plus productive que j’aie jamais reçue.
D. W. : Les techniques Lecoq vous servent-elles toujours aujourd’hui dans votre travail de metteur en scène ?
W. K. : Oui, tout le temps ! Les techniques Lecoq donnent un moyen pour arriver, par l’intermédiaire d’exercices utilisant des métaphores très concrètes, à une signification qui n’a rien à voir avec la motivation psychologique du jeu d’acteur. On demande à l’acteur d’imaginer un objet physique, par exemple un bloc d’argile, d’imaginer à quoi ressemble l’argile, ses propriétés physiques – la possibilité de la découper, de la malaxer, sa faculté à garder la forme qu’on lui imprime –, d’étudier les propriétés dynamiques de l’argile. Il se produit alors un transfert de ces sensations dans le travail dramatique de l’acteur. Avec ces outils, on peut construire tout un personnage, et au fur et à mesure que l’on travaille un rôle, ces sensations restent, et on peut s’y reporter pour se reconnecter immédiatement au personnage.
D. W. : Ces techniques sont-elles utiles aux chanteurs d’opéra ?
W. K. : Avec les chanteurs d’opéra, il faut adopter une approche très différente. Par exemple, il serait impossible de solliciter de la part d’un chanteur le genre d’improvisations physiquement exténuantes que l’on pourrait demander à un acteur, tout d’abord en raison des exigences physiques liées à une bonne projection de la voix, et ensuite en raison du cadre temporel fixé par la musique. Il faut donc trouver un itinéraire métaphorique différent, qui soit sans difficulté physique extrême.
Mais le travail avec les chanteurs peut être difficile parce que, plus qu’au théâtre, on se trouve face à quelqu’un qui peut avoir déjà chanté le même rôle pour douze maisons d’opéra différentes, et qui a sa manière d’interpréter Papageno, sa manière d’interpréter Pamina, avec plein de tics. C’est parfois très difficile de les supprimer et de repartir à zéro.
D. W. : Les productions lyriques impliquent aussi une collaboration avec le chef d’orchestre, qui a souvent ses propres idées sur une œuvre précise.
W. K. : Aucune de mes expériences de collaboration avec un chef d’orchestre n’a été concluante. Je n’ai jamais eu de vraie conversation sur des questions artistiques avec un chef d’orchestre, jamais !
J’ai par exemple travaillé avec un chef d’orchestre qui voulait régler au millimètre près le moindre détail de la mise en scène. Il m’avait expliqué lors d’une première rencontre ce qu’il voulait faire sur le plan musical, et comment il voulait traiter les dialogues ; nous avons donc eu un petit bras de fer à ce sujet, jusqu’à ce que je lui explique que les dialogues étaient mon domaine.
Un autre chef était absent pendant toute la période des répétitions. Il n’est arrivé que trois jours avant la première pour se familiariser avec la mise en scène. Pour une nouvelle production, ce serait bien de trouver un chef d’orchestre, ou peut-être un dramaturge musical, avec qui je pourrais avoir un réel échange d’idées.
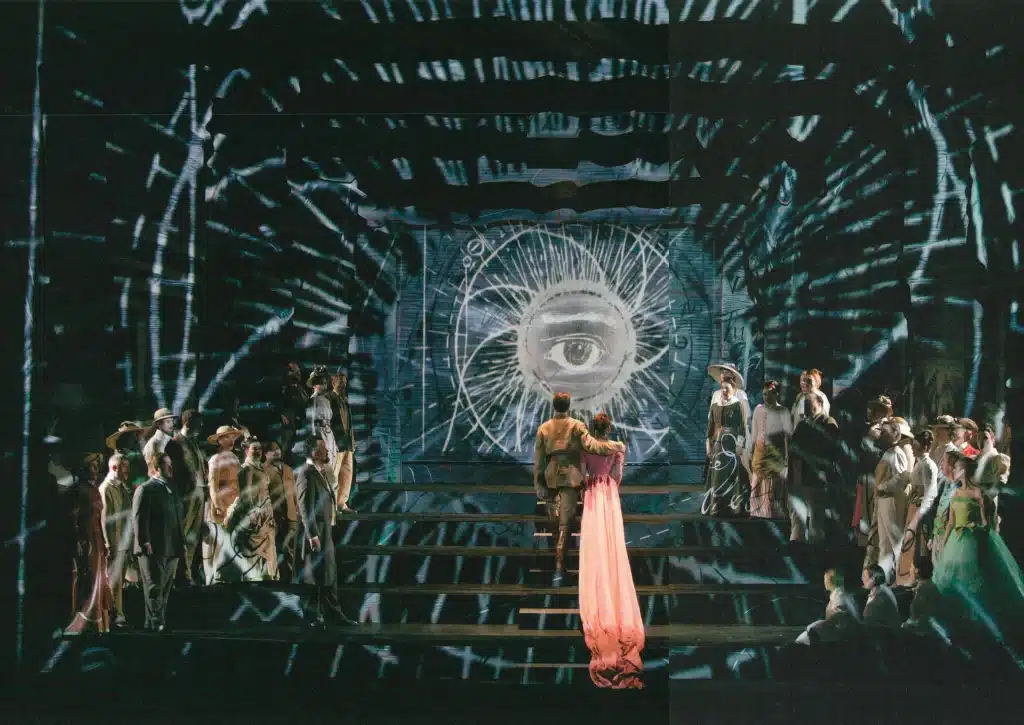
D. W. : Vous aviez nourri l’espoir de devenir acteur, qu’en est-il advenu ?
W. K. : Les bons acteurs sont comme des caméléons, dans le sens où ils peuvent endosser des personnages très différents, si bien qu’à chaque fois qu’on les voit sur scène, ils sont complètement transformés. Tandis que moi, j’avais l’impression que, peu importe ce que j’allais faire, ce serait toujours la même performance. Je pense que j’ai eu de la chance de découvrir à l’école de théâtre que j’étais à ce point mauvais acteur. J’en étais réduit à être un artiste, et je m’en suis accommodé.
D. W. : Vous avez pourtant remporté un succès considérable avec votre spectacle en solo I AM NOT ME, THE HORSE IS NOT MINE, une conférence-performance accompagnée de projections, initialement réalisée pour la Sydney Biennale en juin 2008.





![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)

