PARMI TOUS les metteurs en scène actifs dans le domaine du théâtre parlé comme dans celui de l’opéra, le nom de Katie Mitchell se distingue depuis quelques années. L’artiste britannique s’est forgé une réputation dont la solidité va grandissant, à force de spectacles d’une grande rigueur et d’une rare perfection. Dans une esthétique volontiers réaliste et une recherche de vérité quasiment scientifique (« c’est de la science !» est une phrase qui revient souvent dans sa bouche, quant il s’agit de calculer les angles de vision d’un décor ou le temps d’un interlude). Mais si elle sait dégager ce que les textes d’hier ou d’aujourd’hui ont de violemment actuel, son esthétique hyper-réaliste fuit les outrances d’un certain Regietheater pour trouver une objectivité dont peut se dégager une poésie frémissante. Après plusieurs expériences lyriques, tant dans le grand répertoire que dans la création contemporaine (OREST DE TROJAHN à Amsterdam), tant dans l’opéra au sens propre que dans des formes non-scéniques pourtant portées à la scène (JEPHTHA de Haendel, la PASSION SELON SAINT-MATTHIEU de Bach), la reconnaissance internationale est arrivée avec sa production virtuose de la fresque de Luigi Nono, AL GRAN SOLE CARICO D’AMORE, qui a transporté le public du Festival de Salzbourg en 2010 et du Staatsoper de Berlin en 2012. À la veille de la création attendue de WRITTEN ON SKIN de George Benjamin en juillet 2012 au Festival d’Aix-en-Provence, et avant des reprises dans les quatre coins d’Europe (Londres, Amsterdam, Toulouse, Florence, Paris, Munich, Vienne…), elle livre quelques réflexions sur son métier.
Alain Perroux : Votre monde théâtral est généralement réaliste, alors que l’opéra est très artificiel. Comment trouvez-vous votre chemin dans cette apparente contradiction ?
Katie Mitchell : Pour moi, l’opéra n’est pas artificiel. Il met en présence des personnages dans un temps et un espace précis. La seule chose étrange, c’est qu’ils chantent au lieu de parler ! Mais l’opéra a sa propre logique. On doit la comprendre, la respecter… et faire avec. Le texte est amplifié du fait qu’il est chanté, cela lui donne une subjectivité et une intensité beaucoup plus profonde que tout ce que vous pouvez faire avec le mot parlé. Et cela vous confronte à une série de règles différentes en termes de représentation. Mais en réalité j’aime beaucoup avoir des règles à respecter. Mon travail, après tout, n’est pas de soigner la musique – ça, c’est le boulot du chef d’orchestre – mais de faire en sorte que les actions des interprètes semblent véridiques, aussi précises et crédibles que la vie, et que ce le soit dans un monde puissant et clair à la fois.
A. P. : Quel rôle joue la musique, quand vous concevez un spectacle ?
K. M. : La musique détermine tous les choix, beaucoup plus qu’un texte de pièce de théâtre. Dans le cas de WRITTEN ON SKIN, que je mets en scène au Festival d’Aix-en-Provence 2012, le compositeur George Benjamin agit comme un « programmateur psychologique » qui fait en sorte que l’action arrive, réplique après réplique, scène après scène. Si la partition indique que la protagoniste féminine est dans un état émotionnel précis, comme le désespoir, il me sera impossible de mettre en scène contre cette émotion. Parce que tout, dans le tissage musical, va dans une direction psychologique précise. D’une certaine manière – et c’est quelque chose d’assez réjouissant – une partie du travail que le metteur en scène doit fournir vis-à-vis d’une pièce de théâtre est déjà fait dans un opéra. La difficulté, c’est de comprendre la texture du son. Et dans le cas d’une œuvre en création mondiale, évidemment, ce processus est très délicat puisqu’il n’y a aucun enregistrement de l’ouvrage et que je ne suis pas capable de lire une partition d’orchestre ni d’entendre dans ma tête le son produit. Pour WRITTEN ON SKIN, George Benjamin s’est assis avec moi pour m’expliquer en détail tout son opéra. Et il m’a même remis une partition complètement annotée, où il décrit mesure après mesure, au crayon rouge, la texture musicale recherchée à chaque seconde de sa musique. Habituellement, quand je travaille sur un opéra, je n’écoute pas beaucoup les mots de son livret, j’écoute ses sonorités et j’essaie de comprendre ce qu’elles ont de particulier. La seule lecture du livret ne vous donne pas d’indication de tempo, c’est un document qui n’a pas beaucoup de sens quand il s’agit de mettre en scène un opéra.
A. P. : Vous avez mis en scène des œuvres aux dramaturgies très contrastées. Monter un opéra de Janácek doit être très différent de mettre en scène un oratorio baroque comme JEPHTHA de Haendel, non ?
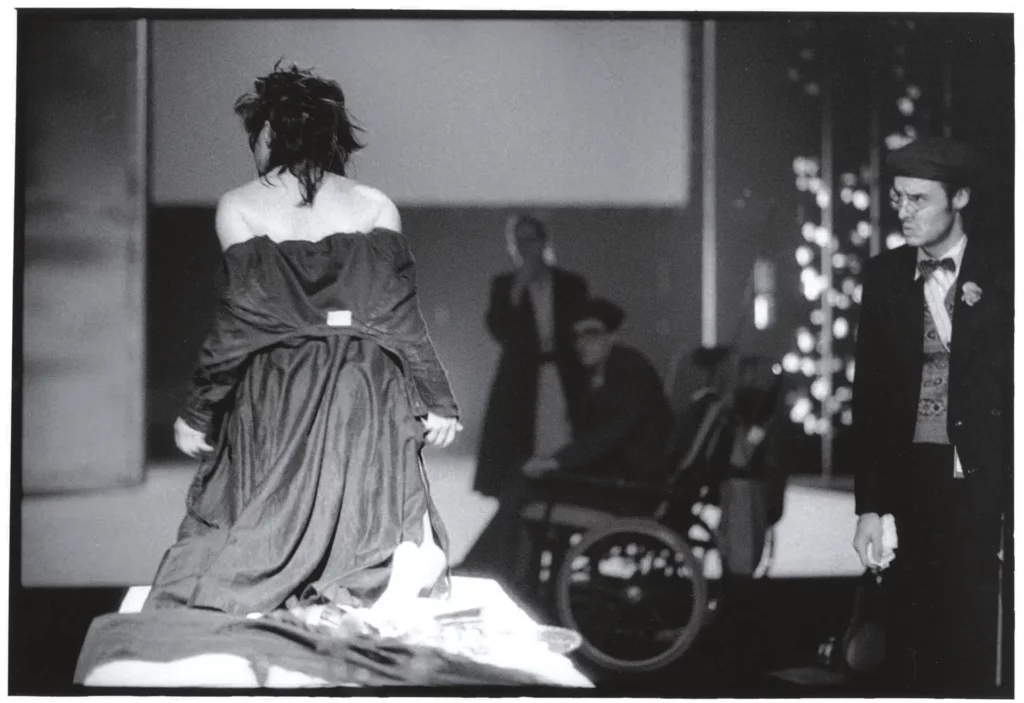
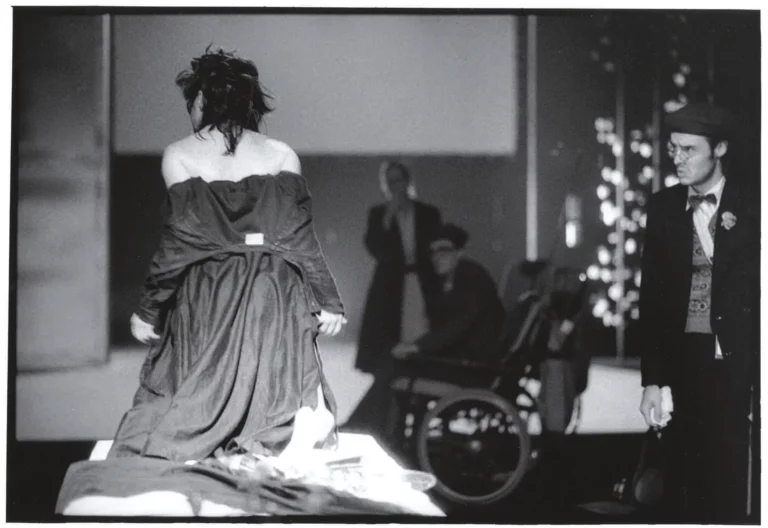



![Enfant de Médée : [maquette de costume] / [Louis-René Boquet]](https://alternativestheatrales.be/wp-content/uploads/2025/12/Enfant_de_Medee___maquette_.Boquet_Louis-Rene_btv1b8454742f-3-428x569.webp)

