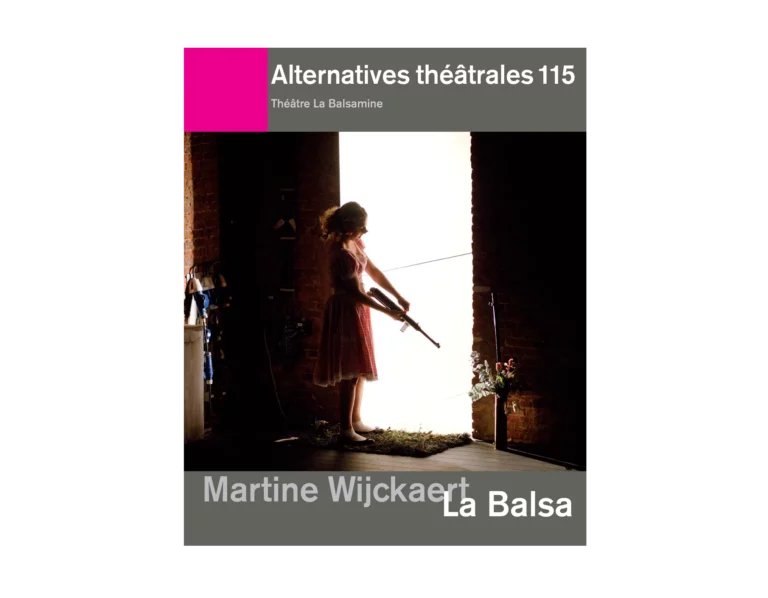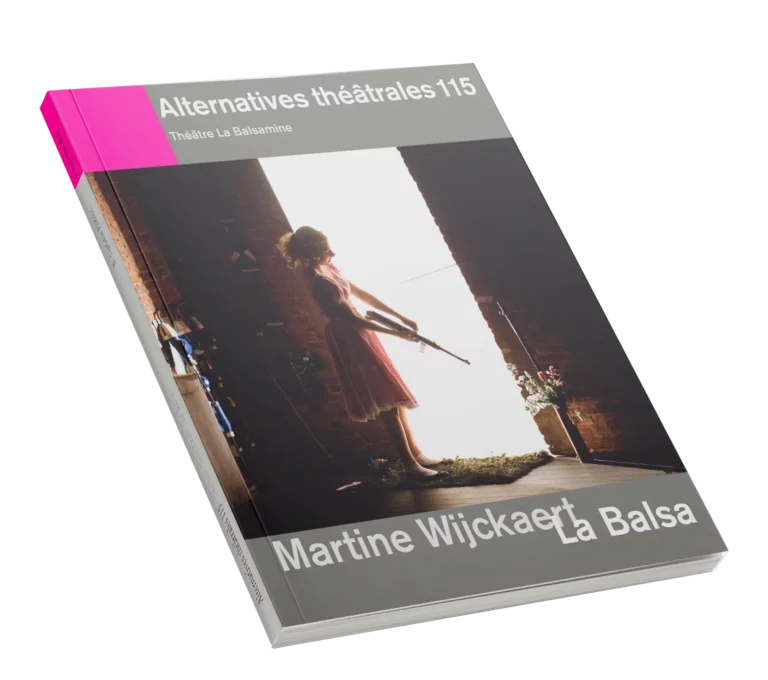« En mécanique, la transmission est conçue pour permettre le transfert d’énergie, généralement depuis une source vers un récepteur. »
LE 5 SEPTEMBRE 2011, en vue d’écrire cet article, je prends place aux côtés de Martine Wijckaert dans une classe à l’INSAS. Trente élèves (apprentis comédiens et metteurs en scène de deuxième année) sont assis autour de nous. Une petite nostalgie m’étreint : j’étais assise là moi-même, il y a six ans, elle était assise là, elle-même, il y a plus de trente-cinq ans, avec ses tresses blondes et ses grands yeux bleus… Dans les couloirs de l’INSAS, Martine hurle en permanence sur tous et sur tout. Elle a la réputation d’être une grande gueule au franc parler impitoyable (c’est un euphémisme), boule d’énergie dévastatrice, et les élèves savent qu’elle fait en général travailler le vaudeville (« vaudeville métaphysique » comme elle l’appelle, comme le théâtre de Thomas Bernhard, ou vaudeville du XIXe, Labiche, Feydeau…). Je ris sous cape en pensant : « ces élèves doivent s’imaginer qu’ils vont bien rigoler… ils ne vont pas comprendre ce qui leur arrive ». Et en effet : un premier choc a lieu. Martine a sorti son petit cahier noir, dont les pages sont couvertes de minuscules hiéroglyphes, taches d’encre, parcours fléchés et autres dessins cabalistiques ; elle a également extrait de son cartable antique un texte de théâtre tout aussi noirci d’annotations et autres ratures, dont on ne discerne pas encore le titre. Sa voix s’élève, grave, régulière, mesurée. Et le premier cours se déploie à la manière d’une leçon inaugurale au Collège de France, le conférencier arborant un sérieux et une prestance dignes d’André Malraux.
Pas un mot n’est prononcé plus haut que l’autre. Pas le moindre signe d’ouragan en vue. Les élèves sont médusés. Il n’y a plus un bruit. Les corps sont en alerte. La classe est une oreille géante. Les élèves sont, comme dit Feydeau, sur les « charbons » : ils ne s’attendaient pas à être ainsi traités, comme des artistes ; ils pressentent qu’il y a dans ce discours quelque chose de risqué, de violent peut-être. Pendant deux heures, obéissant à une tension continue, Martine Wijckaert leur parle. Elle leur livre une parole intime qui se donne généreusement, une parole bien à elle : elle parle de ce qu’est le théâtre, le texte de théâtre, le jeu d’acteur, la direction d’acteur, la posture philosophique et politique de l’artiste, de l’Art. À l’issue du cours, je peine à dissimuler mon émotion : une vie, un corps pourrait-on dire, entièrement voués au théâtre, sont exposés ici, devant ces jeunes. Ce qu’on leur transmet ici avec un tel calme, une telle précision, est le fruit de quarante ans de pratique artistique, de prises de risques sauvages. Car WIJ 1 est une sorte de pirate navigant depuis bientôt quarante ans dans les eaux calmes du paysage théâtral. Arpenteuse acharnée de territoires en friche, bâtisseuse d’empires éphémères, lionne solitaire éprise de liberté. Pour moi, ceux de ma génération et les autres, une figure fondatrice, un mentor, en quelque sorte. La fin du cours approche. L’épilogue tombe comme un couperet : l’art est affaire de rigueur et de responsabilité. Il n’y a pas d’art sans engagement (de corps et d’esprit) total. Il n’y a pas de demi-mesure. Le ton est donné : on est vraiment pas là pour déconner, on travaillera Feydeau.
Dire une partition
À quoi ressemble donc un cours de Martine Wijckaert, concrètement ? On lit d’abord minutieusement le texte à la table, s’arrêtant sur chaque mot, sur chaque virgule. On défriche, on déchiffre. Ici, le texte est considéré comme une véritable partition musicale. Pour pouvoir le donner, il faut l’avoir exploré, expérimenté, puis domestiqué parfaitement. Dans le cas présent, les élèves metteurs en scène s’attribueront des scènes à superviser et reprendront le flambeau de la direction d’acteur sous l’œil de Martine. Les acteurs sont ici assimilés à des techniciens instrumentalistes. On peut d’ailleurs davantage parler d’interprètes que d’acteurs. Les scènes seront réparties, découpées, séquencées. Pendant toute la durée du cours, les élèves travailleront humblement sur une toute petite partition jusqu’à la maitriser parfaitement et à être véritablement capable de la lire.
L’objectif du cours : que les jeunes apprentis soient capables d’exécuter ensemble (devant un public ou non) le compte rendu d’un espace textuel, d’une partition, chacun lisant-interprétant parfaitement sa partie, chacun étant la partie d’un tout. À ce titre, on ne représente rien : ni espace, ni costume. On est au lutrin. Les interprètes disent toutes les didascalies. Le cadre commun de travail est donc purement technique (il est fait très peu mention de dramaturgie par exemple). Plus le cadre technique est drastique, dit Martine, plus on pénètre une poétique. La maîtrise de la partition est une première étape. Il faut ensuite être capable de jouer, c’est à dire de recréer, d’inventer, d’être, avec candeur, avec naïveté, dans l’instantanéité du présent, au pied de la situation.
Lorsque vous assistez à un cours ouvert de Martine Wijckaert, vous assistez à une lecture sauvage : ici il ne serait être question d’un quatrième mur , les élèves vont et viennent sur le plateau, se plaçant face à face ou côte à côte derrière des lutrins, racontant, vociférant, braillant, imitant, chuchotant, déclamant, marmonnant, murmurant, induisant, sous-entendant, fu stigeant, psalmodiant, maugréant, bredouillant, marmottant, beuglant, commentant, parodiant. Le tout main dans la main avec le spectateur, en représentation constante. Les acteurs sont convoqués sur le plateau pour Dire. Les corps, les imaginaires sont mis en branle en tant que corps, en tant qu’imaginaires parlants. Toutes les tensions vont convergeant vers la bouche. C’est ainsi qu’un théâtre imaginaire commun entre acteurs et spectateurs naît : le texte théâtral se déploie, non sous nos yeux, mais dans nos têtes.
Placer les jeunes acteurs au centre d’une archéologie textuelle : l’exemple de MAIS N’TE PROMÈNE DONC PAS TOUTE NUE ! de Feydeau.