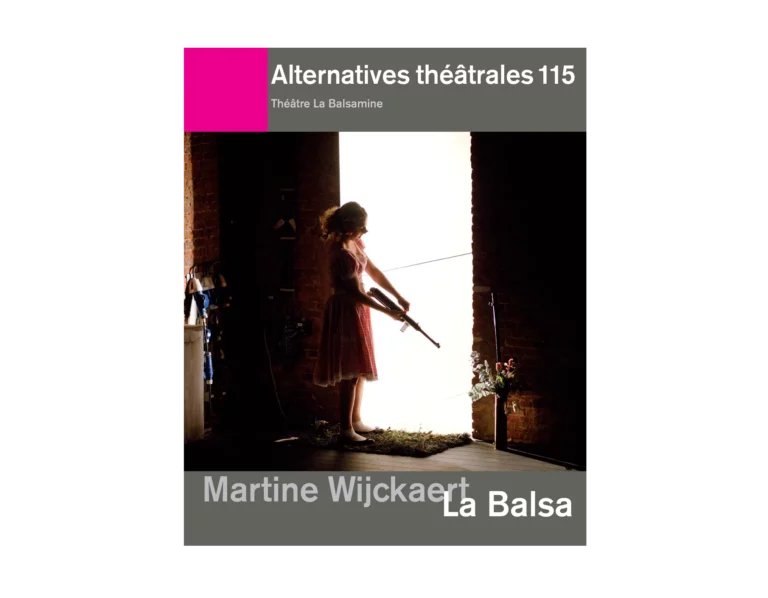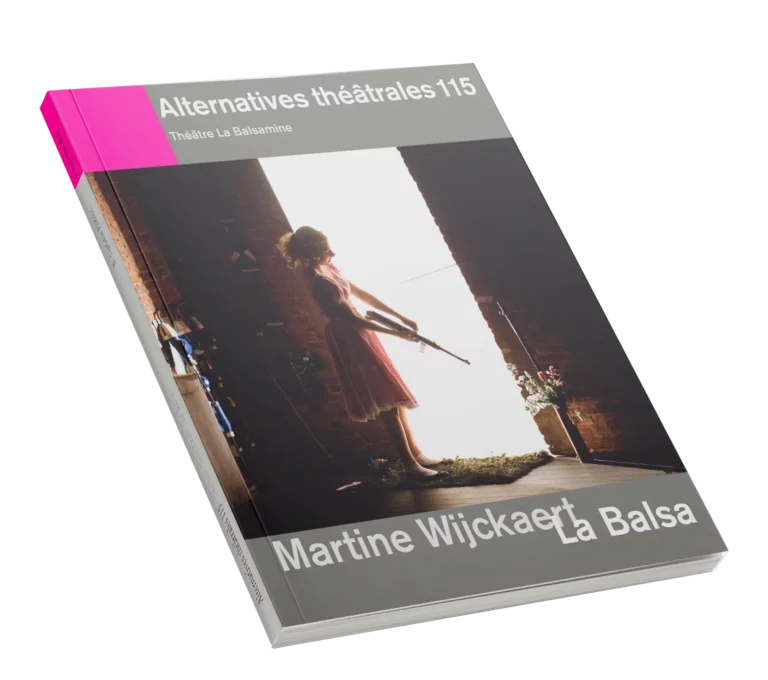BERNARD DEBROUX : Comment avez-vous été amené à prendre en charge la réalisation de cette partie de la Caserne Dailly qui est devenue le Théâtre de la Balsamine ?
Francis Metzger : Ce projet est un projet qui date, je ne parle pas de l’activité d’architecte, mais bien avant ça, dix-quinze ans plus tôt, j’avais des amis dans le domaine du théâtre et je les suivais dans leur parcours théâtral. À de nombreuses reprises, je me suis retrouvé à assister aux spectacles de la Balsamine avec un certain plaisir, à aller voir ce qui se faisait. Un jour, la commune de Schaerbeek a organisé un concours d’architectes pour repenser le Théâtre de la Balsamine dans une réappropriation des casernes, mais surtout avec une démolition-reconstruction d’une partie des casernes. Ils avaient élaboré un programme assez défini, assez clair, des ambitions, des enjeux, des besoins et il nous appartenait de proposer un projet. Notre métier, c’est le projet, c’est d’anticiper une situation qui sera et donc de faire une nouvelle proposition pour ce théâtre qui existait, pour un nouveau lieu. Une dizaine d’architectes a concouru. Il y a eu une épreuve dessin évidemment, et puis une épreuve orale. L’ensemble des architectes se sont succédés toutes les heures pour présenter leurs projets. Nous avions dessiné un projet qui, au niveau de l’esprit, est très semblable à ce qui a été construit, mais était peut-être un peu plus poétique et peut-être un peu moins juste au niveau de son fonctionnement.
Martine Wijckaert avait déjà utilisé cette salle de spectacle, bien connue, une salle de spectacle en fer à cheval…
B. D.: Qui est un ancien amphithéâtre de l’école militaire…
Fr. M.: Oui, et nous avions imaginé un projet où on rentrait dans l’amphithéâtre, dans cet amphithéâtre qu’on connaissait bien, qui devenait en fait le lieu de vie, qui devenait un lieu de réception, de rencontre. On passait à travers la scène, à travers le décor et on retrouvait une autre salle qui était une copie conforme mais plus grande du premier théâtre et qui là, était performante, technique. Un peu comme dans ALICE AU PAYS DES MERVEILLES, on passe à travers le décor et on trouve ce nouveau lieu qui est à l’image de l’ancien sans être tout à fait l’ancien. C’est grâce à cette idée, ce concept que nous avons gagné le concours. Lors de la première réunion avec Martine Wijckaert que je ne connaissais pas, que je n’avais jamais rencontrée, Martine nous a dit : « Nous avons beaucoup aimé votre projet, l’esprit de votre projet ; mais je ne veux pas qu’on touche à ma salle. Dans ma salle de spectacle, j’ai tout vécu et je veux qu’elle reste là où elle est. » Nous avons alors repensé le projet en gardant son esprit initial et en le modifiant un tout petit peu pour devenir ce qu’il est aujourd’hui.
B. D.: Quelles ont été vos sources d’inspiration, les fils conducteurs qui vous ont guidés ? Vous êtes-vous inspirés d’autres travaux ? Aviez-vous déjà réalisé des salles de spectacle auparavant ?
Fr. M.: Je n’avais fait aucune salle de spectacle, et c’est bien ma chance. Je dis c’est bien ma chance parce qu’aujourd’hui, pour obtenir un projet, il faut avoir fait un projet. Vous voulez faire des piscines, la meilleure solution, c’est d’être spécialiste en piscines. Si vous voulez faire un hôtel, il doit y avoir des hôtels à montrer. Je trouve que c’est une très mauvaise idée de dire que pour obtenir un projet au niveau des bâtiments, il faut déjà les avoir faits parce trop souvent, on croit que l’on connaît. Or notre chance, c’était de n’avoir jamais fait de théâtre et d’être à l’écoute du maître d’ouvrage, de l’utilisateur final qui, lui, sait très bien ce dont il a besoin et pourquoi. Pendant tout un temps, nous avons fait une espèce d’écolage pour essayer de savoir ce qu’était un théâtre, ce qu’était la Balsamine et ce qu’étaient les besoins. Il y a eu tout un travail qu’on a fait ensemble. Nous avons été voir des théâtres, parfois des théâtres qui fonctionnaient mal et où les metteurs en scène se plaignaient d’avoir travaillé avec des architectes qui croyaient savoir ce dont ils avaient besoin et qui sont arrivés avec un très mauvais produit. Nous sommes allés voir aussi de l’architecture contemporaine pour voir quelle était la réaction des acteurs de la Balsamine, Martine Wijckaert, Michel Van Slype, Christian Machiels…
Nous sommes allés nous balader en Hollande par exemple, voir des universités très contemporaines réalisées avec des matières très insolites, de l’acier, du bois, des plastiques, des matières inhabituelles pour le commun des mortels. J’étais curieux de voir comment ils réagissaient face à cette espèce de nouveauté. Nous avons pu ainsi cerner d’avantage ce qui était dans leurs envies, dans leurs préoccupations, dans leurs ambitions, ce qu’on pouvait utiliser de tout ça. Nous avons donc construit le costume réellement sur mesure, à partir de tout ce travail préparatoire qui était long. Autant l’esquisse a été très rapide, autant au niveau des matières et des textures ce fut beaucoup plus long. Le débat s’est cristallisé autour du « décor ». On voulait surtout un théâtre où le décor était sur scène. Le propre d’un théâtre, c’est effectivement l’artifice et l’artifice est sur scène, il n’est pas dans les murs. On voulait quelque chose de relativement simple, efficace, une belle machine, mais qui soit agréable, qui soit conviviale, mais où il n’y a pas de faux plafond, pas de tentures grandiloquentes, où il y a des choses basiques, évidentes. Et donc le gros du travail a été de travailler sur l’identité, de trouver à ce théâtre une nouvelle identité. Ils avaient trouvé une identité théâtrale, sur scène, il se passait des choses qui font que les gens connaissent ce théâtre et lui reconnaissent une identité, notamment son côté novateur. Ce qu’il fallait trouver, c’était une identité formelle. On se trouve dans un quartier qui va renaître ; une partie des casernes ont déjà été démolies, il reste ce bout de caserne qu’on va utiliser. Comment va-t-on écrire ? Un peu comme quand on écrit un roman, on a un style. On peut écrire de l’architecture de la même façon qu’on écrit un roman, c’est-à-dire qu’on va travailler avec de la matière plutôt qu’avec de l’encre. Mais on lit aussi bien une ville : si vous visitez une ville ou une rue, vous arrivez à avoir une lecture très évidente de la façon dont la ville va vivre, simplement en voyant comment les maisons sont juxtaposées. Ici, à Bruxelles, ce sont des maisons vieilles, on sent tout de suite le côté indépendant, bourgeois. Ou à Paris, les immeubles collectifs avec les pauvres tout au-dessus et les riches un peu plus bas. On arrive donc à très vite lire au travers de la matière, au travers de l’exercice du construit. Il nous appartenait de trouver une identité : ce n’est pas du logement, un théâtre c’est comme un cinéma, c’est un bâtiment public, donc c’est un repère urbain, et un théâtre, c’est un repère important. Il fallait donc que ce théâtre joue son rôle de repère urbain d’une part, d’autre part, que l’on se dise que ce qui se passe là, c’est contemporain. Il s’agit donc d’une écriture d’aujourd’hui avec des matières d’aujourd’hui, sans décor, et qui dise qu’à cet endroit-là, il se passe quelque chose d’exceptionnel. Et ce qui est exceptionnel là, c’est le théâtre.
B. D.: Et pourtant, vous avez eu l’occasion de dire que les habitants au départ n’ont pas tout de suite eu la perception de ce que c’était…
Fr. M.: Oui, évidemment, quand on n’est pas féru d’architecture et d’architecture contemporaine qui plus est, cet objet a fait l’objet d’un ovni dans un quartier délabré, un quartier en construction. Le jour de l’inauguration, il y avait les discours convenus des différents ministres, le discours de l’architecte qui explique un peu ce qu’il avait tenté de faire. Et puis il y avait la Balsamine qui avait prévu une sorte de petite intervention urbaine. Ils avaient filmé les habitants du coin en les interrogeant sur ce qu’était ce nouvel élément-là, construit dans le quartier. On a eu alors les réflexions les plus drôles du style : « ça, monsieur, ça doit être un sauna ». « Une grande caisse en bois comme ça, ce doit être un un cageot à légumes ». Personne n’était indifférent à ce lieu, tout le monde l’avait vu. C’est important pour un bâtiment public ! Cela veut dire qu’il a une identité, qu’il existe, qu’il est visible. Ensuite, les gens doivent faire la démarche d’aller voir ce qui se passe dedans. Il faut susciter aussi la curiosité.
Quand on y rentre, on ne rentre pas directement. Je ne voulais pas une porte comme une porte de bistrot qu’il suffit de pousse pour entrer. Nous avons imaginé cette grande porte, dessinée par un de mes collaborateurs qui est artiste-peintre au départ, Daniel Deltour. Ce que je voulais c’est que ce soit une porte mobile qui fasse la séparation entre la partie neuve et la partie ancienne et ensuite qu’on passe à travers une petite cour. Il y a un travail sur la profondeur de champ, comme on peut le faire au cinéma avec un avant-plan, un arrière plan. Ces quelques instants, c’est le moment où on passe d’un univers à un autre…
B. D.: Pour se retrouver dans le foyer du théâtre…