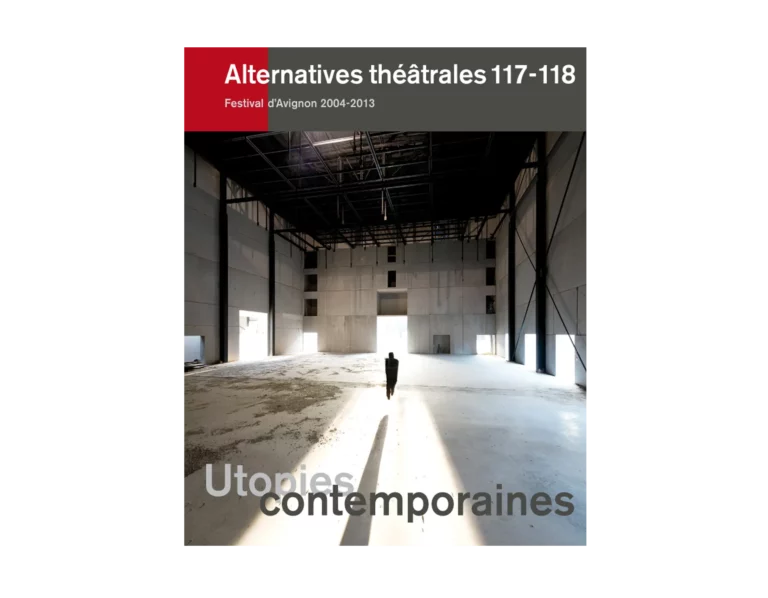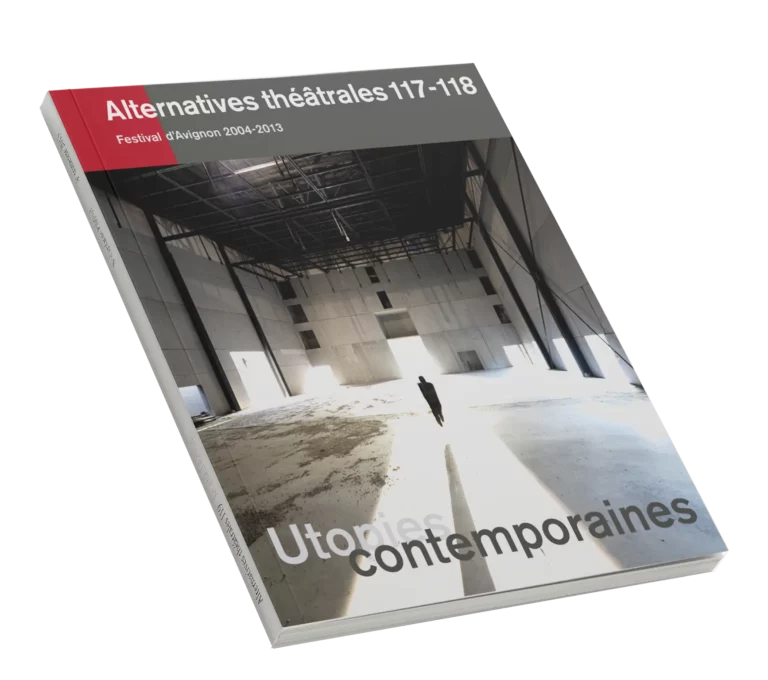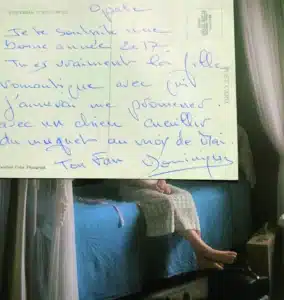LE DANSEUR et chorégraphe originaire de Yougoslavie, directeur du Centre Chorégraphique d’Orléans depuis 1995, fut l’artiste associé du Festival d’Avignon en 2006. Pour les spectateurs qui eurent la chance de vivre cette édition, ce fut l’occasion de s’immerger dans l’univers d’un artiste irrigué par de multiples sources. Après avoir étudié les Beaux-arts, l’histoire de l’art et de la musique à Budapest, s’être initié au jeu d’acteur, Josef Nadj est arrivé à Paris en 1980 pour se former au mime. Il y a découvert, entre autres, la danse contemporaine en pleine expansion. C’est à l’intérieur de sa compagnie, fondée en 1986, qu’il put donner libre cours à l’élaboration d’un langage qui se situe à mi-chemin entre la danse et le théâtre, en empruntant à de multiples cadres de référence. La littérature (Borges, Beckett, Kafka, Schulz…) aussi bien que la musique et les arts plastiques inspirent cet insatiable créateur d’images. Avec PASO DOBLE, inoubliable duo d’argile créé avec Miquel Barceló, dans l’Église des Célestins, et ASOBU, présenté dans la Cour d’honneur, mais également plusieurs expositions et une importante présence musicale, Josef Nadj offrit aux spectateurs un large spectre de son univers scénique. Et révéla tout un pan de son imaginaire fortement marqué par la Voïvodine, sa région d’origine.
Sylvie Martin-Lahmani : En 2006, vous aviez déjà participé à de nombreuses éditions du festival d’Avignon et présenté huit pièces de votre répertoire entre 1992
et 20051. Vous étiez déjà un familier de cet événement international, un habitué, voire un ami… Pourquoi avoir accepté d’être artiste associé ?
Josef Nadj : Quand on vous fait ce genre de proposition, vous n’y réfléchissez pas beaucoup.
Quand Vincent Baudriller m’a appelé, j’étais quelque part en tournée. C’est par téléphone qu’il m’a demandé si cela m’intéressait. J’ai dit oui sans réfléchir. C’était l’occasion de vivre une aventure qui m’était encore inconnue, la possibilité de plonger dans l’image et la fabrique d’un festival. Je n’avais encore jamais pensé en ces termes. Participer à la réflexion d’un tel événement, c’était un véritable challenge pour moi.
S. M.-L. : Lors de vos premiers échanges avec Hortense Archambault et Vincent Baudriller, deux images sont, paraît-il, revenues avec persistance : « la terre comme évocation des racines et de l’identité, le fleuve comme lieu du mouvement, du possible déplacement vers l’autre ». D’où vient cette orientation poétique ?