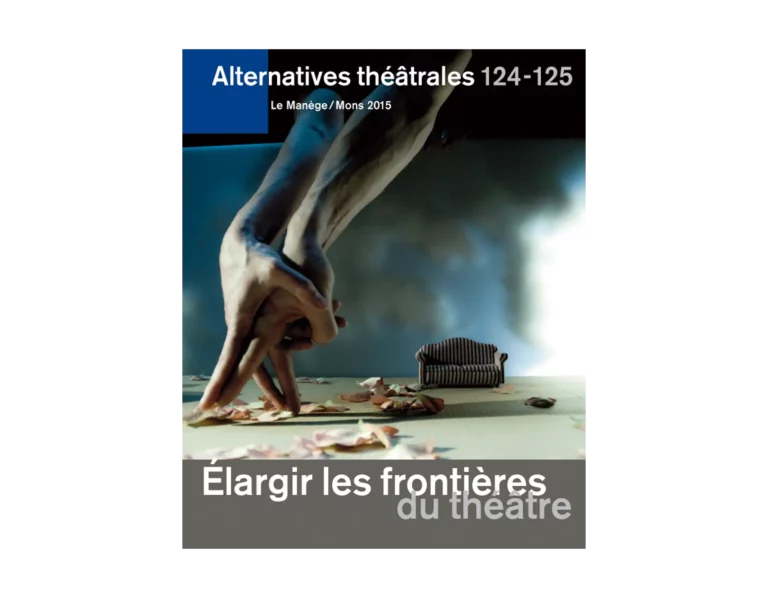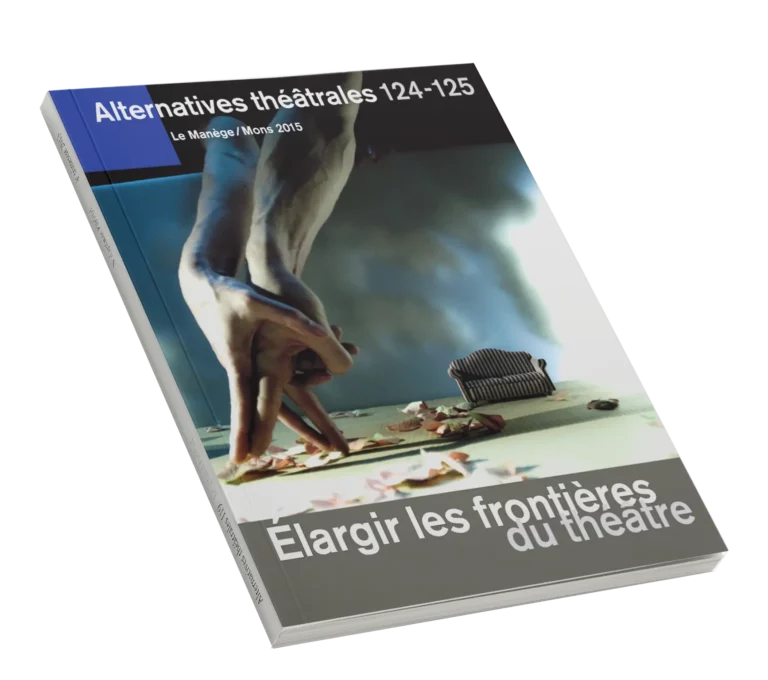YANNIC MANCEL : Dès 2010 vous aviez conçu puis réalisé un premier projet intitulé déjà GHOST ROAD (route fantôme) où était abordée la question de la désaffection puis de la désertification démographique de ces villages de l’arrière-pays californien qui autrefois jalonnaient les étapes de la fameuse Route 66, celle qui reliait Chicago à Los Angeles.
Fabrice Murgia : Au départ j’avais travaillé sur la pièce de Falk Richter DIEU EST UN DJ. C’était ma deuxième mise en scène après LE CHAGRIN DES OGRES. Pour la première fois j’osais me confronter à un texte écrit, un texte d’auteur. Falk Richter a été très accessible. Il m’a raconté comment lui était venue l’idée du texte, en traversant la Vallée de la Mort, je le précise pour l’anecdote, dans une voiture qui lui avait été prêtée par Peter Sellars… Il s’était arrêté à plusieurs reprises dans ces « Ghost Towns » du Sud-Ouest des États-Unis et avait
écrit sa pièce dans les préfabriqués où il avait fait halte.
J’ai eu envie d’aller visiter cet environnement et de m’’asseoir dans les mêmes endroits que lui pour m’imprégner de l’atmosphère et de ce qu’il en avait ressenti. J’en ai profité pour refaire en entier le parcours de la Route 66 qui est elle-même devenue une route fantôme, celle de la faillite du rêve américain, depuis qu’en parallèle une autoroute a été construite, plus performante, mais qui écrase les paysages au lieu de les contempler.
Je n’ai jamais voulu faire un spectacle sur l’impérialisme et les conséquences cruelles de la compétition ou de la course à la modernisation. J’ai seulement voulu montrer les gens qui avaient fait (ou subi) Le choix de rester là. Ç’aurait pu être aussi bien un reportage photo ou un film documentaire. Au cours de ce périple, je suis tombé sur une ville encore plus étrange que les autres : Darwin City (la bien nommée!) que Falk Richter appelle dans son texte « Darwin City of Fallen Angels », une ville minière — déjà ! — où l’on testait des explosifs.
J’ai voulu y retourner avec Viviane De Muynck, parce qu’il était important pour moi, dans le processus documentaire, de me confronter à une personne plus âgée, dont l’âge et la relation à l’échéance de la mort étaient plus proches de ce que doivent ressentir les survivants vieillissants de cette Vallée. Il fallait sans tabou se confronter à cette thématique : regarder en arrière, mais aussi en face, vers la mort, avec sérénité, comme le suggèrent et le soulignent ces paysages désolés et leurs derniers habitants. Le texte est né de mes conversations avec Viviane et avec ces habitants.
C’est donc un road movie, un parcours initiatique né de la rencontre par étapes, par épreuves successives avec divers protagonistes. GHOST ROAD était aussi un projet que je voulais en rupture avec le plus connu et le plus vu de mes spectacles, LE CHAGRIN DES OGRES, qui était un spectacle jeune, turbulent, provocateur mais qui, du fait de sa très longue tournée, ne correspondait plus à ce que je voulais explorer. Lorsque Jan Lauwers a reçu son Lion d’or à Venise, il a déclaré : « le théâtre est un art qui se pratique avec les bonnes personnes, au bon endroit, mais peut-être pas au bon moment. C’est ainsi qu’il préserve sa vocation critique et le rôle d’opposition poétique qui doit être le sien. »
Y. M.: Comment par la suite s’est pensé ce rebond sur un deuxième volet, voire ensuite un troisième ? Aviez-vous au départ l’idée d’une trilogie?Et pour ce qui concerne ce deuxième rendez-vous à venir, que vous annoncez cette fois sur l’évocation d’un désert chilien, est-ce que le fait que l’un de vos commanditaires principaux, en l’occurrence Daniel Cordova, soit d’origine chilienne, a influencé votre choix ?
Fabrice Murgia : Le projet d’une trilogie était encore abstrait, concrètement je n’avais que le projet du premier volet, l’épisode états-unien. Mais j’ai découvert le cas de Chacabuco avant de partir pour les États-Unis.
En écrivant le « un », je savais déjà que le « deux » serait consacré au Chili. Je ne l’ai fait ni à la demande de Daniel Cordova, encore moins pour complaire au producteur qui s’était déjà investi sur le premier voler. Il se trouve que je suis Liégeois, issu de parents immigrés comme nous l’avons déjà évoqué ensemble (Alternatives théâtrales, hors-série Villes en scène, 2013) et que rien de ce qui concerne l’exil et les migrations ne m’est étranger.
Il y a à Liège comme à Bruxelles de nombreux exilés chiliens qui ont fui la dictature de Pinochet. Pour eux et avec eux j’ai participé à de nombreuses soirées poétiques, autour de l’œuvre de Neruda par exemple. Je souhaitais que les questions économique et politique soient présentes tout au long de cette trilogie : elles y sont déjà avec la crise des « subprimes », l’une des causes de la désertification immobilière de la Vallée de la Mort.
Le trait d’union entre les deux volets, c’est que le putsch qui a destitué le Président Allende et porté le général Pinochet au pouvoir est un coup d’état nord-américain, ourdi par la CIA pour remettre la main sur les mines de cuivre et les nombreuses autres ressources minérales du pays.
Il se trouve que Le Festival de Santiago avait invité dans sa programmation LE CHAGRIN DES OGRES. Ma première visite au Chili fut donc pour accompagner le spectacle. J’avais entendu parlé de Chacabuco, j’ai donc voulu me rendre sur place. J’ai reçu là un choc insensé.
GHOST ROAD est l’histoire de personnes qui ressemblent à des lieux, à des sites. J’étais confronté là à une mutation sociale, microcosmique, d’une singularité exceptionnellement étrange. D’abord il y avait eu une mine de nitrate et donc un développement industriel érigé en plein désert, celui d’Atacama. On y avait établi un régime de commerce insulaire qui éditait même sa propre monnaie. On y payait avec des « fichas », des jetons. Et on achetait son pain dans la boulangerie qui appartenait au patron:une façon astucieuse de lui faire remonter une partie de l’argent des salaires. Ce monde était très dur : la mortalité accidentelle au travail y était presque aussi fréquente et banalisée qu’en temps de guerre. Vinrent ensuite la crise — crise économique, crise d’exploitation — et l’exode. Puis au lendemain du coup d’état, le site fut transformé en immense camp de concentration pour Les opposants à la dictature de Pinochet, les anciens militants nostalgiques d’Allende, les intellectuels, les artistes qu’il fallait mettre hors d’état de s’exprimer. Ce camp qui, tout en pratiquant régulièrement la répression et les exécutions sommaires, n’avait aucun objectif d’extermination, était plutôt conçu comme un laboratoire d’étude des comportements et un centre de rééducation. S’organisa alors une micro-société pleine de contradictions, qui ira même jusqu’à créer un théâtre expérimental, un atelier de sculpture, un groupe de littérature.
Pendant dix ans va régner là la terreur. Aujourd’hui encore, on croise des femmes qui creusent la terre avec une petite pelle à la recherche de quelques ossements ayant pu appartenir à un père, un frère ou un mari. L’enjeu pour elles aujourd’hui est celui de la réparation — de la résilience ? — face à un deuil qui n’a pas pu s’accomplir. Moi-même enfant d’émigrés comprends bien comment une blessure, en l’occurrence pour moi celle de l’exil, peut rester béante et se transmettre de génération en génération sans jamais se refermer.

Chacabuco est donc devenue cette ville fantôme parfois visitée par des habitants de Santiago dont la vie quotidienne demeure hantée par la présence à quelques mètres de chez eux d’un ancien tortionnaire impuni, parfois leur propre tortionnaire, avec lesquels impuissants ils sont obligés de cohabiter.
Y. M.: Qu’y aura-t-il donc de commun entre les trois épisodes de GHOST ROAD ?
Fabrice Murgia : L’idée générique de GHOST ROAD, c’est qu’on arrive dans un désert. On a un peu préparé, on s’est un peu documenté, mais pas trop, sans feuille de route trop précise, pour pouvoir se laisser surprendre. On prend le temps de parler avec les gens, de les interviewer, sans aucun planning de rendez-vous qui nous pousserait à passer trop tôt à quelqu’un d’autre. On se laisse entre deux « carrefours », entre deux « points de rendez-vous », une grande marge d’improvisation, un peu comme en jazz.
Y. M.: Pourriez-vous nous dire un mot du troisième épisode à venir ? Sa thématique ? Le choix du site ?
Fabrice Murgia : Peut-être Fukushima.. Mais il faudra trouver des partenaires japonais. Cela n’aurait aucun sens de ne pas jouer ce spectacle au Japon. On va y jouer prochainement NOTRE PEUR DE N’ÊTRE. Ce sera l’occasion d’un premier contact et peut-être aussi d’une première rencontre avec des acteurs japonais.
Y. M.: Et sur un plan dramaturgique et esthétique, quel serait le dénominateur commun entre les choix de Darwin City, Chacabuco et Fukushima ?
Fabrice Murgia : La contemplation d’un paysage dévasté pour comprendre comment le reconstruire, et pour cela il faut se retourner, regarder en arrière, ce que fait Viviane dans le premier volet.
Y. M.: Cela rejoint le propos de Gramsci que Dario Fo aimait à citer : « Pour savoir où l’on va, il faut savoir d’où l’on vient.….».
Fabrice Murgia : Oui, et comme dans toute bonne trilogie, c’est la loi du genre, le troisième volet devra assembler les trois éléments, tenter de résoudre une problématique.
Y. M.: Dans le second projet, on retrouvera Viviane De Muynck, peut-être aussi dans le troisième. Pourquoi un tel attachement àcette actrice?Que dit-elle de si particulier dans Le propos général que vous avez choisi ? Quel est son rôle en termes d’image, d’icone ?
Fabrice Murgia : Le choix de Viviane est très lié au projet littéraire de la première pièce, à son écriture. Je savais qu’il fallait partir de Kerouac et de la Beat Generation : j’ai même glissé un poème de Ginsberg à La fin de la représentation. De même que la poésie chilienne sera très présente dans le second épisode. Pour moi, Viviane incarne l’esprit de la Beat Generation. Pour représenter un monde, et surtout un monde disparu, il faut un acteur ou une actrice qui soit un monument, un monument scénique. Viviane est ce monument. Pour raconter une telle histoire, je n’aurais pas pu faire confiance à un jeune acteur. Question de mémoire et de vécu, peut-être. Viviane, seule sur une chaise, dans une boîte noire, face public, inspire cette confiance.
La relation au spectateur pour Le volet chilien, tel qu’aujourd’hui je l’imagine, sera plus immersive. Je vois Viviane au milieu du public sur une aire de sable aride qui les relie sur un même plan. Je souhaite que ce deuxième épisode évoque la proximité, incite au toucher. Il y a, je crois, un thème que je ne cesse d’explorer et de décliner dans tous mes spectacles : c’est la solitude, sous toutes ses formes et dans toutes ses différentes variations.
Y. M.: Comment écrivez-vous ?Arrivez-vous au plateau avec une brochure établie, un texte déjà écrit ? Ou bien seriez-vous plutôt ce qu’on appelle aujourd’hui un « écrivain de plateau », qui écrirait un peu tou les jours en fonction de ce que le travail de répétition et d’improvisation a révélé dans la journée ?