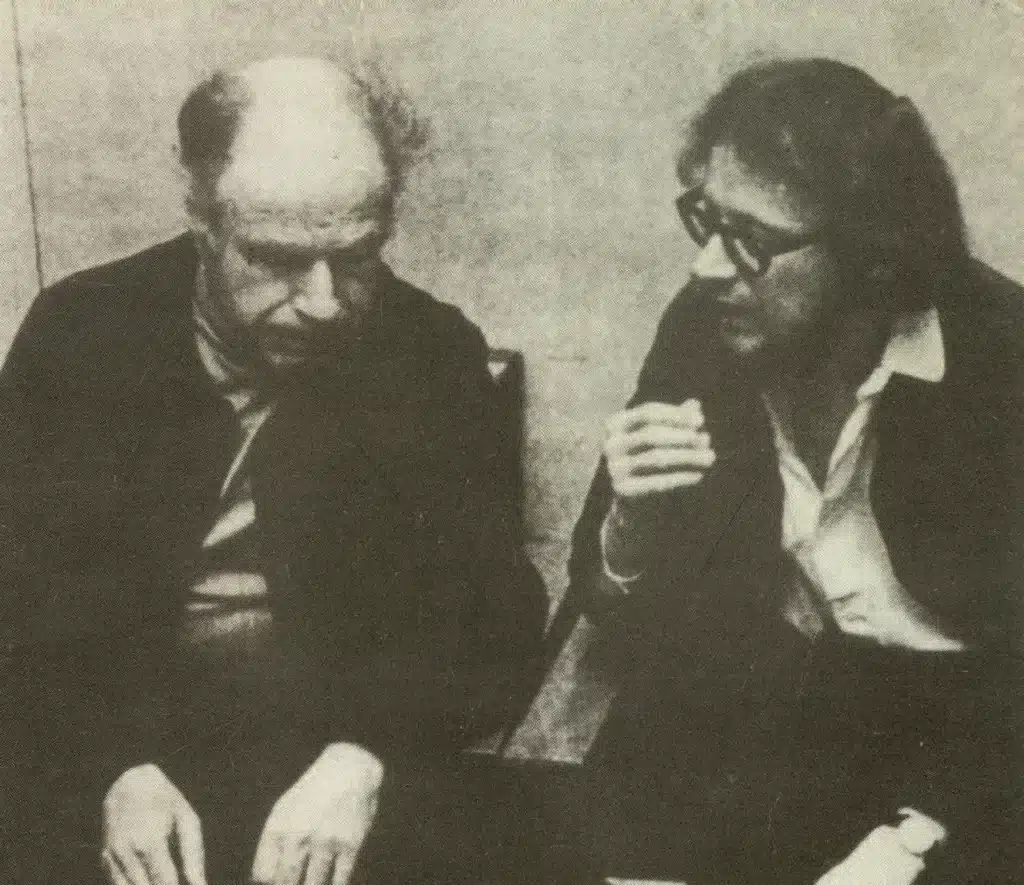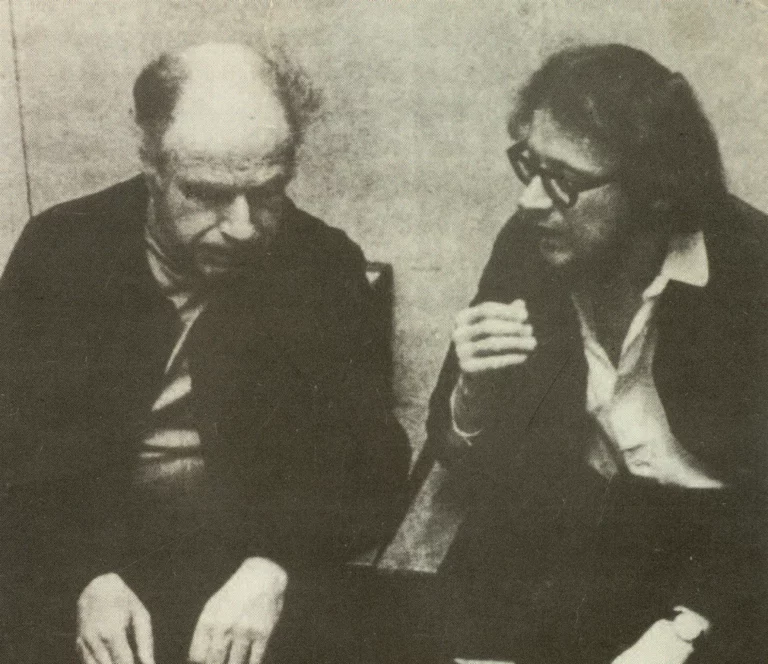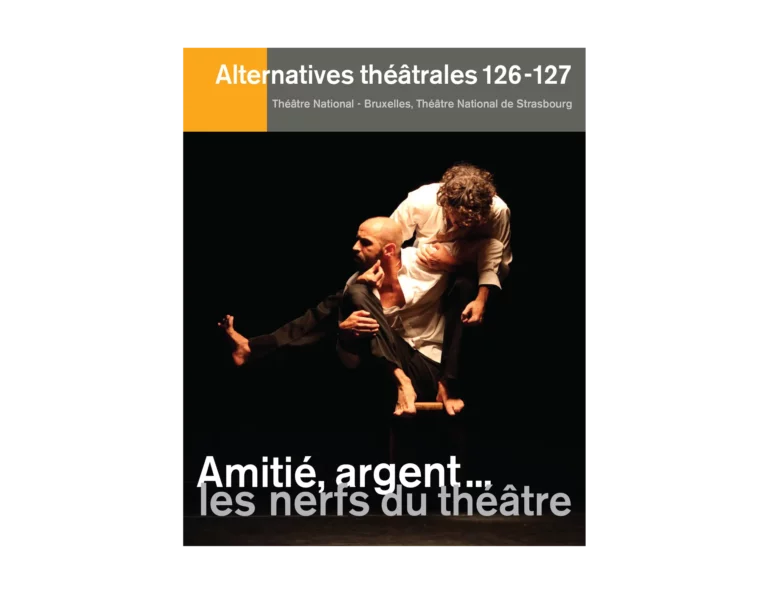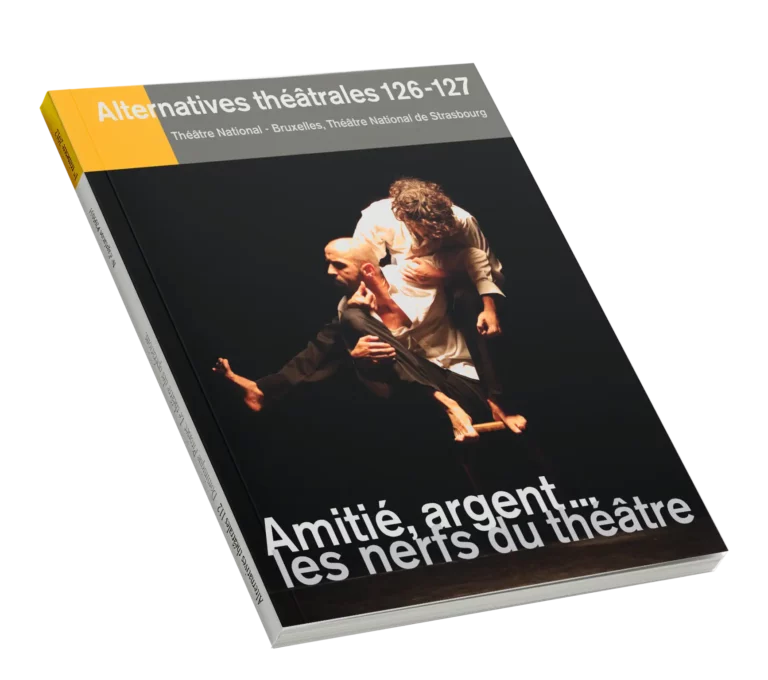Les qualités essentielles d’un homme se reflètent en ses amis, et par eux doivent un jour être perpétuées.
Peter Brook
DES AMITIÉS il y en a eu dans l’histoire de l’art. Elles se nouent sur la base d’une communauté de visées esthétiques, morales ou politiques. Et les amis – je ne parle pas ici d’une relation collective de groupe, mais d’une relation binaire – bénéficient d’un statut égal fondé sur l’équivalence et le partage réciproque. Ce sont des amitiés qui se développent dans le contexte des sociétés non totalitaires où les menaces qui pèsent sur les artistes concernent peut-être leur statut économique, comme ce fut le cas pour Zola et Cézanne, mais non pas leur survie artistique. Un autre lien se noue parfois là où les contraintes, les dangers et les sanctions visent certains créateurs qui se trouvent démunis face à la machine politique de leur temps. Cela n’affecte pas la base initiale de l’amitié qui se justifie par des données communes entre les partenaires, mais une dimension autre s’ajoute, la dimension du péril et de l’entraide nécessaire. Il serait intéressant de répertorier ces amitiés développées sous la dictature car elles sont nombreuses. Amitiés durables ou amitiés passagères qui impliquent toutes un risque et se confirment par le secours apporté à l’autre. Rostropovitch n’a‑t-il pas sauvé Soljenitsyne ?
Il ne s’agit pas de procéder ici à un long inventaire, mais on peut rappeler une amitié paradigmatique dont le fonctionnement acquiert une dimension particulière pour le théâtre du xxe siècle. L’amitié entre Stanislavski et Meyerhold. Stanislavski, lui, reconnaît vite les qualités de jeune Meyerhold au point de le distribuer dans ce qui sera le spectacle socle du Théâtre d’Art : LA MoUETTE. Turbulent et insatisfait, on le sait, Meyerhold quitte son aîné pour s’éloigner et faire du théâtre loin de lui, en province où il explore les nouvelles dramaturgies, Ibsen, Maeterlinck. Cela n’empêchera pas Stanislavski de suivre son parcours, de l’ériger en partenaire en raison même de leurs divergences. ( Je me souviens d’Ibsen, au sommet de sa gloire, qui prenait en compte les propositions du jeune Strindberg, et pour ne pas l’oublier avait placé son portrait derrière le bureau de travail. Il voulait écrire, avouait-il, en ayant « Strindberg dans son dos »). Meyerhold occupe un statut similaire auprès de Stanislavski qui l’invite à ouvrir un Studio au Théâtre d’Art afin d’alimenter et de renouveler l’esthétique du célèbre ensemble. C’est le studio de 1905 qui agitera les esprits, suscitera l’agacement de Dantchenko et restera comme une tentative avortée. Peu importe son échec apparent, c’est l’initiative qui compte et elle a à voir avec le besoin de dialogue avec Meyerhold qu’a manifesté Stanislavski. Et, plus tard, Grotowski, en faisant référence justement à cette relation exemplaire, dira que le meilleur disciple ce n’est pas le disciple obéissant mais le disciple révolté, le disciple qui, comme Meyerhold, s’attaque à l’esthétique du maître. Plus tard, dans les années 30, quand, à l’incitation de Staline, s’instaure une terreur intellectuelle qui menace l’ensemble des artistes, même les plus dévoués comme Meyerhold, qui se trouvent désormais en proie aux attaques violentes et aux risques d’anéantissement physique. Alors, Stanislavski invite son ami à trouver refuge dans l’îlot du studio marginal qu’il avait mis en place et lui propose de travailler sur un opéra, LA DAME DE PIQUE – est-ce un pressentiment de la mort ? – et de s’écarter ainsi du champ explosif du théâtre public. Par son aide il lui accorde une chance de survie. Comment oublier la belle image du spectacle d’Eugenio Barba où le vieux maître portait sur ses épaules le jeune ami désarmé ? Stanislavski une fois mort, les jours de Meyerhold seront comptés et il finira en Sibérie, assassiné. De cette fin s’est inspiré Kantor pour son dernier spectacle, AUJoURD’hUI C’EST MoN ANNIVERSAIRE. Voilà le sens de l’amitié pendant les temps de peste. Partager et aider pour que l’autre, l’ami en danger, puisse continuer à travailler, à vivre. C’est une amitié qui se constitue en résistance au danger. Ainsi à la confiance dans l’art partagé avec son ami s’ajoute l’impératif de l’aide à lui apporter, lui, l’artiste menacé.
« Toute comparaison est à moitié fausse », on l’a souvent dit. Convaincu par cette assertion, j’avance la comparaison entre l’amitié évoquée de Stanislavski et Meyerhold et l’amitié de Brook et Grotowski. Certes, les différences sont multiples : ils n’appartiennent pas à la même société, ils ont le même âge… mais les ressemblances, elles aussi, sont nombreuses. D’abord une, la première : Brook, comme Stanislavski, invite son collègue polonais à venir travailler en 1964 dans un atelier avec les acteurs de la célèbre Royal Shakespeare Company. L’assise initiale est liée au travail, au partage des préoccupations et des visées communes. Ensuite, d’autres motifs viendront les relier, motifs esthétiques ou motifs philosophiques, comme par exemple leur intérêt commun pour Jung et Gurdjieff. Ils se verront souvent, mais lorsque la situation s’aggrave en Pologne, la posture de Brook va se rapprocher de plus en plus de celle de Stanislavski et ses interventions prendront le même sens : aide apportée à l’ami en danger. La société polonaise placée en « état de siège » produit le contexte qui renvoie à l’autre, stalinien, bien que tout de même moins meurtrier. Mais, cette fois-ci, la même conversion est nécessaire : l’ami devient l’allié. Allié qui vient au secours, qui apporte sa caution et fait jouer sa notoriété, qui écrit, prend position, s’engage : amitié de combat, amitié de protection. Conclusion deux fois reprise pendant des temps de peste durant le siècle dernier.
À la différence de Stanislavski, Brook est souvent intervenu pour parler de Grotowski, pour dévoiler ce qui lui semblait être son unicité et son génie, pour dire sa différence – en particulier pour ce qui concerne le rapport au public – et surtout pour reconnaître leur vœu commun de dépassement du théâtre d’art…