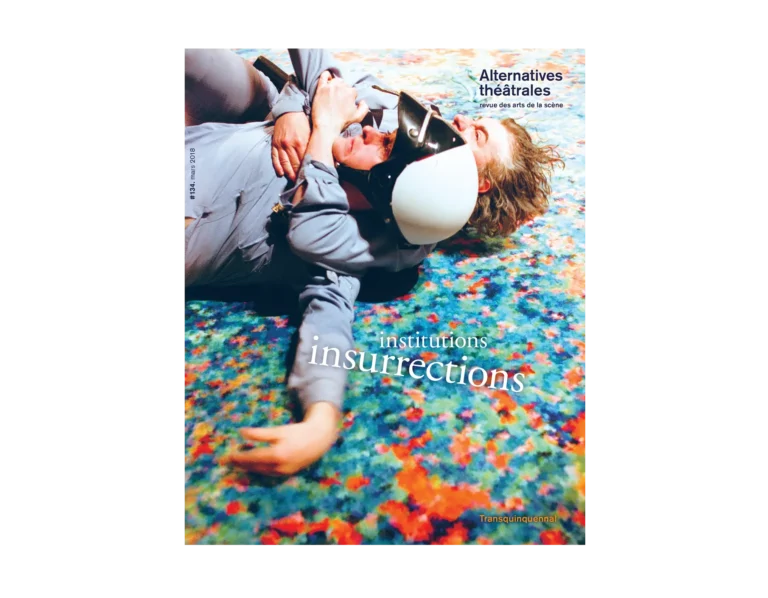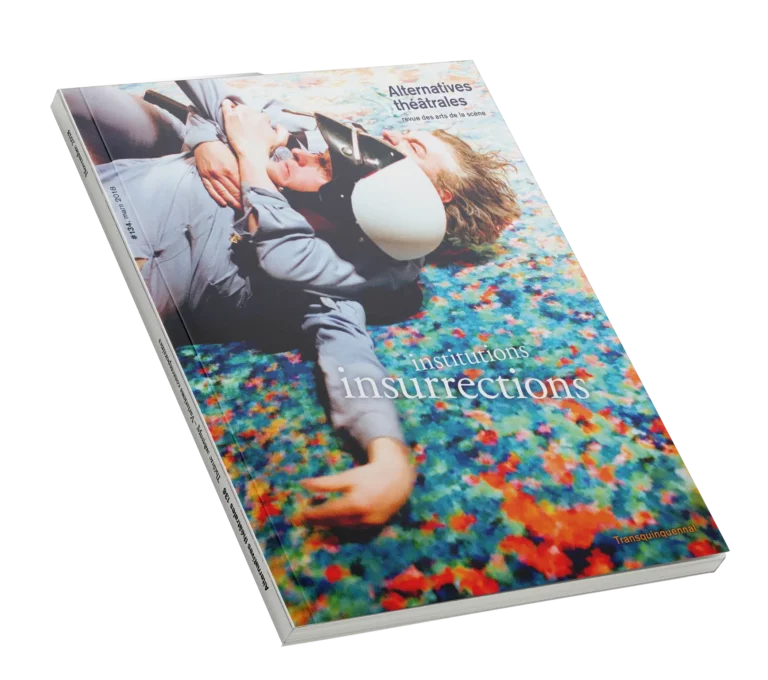Le 23 novembre dernier, la ministre de la Culture de la Fédération Wallonie Bruxelles Alda Greoli rendait ses décisions relatives au subventionnement des opérateurs reconnus dans le domaine des Arts de la Scène pour la période 2018 – 2022. Le 13 décembre, à l’initiative conjointe d’Alternatives théâtrales et de la filière « Arts du spectacle » de l’Université libre de Bruxelles, se tenait, dans les locaux de l’ULB, une table ronde rassemblant plusieurs représentants du secteur et les étudiants en master Arts du Spectacle Vivant à l’ULB.
Françoise Bloch directrice artistique de la compagnie Zoo Théâtre, metteuse en scène.
Michael Delaunoy directeur du Rideau de Bruxelles, président de la CONPEAS (Concertation permanente des employeurs des arts de la scène) et metteur en scène.
Rachel Goldenberg administratrice de la compagnie Dame de Pic, membre de la RAC, Rassemblement des Acteurs du secteur Chorégraphique.
Isabelle Jans coordinatrice d’Aires Libres, concertation des Arts de la rue, des Arts du cirque et des Arts forains.
Dominique Roodthooft directrice artistique de la compagnie Le Corridor, metteuse en scène.
Julien Sigard coordinateur de Habemus Papam, structure de développement, production et diffusion de projets artistiques.
Philippe Sireuil directeur du Théâtre Les Martyrs, metteur en scène.
J.-Philippe Van Aelbrouck directeur général du service général de la création artistique, Ministère de la Culture de la FWB.
J.-Michel Van den Eeyden directeur du théâtre de l’Ancre de Charleroi, metteur en scène.
Karel Vanhaesebrouck professeur en histoire et esthétique du spectacle vivant à l’ULB, où il dirige le Master en Arts du Spectacle vivant. Il enseigne également au RITCS et à l’ESACT.
Modération Laurence Van Goethem.
I. VAN GOETHEM Merci à toutes et tous pour votre présence. Notre première question sera la suivante : quels sont selon vous les critères qui ont été décisifs dans les récentes décisions
ministérielles en Fédération Wallonie-Bruxelles ? Comment comprendre la logique sous-jacente de la ministre de la Culture ?
M. DELAUNOY La question que tu poses montre que les choses ont été en quelque sorte faites à l’envers. On a donné les montants des subventions dans la presse (avant même que les opérateurs ne les reçoivent) sans discours introduisant ces décisions. Or, l’idée de l’alignement (mettre presque 300 opérateurs sur la ligne de départ en même temps), c’était de dire « on veut insuffler une politique sur une certaine durée » (avant ce n’était pas le cas puisqu’on négociait tous séparément à des moments différents). Si toutes les décisions budgétaires sont prises en même temps, un discours devrait expliciter et mettre en perspective ces décisions : « voilà la politique que je veux insuffler et c’est pourquoi mes décisions vont dans tel ou tel sens ». L’autre question absente est celle des missions. Nous avons reçu un montant et nous allons négocier ensuite, et avec l’administration, le cahier des charges. C’est surprenant, car le cahier des charges est l’élément clef d’un contrat-programme, ce qui lui donne sens. Il doit donc être discuté avec le politique (à l’administration d’appliquer ensuite ce qui a été décidé). Ici aussi, les choses semblent se faire à l’envers. Il en résulte pour chacun une difficulté à appréhender la politique qui sous-tend les décisions annoncées.
I. JANS Dans le secteur du cirque, des arts forains et des arts de la rue, nous n’avons pas encore reçu, à l’heure actuelle, le montant des aides pluriannuelles, or il s’agit d’un secteur très petit dont la plupart des opérateurs bénéficiaient de petites conventions. On suppose donc qu’il y aura des aides pluriannuelles qui vont tomber.
Dans notre secteur, nous n’avons pas reçu les arguments des instances d’avis justifiant les décisions prises. Ce secteur, qui était extrêmement sous-financé, reçoit globalement une augmentation des subventions. Pour le moment je constate une augmentation mais cela reste très peu en chiffres. C’est un secteur où le centre scénique principal est subventionné à 300 000 €.
J‑PH. VAN AELBROUCK Je remarque avec vous que le timing est très mauvais. Ceux qui me connaissent savent que je ne pratique pas la langue de bois, ainsi je peux en même temps défendre ma ministre et dire qu’un certain nombre de choses ne vont pas. Voici la manière dont nous avons travaillé, jusqu’à l’épuisement : le 17 janvier 2017, nous avons commencé à dépouiller les 415 dossiers qui ont été déposés (je rappelle qu’il n’y a pas que le théâtre dans le décret des Arts de la Scène).
Nous avons mis au point une méthodologie tout à fait transversale qui a permis que l’analyse des dossiers par l’administration soit la même dans tous les secteurs. Nous avons également mis au point une méthodologie transversale pour les instances d’avis : une grille d’analyse qui comporte plusieurs critères. Nous avons aussi rappelé que nous étions dans une phase d’estimation d’un projet d’avenir, car je sais que dans beaucoup de dossiers sont apparus des on-dit, des rumeurs sur le passé d’un opérateur etc. Autant que possible, nous y avons coupé court. L’ensemble des critères prévus par le décret ont été examinés et argumentés un à un, afin de déterminer si l’opérateur y répondait ou non. Pour l’avenir, la position de l’administration est d’affirmer le dossier déposé comme outil de référence. La négociation viendra après. Nous allons faire des « copiés-collés » dans les cases prévues du cahier de charges. Ensuite vous nettoierez, vous argumenterez en disant « À tel prix on ne peut pas faire ça », « Nous n’avons pas la capacité de faire plus » et, enfin, la Ministre tranchera.
F.BLOCH Ce que M. Van Aelbrouck vient de dire pose problème : que vont pouvoir faire des opérateurs dont le projet a été jugé positif et qui ne reçoivent que 30 % ou 50 % du montant accroché à ce projet ? Dans le monde de l’entreprise, on considère que jusqu’à un certain pourcentage du montant nécessaire (environ 80 %) il est possible pour une PME de revoir son projet à la baisse ; en deçà de ce pourcentage, elle doit changer de projet ! Parce que soutenir un projet, c’est soutenir un montant. Ici c’est exactement l’inverse. Sur des projets jugés positifs les compagnies reçoivent selon les cas entre 90 % et 25 % du montant demandé et recommandé par l’instance d’avis. Je ne vois pas comment un cahier des charges peut se concevoir dans le cadre de tels écarts. D’autant qu’aucune justification ne les accompagne… Il y a un vrai problème de lisibilité qui handicape le travail à venir. La seule chose claire est qu’il y a une chute au niveau du théâtre adulte, qui est le secteur qui n’a pas été privilégié par Madame la Ministre, et qu’au sein de ce secteur, il y a une chute des compagnies portées par les artistes, qui est le mode de fonctionnement qui n’a pas été privilégié par Madame la Ministre (augmentation des compagnies de 0,5 % pour une augmentation globale du secteur de 10 %).
PH. SIREUIL Je voudrais faire un brin d’histoire. Autour de cette table, je suis le seul à avoir participé à un débat intitulé « Le Théâtre et l’État ou le cul entre deux chaises », organisé par Alternatives théâtrales en décembre 1982 et qui relatait déjà dix ans d’errance3. On ne peut comprendre l’attitude des décisions ministérielles qui viennent d’être énoncées et leurs conséquences si l’on ne s’en réfère pas à ce que la Belgique francophone connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Cette évidence plaît rarement : en Belgique il n’y avait pas de plan pour les théâtres avant que l’occupant ne s’en occupât. La fondation du Théâtre National de Belgique s’inspire de cet accident de l’histoire, mais il faudra attendre l’arrêté royal de 1957 pour que l’État décide d’interférer en instituant un certain nombre de théâtres à partir des entreprises nées du privé. Contrairement à la création des maisons de la culture et des centres culturels, et à l’exception notoire du Théâtre National, le rôle de l’État vis-à-vis des théâtres a toujours été celui d’accompagner et non de faire naître.
le rôle de l’État
vis-à-vis des théâtres
a toujours été celui d’accompagner
et non de faire naître.
La différence explique pour une part ce à quoi nous sommes confrontés aujourd’hui. Jusqu’à récemment, l’organisation politique de la gestion des Arts de la Scène consistait en ce qu’Henri Ingberg4 appelait « la tranche milanaise » : augmenter progressivement sans remettre en cause ce qui existe. Ces quinze dernières années, il y a eu une inflation de 17 %. La moyenne générale de l’augmentation des théâtres obtenue en 2018 se chiffre aux alentours de 9,5 %. Je parle ici des théâtres avec un bâtiment. L’enveloppe de départ est donc absolument insuffisante.
R. GOLDENBERG Je rejoins ce que disent Philippe Sireuil et Michael Delaunoy : les décisions ont été prises sans une volonté politique d’insuffler une direction. Pour le secteur de la danse, c’est un réel problème : nous n’avons pas un réseau de diffusion très important en Fédération Wallonie-Bruxelles. Pour mémoire, le secteur représente 6 % du budget des Arts de la Scène, il y a un seul centre chorégraphique (Charleroi danse – qui concentre 50 % du budget danse), et une salle dédiée aux arts chorégraphiques (Les Brigittines). Depuis des années, nous demandons une impulsion politique pour soutenir le développement de ce réseau, qui passerait par une inscription de la programmation et co-production des arts chorégraphiques dans les missions des théâtres et des centres culturels. C’est ce qui a été fait en Flandres, où la création d’un réseau de diffusion en danse permet au secteur de se développer sur le territoire national avant de se déployer au-delà des frontières belges.