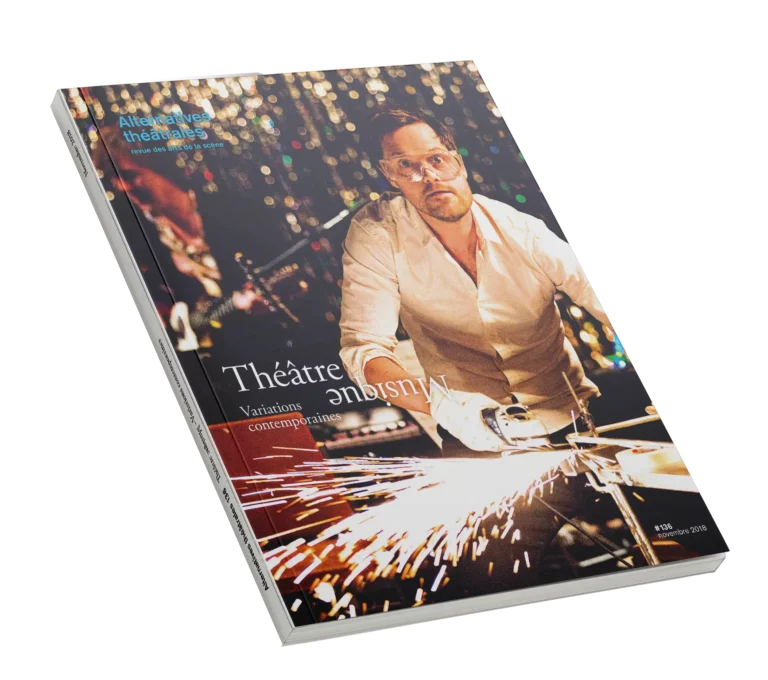Théâtre musical ou musique théâtrale ? L’important est d’être absolument impur, renégat, contre-nature et contre soi-même. Faire du théâtre de manière musicale, et de la musique de manière théâtrale. Surtout pas l’inverse. À la limite, faire de la musique de manière musicale passe encore. Mais du théâtre de manière théâtrale…
Commencer par finir
Ce que je sais, c’est que s’il n’était pas possible de faire du théâtre comme si c’était de la musique, je ferais autre chose que du théâtre. Disons que le théâtre est pour moi le moyen de faire de la musique avec les éléments qui composent le théâtre : le texte, les voix, les corps et le bruit qu’ils font en bougeant, le temps et tout ce qu’il contient, action ou vide, les lumières. Les lumières sont temporelles, rythmiques. Je laisse l’éclairagiste composer sa palette, mais je décide de la conduite, c’est-à-dire de la temporalité de la lumière (moments, bascules, durées). Les deux principales manières d’éteindre la lumière au théâtre sont le fading out (on baisse lentement) et le cut (on coupe d’un coup). C’est très musical.
Il y a un spectacle de Christoph Marthaler que j’ai vu en 2004 à la MC93 Bobigny, et dont j’ai par la suite imité la fin, tant je la trouvais musicale. C’était une affaire de rythme, mais où entraient en jeu le chant, le jeu et la lumière.
Le spectacle s’appelait Les Dix commandements1, et était adapté de l’auteur napolitain Raffaele Viviani. On y voyait une placette, un campiello, ses habitants, ses commerçants, leur vie quotidienne, leurs bavardages, presque rien, et leur envie d’ailleurs. À la fin, rassemblés dans la chapelle d’une église contiguë à la place, ils chantaient une espèce de romance sucrée, populaire et utopique, qui disait le désir de partir, le rêve impossible de voyage. C’est une très belle fin : on reste là, tandis que la chanson dit qu’on part : (« – On y va ? – Allons‑y. Ils restent sur place. »2)
Lumineusement parlant, n’importe qui aurait fini ça avec un fading out : la lumière baisse lentement sur la chanson, elles arrivent au noir à peu près en même temps : émotion garantie. Mais Marthaler fait autrement, parce qu’il est musical : la chanson s’achève, les chanteurs bavardent quelques secondes entre eux, on n’entend pas ce qu’ils disent, mais on entend qu’ils parlent, et la lumière s’éteint cut. L’émotion n’est pas attendue, mais surprise. Elle se déclenche non pas pendant la fin qui dure, mais après la fin qu’on n’a pas vu venir (comme souvent dans la vie). C’est du théâtre musical, au sens où c’est une manière musicale de faire du théâtre.
Grande petite forme
L’une des sources, l’un des noyaux du théâtre musical, c’est le cabaret. Vieille forme, populaire, immédiatement compréhensible, à laquelle on assiste en étant détendu, et qui, à ce titre, était considérée par Brecht comme un modèle pour le théâtre épique. Le cabaret contamine tout ce qu’il touche, pas pour le détruire mais pour le régénérer. On trouve même du cabaret dans l’opéra. Dans La Flûte enchantée de Mozart, le personnage de cabaret, c’est Papageno, l’oiseleur. Le rôle a été composé pour Schikaneder, le propriétaire du théâtre, qui n’était pas chanteur mais acteur. C’est un rôle chantable par un acteur. À la fin de l’opéra, il décide de se suicider par désespoir amoureux, compte jusqu’à trois mais diffère sans cesse le moment d’arriver à la seconde fatale. C’est un numéro de cabaret, au cœur d’un opéra. Une petite forme, comme on dit, au milieu de LA grande forme.