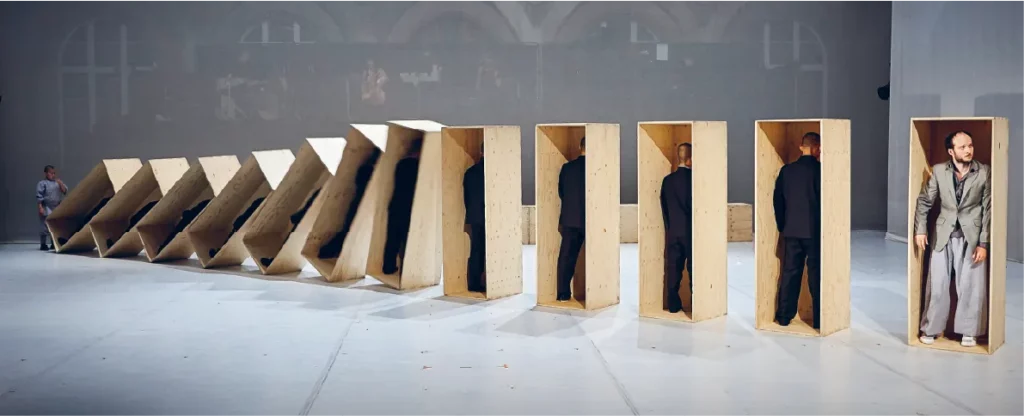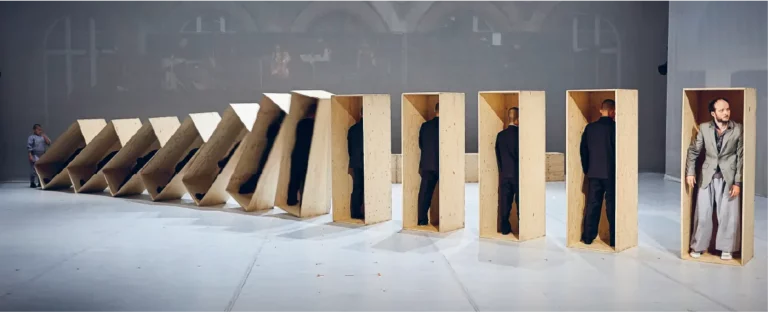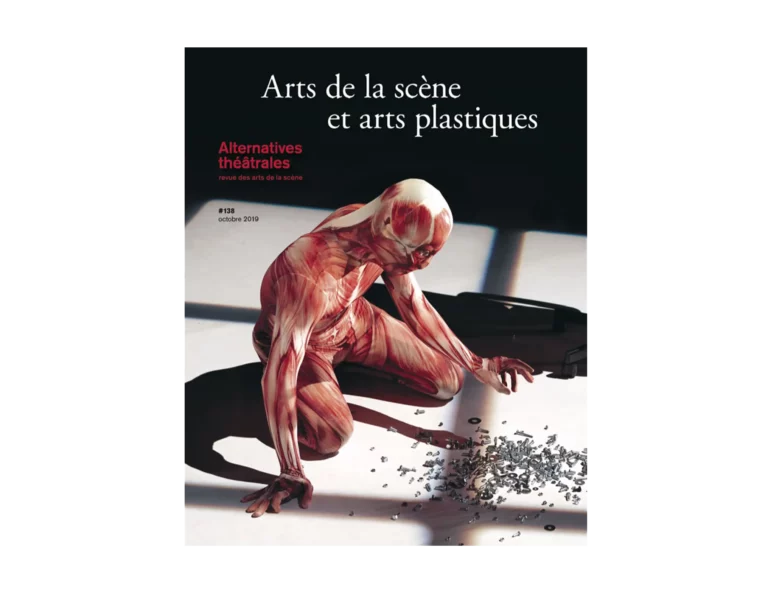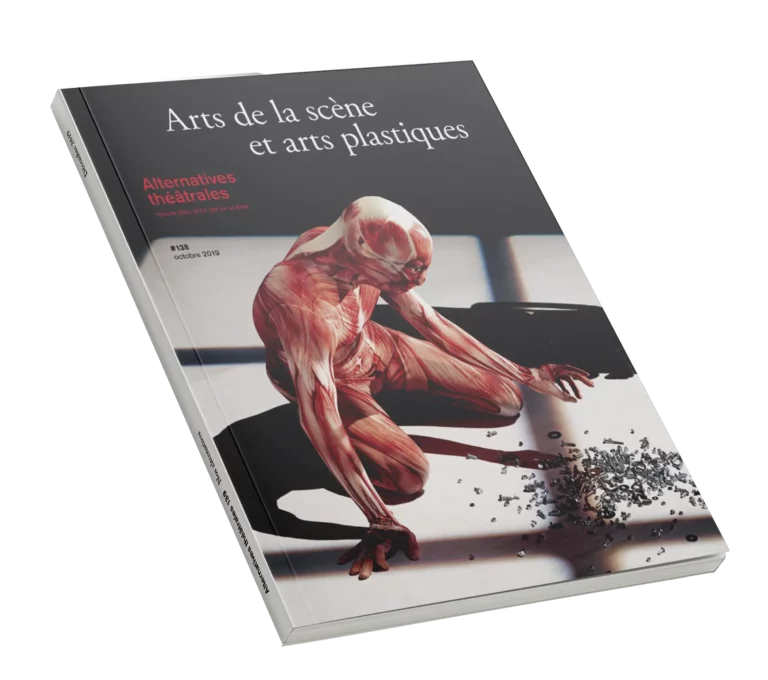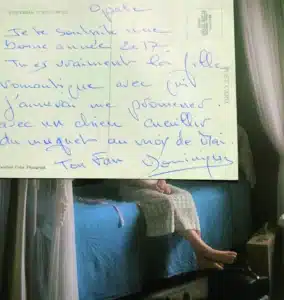Où en est-on, un siècle et demi après la révolution scénique pensée et partiellement réalisée par Richard Wagner, de la théorie du Gesamtkunstwerk qui donnerait à chaque discipline sa juste place dans “la ronde des arts” ? Si la hiérarchie wagnérienne n’est plus à l’ordre du jour depuis longtemps, contestée dès les années 1920 par la vision démocratique d’un compagnonnage égalitaire de la musique, de la peinture, du livret et de la chorégraphie orchestrée par Serge Diaghilev et Rolf de Maré au sein des Ballets russes (1909 – 1929) et des Ballets suédois (1920 – 1925), c’est tout de même au compositeur allemand que la danse moderne doit d’avoir conquis — tardivement — ses lettres de noblesse, et qu’elle a pu revendiquer, à ce titre, un droit à l’indépendance l’autorisant paradoxalement à se passer du secours de ses “arts-frères”. Pouvoir danser en silence, sans décor ni costumes somptueux, voilà qui affranchit, au tournant du XXe siècle, les premières “danseuses libres” de toute tutelle étrangère, et recentre l’attention du public sur l’essence même du geste. Mais nouveau paradoxe, Isadora Duncan, qui n’utilisait, en guise de toile de fond, qu’un modeste rideau bleu et pour tout costume, qu’une tunique légère inspirée du chiton grec, a suscité chez les peintres, sculpteurs, et dessinateurs de son temps un engouement nonpareil. Même constat pour Loïe Fuller, dont les savantes architectures lumineuses offraient aux yeux d’un public médusé le spectacle d’un art proprement immatériel, qui fera dire à Mallarmé : « Le décor gît, latent dans l’orchestre, trésor des imaginations1 ».
Célébrées l’une et l’autre comme de véritables « sculptures vivantes2 », elles ont laissé dans l’histoire des arts plastiques et du design de leur époque quantité de chefs‑d’œuvre — esquisses, tableaux, statues, affiches ou objets manufacturés — où se donne à voir le vertige d’un mouvement en train de s’accomplir. Aux portraits de la “danseuse aux pieds nus” par Eugène Carrière, Auguste Rodin, Antoine Bourdelle, Jules Grandjouan, André Dunoyer de Segonzac, José Clara, Alfred Halou, Edward Gordon Craig, Abraham Walkowitz, Mikhail Dobrov, Van Saan Olgi, François Gorguet, Maurice Charpentier-Mio, Valentine Lecomte, Maurice Denis, et de la “Fée Électricité” par Jean de Paléologue, Pierre Roche, Toulouse-Lautrec, Victor Choubrac, Jules Chéret ou François-Raoul Larche, s’ajoutent, à la même époque, ceux de Mary Wigman par les peintres expressionnistes Emil Nolde et Ernst Ludwig Kirchner, qui se sont efforcés de saisir tour à tour la force hiératique et la sauvage sensualité de ses danses. À ceux qui lui reprochaient son manque de féminité dans sa célèbre Danse de la sorcière, le critique allemand Rudolf von Delius rétorque, en 1925, que son érotisme « n’a fait que s’accroître [et qu’] en s’accroissant, il s’est transformé en autre chose. Il abandonne la lourde matière pour devenir une brûlante vibration de l’éther3. » À l’instar de ses condisciples américaines, la danseuse allemande « tir[e] son art de la matière même de son corps4 », réduisant au maximum tout ce qui risquerait de faire obstacle à la vision des paysages intérieurs déployée dans ses solos ou ses pièces chorales. Le masque qu’elle porte dans Hexentanz puis dont elle revêt ses interprètes dans la Danse des morts (1926) aurait alors plutôt une fonction d’effacement — de la fable comme du lieu concret de la représentation — pour mieux faire apparaître la seule dynamique sensorielle, émotionnelle, spirituelle du geste.
En littérature comme en peinture, la fascination exercée par la figure dansante fait naître le désir — de l’ordre du défi — de traduire ici en mots, là en images ce qui, a priori, échappe ontologiquement à ces modes d’expression artistiques : dans les marges du langage et des formes visibles, le rythme pur en tant que phénomène ondulatoire et vibratoire devient l’un des objets de spéculation et d’expérimentation favoris de la Modernité. Désormais, comme le montrent bien les recherches de Rudolf Laban dans les domaines de la choreutique et de l’eukinétique à partir de l’analyse de la kinesphère du danseur5, le corps n’est plus seulement dans l’espace mais il le contient, le crée, l’anime, s’y projette et le transforme au gré de ses évolutions saltatoires. Les avant-gardes théâtrales, picturales et même littéraires du premier XXe siècle font leur cette injonction vitaliste de repenser l’espace et le temps en termes de rythme, d’énergie et d’intensité, à laquelle la première génération de danseurs (et surtout de danseuses) libres — grands lecteurs de Nietzsche, Bergson et Klages — a répondu en se passant largement du concours des autres arts. Mais l’inverse se produit également, quand des peintres imaginent pour la scène futuriste et le théâtre du Bauhaus des ballets abstraits ou mécaniques, d’où tend à s’absenter la figure humaine.
Les premiers exemples de rapprochement véritable entre les deux pratiques apparaissent en France au cours des années 1910 et 1920, lorsque Diaghilev et Rolf de Maré offrent au public parisien le spectacle de brillantes collaborations artistiques. On revient alors à la grande forme du ballet, mais cette fois, ce sont des peintres de renom qui prennent le relais des décorateurs de théâtre à l’ancienne. Les russes Léon Bakst, Alexandre Benois, Natalia Gontcharova ou Michel Larionov marquent de leurs couleurs chaudes et puissantes les débuts flamboyants des Ballets russes dans les pièces d’inspiration slave, antique ou orientalisante de Fokine, Nijinski et Nijinska, avant que ne leur succèdent, à la fin de la guerre, des artistes d’Europe de l’Ouest : Picasso réalise en 1917 le rideau de scène, le décor et les costumes de Parade (1917) — dont les fameuses carapaces cubistes des Managers —, puis ceux de Tricorne (1919) et de Pulcinella (1920), chorégraphiés par Léonide Massine ; Sonia et Robert Delaunay, Derain, Matisse, Coco Chanel, Henri Laurens, Marie Laurencin, Georges Braque, Chirico ou encore Rouault seront également sollicités par Diaghilev pour donner à sa compagnie un éclat inégalé dans l’histoire française du ballet néoclassique, jusqu’à sa mort en 1929.
” je ne veux pas un décor, précise-t-elle au plasticien, je veux quelque chose qui transforme l’espace et nous donne une autre manière de voir la danse.”
Lucinda Childs
C’est peut-être moins la recherche d’une distribution de prestige qu’un appétit insatiable de nouveauté et le désir d’expérimentations toujours plus audacieuses qui poussent Rolf de Maré vers des peintres de la jeune avant-garde française comme Irène Lagut, Francis Picabia ou Fernand Léger. Dans Skating Rink (1922) et plus encore dans La Création du monde (1923), ce dernier achève de transformer le ballet en une succession de « tableaux animés6 », réduisant les danseurs « au rôle de figurants7 ». Le peintre s’en excuse presque : « je veux rendre ici hommage à Rolf de Maré, directeur des Ballets suédois, qui, le premier en France, a eu le courage d’accepter un spectacle où tout est machination, et jeux de lumière, où aucune silhouette humaine n’est en scène ; à Jean Börlin et à sa troupe condamnée au rôle de décor-mobile8. » L’un des tout premiers critiques de danse français, Fernand Divoire, parlera à son tour des Ballets suédois comme d’un essai original de « peinture animée » ou de « ballet pictural », pour conclure que « [l]a danse se plie à ce que commande le tableau9. » Pour le très conservateur André Levinson, il s’agit là d’une « capitulation pure et simple du danseur devant le peintre10 ».
Depuis ce point de non-retour atteint par la troupe de Rolf de Maré et de son chorégraphe attitré, Jean Börlin, qui a fini par provoquer la dissolution de la compagnie après Relâche (1924), comment la relation entre plasticiens et danseurs a‑t-elle évolué et retrouvé un équilibre ? Lorsque Martha Graham fait appel à Isamu Noguchi, formé auprès de Brancusi, pour scénographier une vingtaine de ses œuvres des années 1940 à 1980, la danse n’a plus à prendre sa “revanche” sur les autres arts, ni à lutter contre eux pour asseoir sa légitimité. Entre la chorégraphe et le sculpteur nippo-américain s’établit au contraire une harmonieuse complicité, l’espace épuré de l’un venant « magnétiser11 » la danse de l’autre en créant tout un faisceau de résonances et de tensions subtiles entre les matériaux élémentaires utilisés (pierre, os, bois, corde, bronze) et le geste organique qui se coule dans les interstices du visible. Quand Merce Cunningham, dans une optique bien différente, donne à son tour carte blanche à Robert Rauschenberg, Andy Warhol, Frank Stella ou Jasper Johns pour imaginer les décors et les costumes de ses pièces, le “hasard objectif” qui préside, cette fois, à la rencontre des corps et des images selon une vision parfaitement “émancipée” de la représentation n’en aboutit pas moins à ce même effet d’attraction mutuelle, en dehors de toute intention de signifier. Adolphe Appia ne concevait par autrement, sur le plateau, la mystérieuse interaction entre présence humaine et objets scéniques :