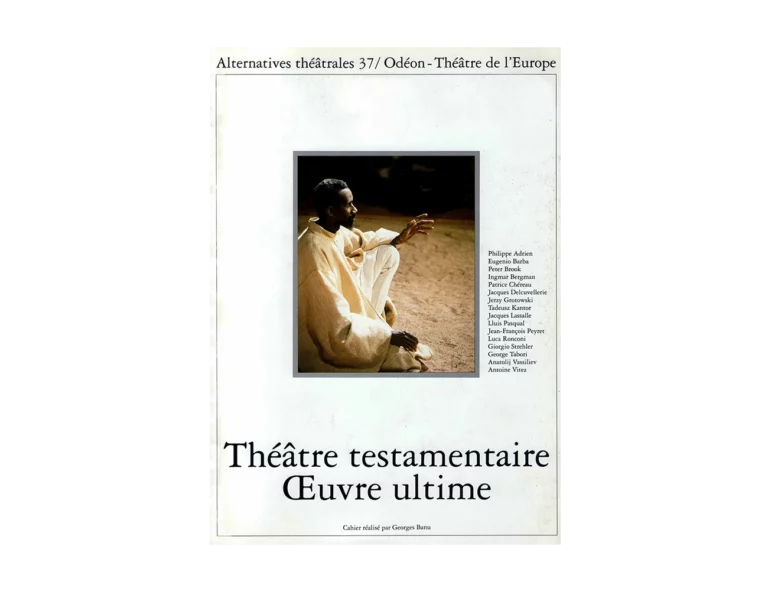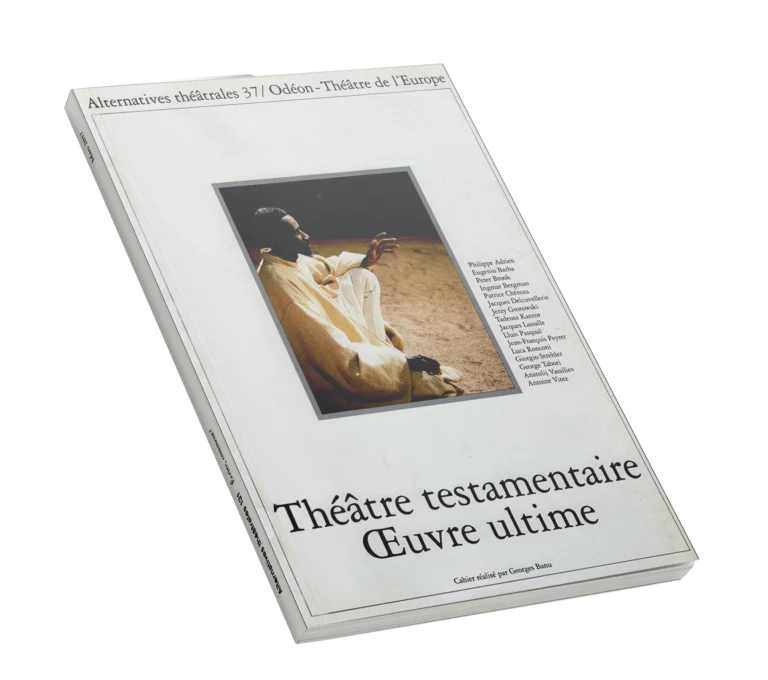LE théâtre n’est pas un art de la mémoire. De la répétition, oui, mais non pas de la mémoire. Essayez une seconde de les opposer, s’il vous plaît. Le roman, difficile pour lui de ne pas aller du côté de la mémoire, quitte à en revenir. Vous en avez la preuve par Proust. L’épopée, à l’origine du roman, sans doute aussi côté mémoire : Musa, mihi causas memora. (Encore est ce Virgile qui parle, car Homère dit plutôt : chante!).
Mais le théâtre, non. Côté répétition. Et donc aussi côté événement. Côté cour et côté jardin. Au plus près de la rampe, du moins dans tout théâtre où on évite le fond de la scène, sombre et silencieux, romanesque. Dans tout théâtre de toujours. Evidemment, FAUST, les deux FAUST, les deux de Virez et les deux de Grüber (mais non les deux de Goethe), côté Vitez : le FAUST d’Ivry, très simple, et le FAUST de Chaillot, plus compliqué, et côté Grüber : le FAUST-Salpêtrière, très compliqué et le FAUST de l’Odéon, si simple, leurs valises, leurs malles, leurs boîtes, leurs machines, les plis de leurs manteaux ou de leurs rideaux, n’est-ce pas de la mémoire que, commodément, tous ces objets étaient allégoriques ? Je dis non, par principe. Comme un qui n’aime pas la mémoire, et encore moins le roman — à moins qu’il n’efface pour finir la mémoire en retrouvant le Temps, long, travail !
Mais d’abord Goethe. Faust vieux devient jeune, il ne le redevient pas. Il a seulement inversé l’ordre ordinaire : il est jeune après vieux, mais il n’y a nulle machine à remonter le temps. Les autres, eux, continuent à vieillir sans problème.
À Ivry, tout habillé, Antoine Vitez rentrait dans sa malle. A Chaillot, tout nu, il sortait de sa malle. Il songeait, à Ivry, à ces malles que les enfants ouvrent dans le grenier ; à Chaillot, on songeait à la malle comme à une boîte de Pandore d’où sortirait l’homme parfait de Léonard de Vinci. Enfance, naissance, dans les deux cas, car si la malle est la mémoire des vieux, pour les enfants, elle n’est que boîte à surprise, ou comme ces boîtes à Silènes dont parle le bel Alcibiade à propos du laid Socrate et qui contiennent de belles figurines de dieux.
À la Salpêtrière, les boîtes ou machines à sous qui représentaient la fabrication des assignats à la Cour de l’Empereur (était-ce bien cela, ma mémoire me fait défaut ?), c’étaient avant tout des machines de théâtre, évoquant la vie d’aujourd’hui, l’argent, les stands d’une exposition. Ensuite, au fond de la même salle, bien sûr, le pèlerinage aux Mères, qui sont, paraît-il, les formes primordiales plutôt que la mémoire, mais dont le théâtre a de toute façon horreur, puisque Faust dit : « Les Mères ! Les Mères ! ‑cela sonne de manière si étrange ! »
À l’Odéon, le fond noir de la scène, la cheminée sombre, le pupitre de Faust, les plis du rideau, que de métaphores de la mémoire pour le sémiologue hâtif ! Et pourtant, le moment où le public éprouva comme un coup de foudre, ce fut celui où Marguerite reprisait, cousait le rideau de scène, retenu par une longue cordelière. De même, dans LA MORT DE DANTON, celle de Grüber, on tissait les drapeaux, on se passait l’écheveau de laine bleu, blanc, rouge. Or, si le public fut bouleversé, dans FAUST, c’est que par opposition au vieux grigou chargé de tout le savoir allemand, la jeune fille faisait ce geste innocent, évident, dénué de sens.
Là où était la mémoire, le théâtre, s’il l’efface, arrive. Et aussi la malle où l’on s’enferme, elle indique que le théâtre traduit les problèmes de temps en problèmes d’espace. « Zum Raum wird hier die Zeit », dit Gurnemanz à Parsifal, donnant la loi du théâtre.
Orgon sous la table, la trappe de DOM JUAN, trucs authentiques de théâtre, à. l’encontre de ce truquage de l’armoire symbolique éhontée qui dans l’invisible Cerisaie est censée évoquer pour Gaïev un passé romanesque. L’introduction de ce temps de mémoire a bien failli détruire le théâtre. Aussi sais-je gré à Gracq d’avoir écrit :
« L’insatisfaction que me donne le théâtre de Tchékhov, vu à travers une pièce comme LA CERISAIE : ce sont des pièces qui semblent adaptées d’un roman. Le souvenir gênant d’un autre moyen d’expression possible n’est jamais complètement refoulé par le spectacle. Si bonnes quelles soient — ce qui suffit à tuer le chef‑d’œuvre — on lit au travers en filigrane : Pourrait être rendu autrement » (LETTRINES).
Pour démontrer que Gracq a tort, il faut de très forts arguments. Ou cette preuve qu’a donnée Grüber montant SUR LA GRAND-ROUTE de Tchékhov, et corrigeant le temps lent par des différentielles de vitesses dans un espace intérieur et restreint.

S’il y a Testament, comme on me presse de le trouver, au théâtre, je dirai encore que c’est contre la Mémoire. Melpomène et Thalie contre Mnémosyne.
Comme le Nouveau Testament accomplit l’Ancien, parce qu’il en « fait mémoire » au sens catholique, en répétant ici et maintenant le passé aboli, et non au sens protestant de commémoration. Par où le théâtre est catholique depuis les Grecs, ce qu’a dit Claudel.
Origène remarque en effet que Jésus ne dit pas tant : je vous rappelle Moïse, que : « C’est de moi que Moïse a écrit » (Jean, V, 46).
Comme au théâtre, c’est de toi qu’ont écrit Eschyle, Shakespeare et Claudel, et c’est de toi que parlent Prométhée, Hamlet et Tête d’Or, Cassandre, Ophélie et Ysé.
Il fallut le sacrifice une fois d’un bouc pour que, l’ayant oublié, nous le célébrions dans la tragédie, et dans la comédie, la procession autrefois des choses phalliques, qu’aujourd’hui nous voilons.