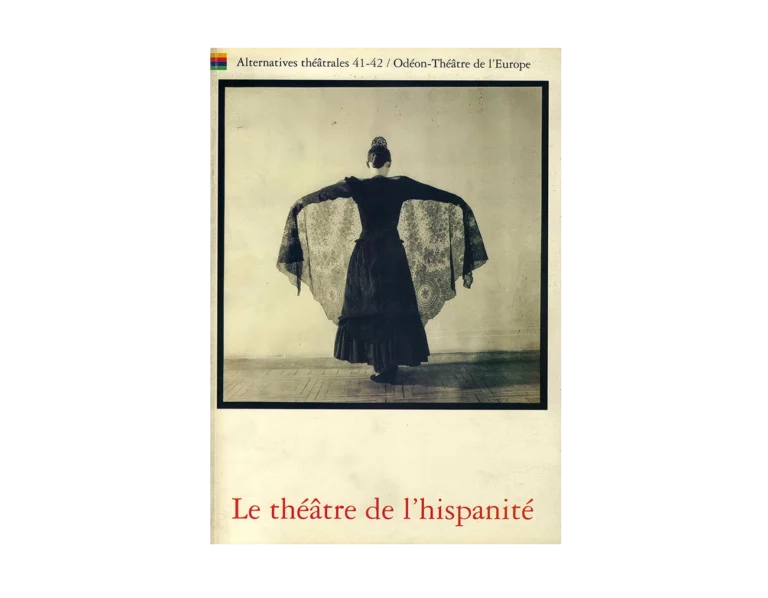GÉRARD RICHET : Pour inaugurer le Théâtre le la Colline, vous avez monté LE PUBLIC de F.G. Lorca. En outre, vous avez donné à la revue de votre théâtre le titre de cette même pièce. Doit-on en déduire que le choix de cet auteur et de cette œuvre a été de votre part un geste fondateur ?
Jorge Lavelli : Je dois dire que je ne suis pas un lorquien, même si j’ai monté DONA ROSITA il y a quelques années avec Nuria Espert. Mais il est vrai que le choix que j’ai fait de présenter LE PUBLIC pour inaugurer le Théâtre de la Colline est tout à fait significatif et symbolique. Ce qui m’a intéressé dans cette pièce, c’est le questionnement profond de l’auteur, la façon dont il part à la recherche de la vérité et questionne le théâtre comme un lieu d’artifices où tout semble possible, mais il y a des choses qui ne le sont pas, car il s’agit quand même d’un lieu culturel, où l’on ne peut pas tout dire, tout dévoiler. Il m’a semblé que cette pièce était véritablement emblématique pour l’ouverture d’un théâtre nouveau, non pas par son aspect provocateur, mais par la radicalité de la quête de la vérité qu’elle propose. Si la vérité existe, comment faire pout la cerner ? Peut-on faire sauter toutes les barrières, quitte à tout perdre, quitte à se mettre dans une situation de provocation totale ? Cette idée d’un théâtre qui doit avoir des racines véritables, d’un théâtre qu’on doit chercher sous terre, d’une vérité qu’on doit trouver à l’intérieur de nous-mêmes, d’un théâtre qui ne chercherait pas à tricher et qui montrerait qu’il y a un savoir-faire théâtral, tout cela m’a semblé dessiner l’image d’un théâtre qui serait fondé sur la liberté.
D’autre part, dans LE PUBLIC, Lorca entreprend un questionnement complet, non seulement de son écriture, mais aussi de lui-même en tant qu’artiste, de sa propre raison d’être. Je vois là un modèle, si j’ose dire, d’un théâtre qui serait axé sur la création. Il est évident qu’il est très La structure du désordre — Entretien — difficile pour un auteur de contester son savoir-faire, de remettre en cause sa capacité à raconter des histoires distrayantes ou émouvantes. C’est pourquoi je pense qu’avec le temps l’élément fondamental de Lorca restera précisément dans cette œuvre. Même si, en apparence, elle est inachevée, elle est absolument achevée sur Le plan théâtral, et elle reste comme une sorte de témoignage ultime de Lorca, et en même temps son chef-d’œuvre.
Le fait d’avoir monté LE PUBLIC représente pour moi une sorte d’appropriation et une façon de me situer, moi, par rapport au théâtre. C’est cette coïncidence-là qui me semble importante. Il m’est apparu que ce que Lorca exprimait de façon exemplaire touchait à quelque chose qui était fondamental dans ma propre démarche. Pour moi, il était clair que cette œuvre devait être présentée pour ouvrir un nouveau théâtre, car elle en révélait l’esprit.
Je dois avouer qu’après ce texte, il y a eu un grand vide. Je n’ai pas trouvé autre chose qui soit aussi génial, aussi fort, aussi provocateur, aussi déchirant, aussi cassé à l’intérieur.
G.R. : Lorca rangeait LE PUBLIC parmi ses pièces impossibles ou irreprésentables. Voulait-il dire que les spectateurs n’étaient pas prêts à la recevoir ou bien qu’elle posait des problèmes presque insurmontables de mise en scène ?
J.L. : Quand Lorca parlait d’une pièce impossible, je ne crois pas qu’il se référait seulement aux critiques ou au public, à tous ceux qui allaient recevoir l’œuvre. Il pensait aussi aux acteurs qui devaient assumer et incarner ce texte, lui donner un poids véritablement charnel et une dimension théâtrale. Lorca est partout dans LE PUBLIC, il est démultiplié : il est en même temps l’auteur, le metteur en scène et les personnages. Il faut donc beaucoup d’intuition et de sensibilité pour ressentir et surtout assumer ce qu’il y a de cassé dans la pièce, ce constat d’échec par rapport au théâtre, ce besoin de revendiquer une vérité qui ferait honte aux spectateurs et gênerait le plus profond de l’être. Il y a là une idée véritablement immense, géniale, qu’il est très difficile d’assumer.
LE PUBLIC n’est pas seulement un jeu d’invention et de provocation, mais le témoignage de quelqu’un qui sentait peut-être la mort très proche. La mort y est présente partout, ainsi que le besoin de casser totalement un art, de le démasquer. Et tout cela avec une concentration, un esprit de synthèse et de théâtralité pas simplement nouveau, mais rare, unique. On disait qu’en 1930 c’était trop tôt, mais je crois que ça l’est encore maintenant. Finalement le théâtre d’aujourd’hui est aussi conventionnel et bourgeois qu’en 1930, et c’est d’ailleurs ce qui m’a frappé en découvrant cette œuvre. Le théâtre va beaucoup moins vite que la pensée des gens, même de ceux qui le pratiquent, beaucoup moins vite que la poésie ou la peinture. Au théâtre, on a toujours besoin de références anciennes. Les choses ne sont pas admises immédiatement. Ou alors, on aime accepter une idée, une clé, parce qu’on croit qu’elle permet de tout comprendre. Mais Lorca ne délivre pas un message clair, il n’exprime pas une angoisse qui réponde à une attente collective. Il n’annonce pas une catastrophe, mais propose de détruire une vision du monde et du théâtre. Il met le doigt sur ce qu’il y a d’essentiel dans ce mensonge qu’on appelle le théâtre, cet art qui se conteste lui-même. Pour toutes ces raisons, LE PUBLIC n’est pas une simple pièce mais une démarche gigantesque, à laquelle le temps finira par donner une perspective.
G.R. : Vous venez de monter les COMÉDIES BARBARES de Valle-Inclán. Comment expliquez-vous que l’on découvre avec autant de retard cet auteur majeur de notre siècle ?
J.L. : Valle-Inclán est un auteur difficile, essentiellement à cause de sa langue. On trouve dans son œuvre une telle invention verbale, une telle fantaisie, une manière de s’approprier des mots galiciens, portugais ou américains en les inscrivant dans des expressions qui n’appartiennent qu’à lui, que cela crée d’emblée un certain dépaysement. C’est pour cette raison qu’il a du mal à franchir les frontières. Même en Espagne ou en Amérique latine, les gens ne comprennent pas tout ce qu’écrit Valle-Inclán. J’ai monté DIVINES PAROLES à Buenos Aires il y a très longtemps, avec Maria Casares, et je me souviens qu’on avait inclus un petit lexique dans le programme.
Mais l’œuvre de Valle-Inclán est aussi d’une immense théâtralité. D’une certaine manière, c’est un auteur régionaliste — ses œuvres galiciennes sont très galiciennes —, mais je suis persuadé qu’un théâtre typiquement local peut devenir un théâtre universel. C’est pourquoi j’ai toujours été favorable à l’idée de monter une œuvre de Valle-Inclán. Car, enfin, tout ce qu’on trouve en Galice, on le retrouve dans l’esprit de l’homme. Ce n’est pas de la pure imagination. Il y a chez Valle-Inclán une véritable sensibilité qui est liée à une manière de vivre, de penser, de sentir la mort, le monde et toutes les grandes choses qui déterminent la situation de l’homme et sa raison d’être dans la vie. Ces choses-là peuvent intéresser partout.
Cela dit, pourquoi un auteur aussi important que Valle-Inclán a‑t-il été pendant si longtemps ignoré ou méconnu dans des pays proches de l’Espagne, comme la France ou l’Italie ? Il y a, c’est évident, des raisons politiques. Quarante années de franquisme ont créé une sorte de mépris à l’égard de l’Espagne, qui était vue comme un pays archaïque, refermé sur lui-même. D’ailleurs, les Espagnols eux-mêmes ont oublié leurs propres auteurs et la reconstruction qui s’est amorcée va demander beaucoup de temps. Mais il y a, à mon avis, un autre facteur : c’est le manque de curiosité en France à l’égard de l’étranger. La France est un pays qui peut donner un élan considérable à un peintre ou à un auteur, mais à condition qu’il s’inscrive dans un contexte français. On ne va pas le chercher. Cet élément a sans doute joué en ce qui concerne les auteurs espagnols. Je trouve très curieux, par exemple, que dans un pays où l’on adore le mythe de don Juan, où l’on célèbre le DON GIOVANNI de Mozart, où l’on ne cesse de jouer le DON JUAN de Molière, on n’ait jamais joué — ou seulement de façon marginale — le DON JUAN de Tirso de Molina, et jamais celui de Zorrilla. Le théâtre français, et plus généralement la littérature française, ont largement emprunté à la culture espagnole, mais on a complètement oublié les œuvres originales.

G.R. : Ce manque de curiosité paraît tout de même très sélectif. La dramaturgie de langue allemande semble pénétrer en France sans trop de problèmes.
J.L. : Il est certain que la source germanophile est très forte en France. L’Allemagne est un pays de référence, un pays exemplaire, à commencer par son économie. Tous les gouvernements français, de droite comme de gauche, ne cessent de se situer par rapport à l’Allemagne. Ce qui est vrai pour l’économie l’est aussi pour la Littérature. Cela dit, la littérature dramatique allemande est en soi très importante. La découverte de Brecht en France a profondément marqué le théâtre et les auteurs français.
G.R. : Vous avez parlé récemment, à propos de Valle-Inclán, du « sentiment tragique de l’âme espagnole ». Voulez-vous dire par là que dans la mentalité espagnole, et sans doute aussi dans la dramaturgie espagnole, on sent toujours la présence d’une force qui agit sur le destin des hommes, cette force étant d’une certaine manière irrationnelle ?
J.-L. : Je pense effectivement que l’esprit espagnol est beaucoup moins rationaliste que l’esprit français. C’est très sensible dans la littérature. Prenons Cervantes, par exemple : que ce soit dans ses romans ou dans son théâtre — voilà encore un auteur espagnol dont l’œuvre est très peu connue en France —, on remarque que l’incursion dans le domaine de la fantaisie et de l’imaginaire est immense.
En même temps, le théâtre espagnol est très lié à la réalité. Dans une œuvre-clé de la littérature espagnole comme LA CÉLESTINE de Fernando de Rojas, on trouve tout le théâtre espagnol, c’est-à-dire cette espèce de profanation des choses et cette irrévérence à l’égard des valeurs, qui s’expriment par l’introduction d’un langage d’un réalisme incroyable pour l’époque. Une CÉLESTINE à la française est impensable. Le théâtre français de la même époque était un théâtre d’élite, de cour, de codes, qui cherchait à plaire et à séduire, alors que le théâtre espagnol se jouait dans des corrales et manipulait de manière fabuleuse les rapports avec le réel.
Le théâtre espagnol ne rentre donc pas dans les normes culturelles. Je pense que, même aujourd’hui, il est difficile d’accepter cette pensée sans orthodoxie, cette pensée dialectique, qu’il y a dans le théâtre espagnol, où tout est toujours contesté, où l’on trouve sans cesse des choses contradictoires, où on ne sait pas très bien comment se situer. Le théâtre de Brecht se conforme très bien à la pensée française, selon moi, car il développe une pensée très organisée et cohérente. Le courant espagnol n’a pas cette cohérence-là. On y trouve à la fois le tragique et la dérision de ce tragique. Dans ce théâtre très particulier, le mot drame n’existe pas, la comedia n’a pas du tout le même sens que celui qu’on donne ici au terme de comédie : il s’agit de la comédie de la vie, elle est à la fois tragique et dérisoire. Et je pense que c’est cet aspect-là qui est Le trait d’union entre les auteurs du Siècle d’or et d’autres plus proches de nous, comme Valle-Inclán, par exemple. Indéniablement, il y a une pensée commune.